LA SECTION ETRANGERE
INTRODUCTION
Ce fut pour la Belgique un sujet d'allégresse et de fierté de voir de nombreux pays, dont quelques-uns lointains, prendre part à l'Exposition internationale de Liège 1939. En s'associant ainsi aux manifestations organisées pour célébrer l'achèvement du Canal Albert et des autres grands ouvrages hydrauliques, ces participations témoignèrent non seulement du retentissement que ces travaux avaient produit au delà de nos frontières, mais encore de l'intérêt suscité par le thème inédit et original de l'Exposition.
A toute entreprise de ce genre, quel que soit son programme, les sections étrangères, officielles ou non, apportent une contribution souvent capitale. Elles permettent, par une comparaison directe et immédiate, d'apprécier le niveau de perfection technique atteint par les produits des diverses nations. Elles provoquent l'émulation nécessaire pour que l'effort de chacun, effort générateur d'initiative et de progrès, soit porté à son maximum. Et, dans un ordre plus élevé, elles favorisent singulièrement le rapprochement des peuples, par la conjonction des idées, des techniques, des faits sociaux et économiques. Une exposition est une incomparable leçon de choses qui ouvre les voies de l'optimisme et de la confiance, par la présentation des réalisations tendant à accroître le bien-être de l'humanité, réalisations dont chaque pays étale avec orgueil les exemples les plus remarquables.
Les quatre pays voisins de la Belgique répondirent spontanément à son appel. Par la suite, quelques autres participations vinrent s'y joindre elles furent moins importantes, mais non dépourvues d'intérêt, entre autres celles des deux pays nordiques: la Norvège et la Suède. Sans aucun doute, l'attrait du programme aurait encore tenté pas mal d'autres pays, si la vie politique de l'Europe avait été plus paisible à l'époque.
En fin de compte, on enregistra les Sections officielles suivantes Allemagne, Egypte, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède. D'autres pays eurent des participations individuelles ou collectives, mais non représentées officiellement. Citons entre autres l'Angleterre, la Pologne, la Roumanie, la Suisse. Au total, ce furent les produits de plus de douze pays qui figuraient à l'Exposition.
La part qui leur revient dans le succès de cette manifestation fut considérable, dans certains cas décisive. Ils y occupaient une surface totale dépassant les 20.000 mètres carrés, et les statistiques du Jury international des Récompenses nous révèlent que le nombre d'exposants étrangers inscrits s'éleva à 1.024, soit 47 % du chiffre total. Quant à la qualité des objets présentés, elle est attestée par le fait que ces exposants obtinrent dans l'ensemble 77 % de hautes récompenses, ce qui est tout à fait remarquable.
D'une manière générale, toutes les participations furent bien dans la note de l'Exposition. Elles se conformèrent d'une façon parfaite au programme spécialisé, bien que celui-ci ne les intéressât pas toutes au même degré.
La présentation fut réalisée avec beaucoup de recherche, souvent avec un soin méticuleux. Malgré l'obligation de suivre un thème commun, le caractère particulier de chaque nationalité apparut nettement dans chaque ensemble.
Nous avons réparti la description des Sections étrangères en huit chapitres: les monographies ont presque toutes été rédigées d'après le même plan. A cause de leur nombre trop élevé, il ne nous a pas été possible de citer tous les exposants, même les plus méritants, surtout dans le cas des grandes participations. Rappelons à ce sujet qu'ils sont tous repris, en même temps que les exposants belges, au Palmarès général alphabétique qui forme l'appendice I de la troisième partie de cet ouvrage.
Enfin, le concours, souvent important, que les pays étrangers ont apporté à certaines manifestations collectives comme les expositions d'art, les congrès et conférences, les salons temporaires, n'est pas acté dans ces chapitres, mais sera consigné dans la quatrième partie du rapport général.
CHAPITRE PREMIER
L'ALLEMAGNE
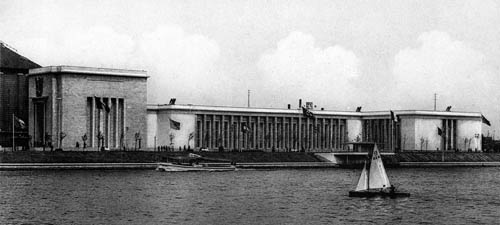
CLIC TO ENLARGE
1. INTRODUCTION
L'Allemagne fit construire, à l'Exposition internationale de Liège 1939, un grand palais en matériaux durs, d'une sobriété de lignes vraiment imposante, et qui occupa une place de choix à l'entrée principale de Coronmeuse, à gauche de l'esplanade d'honneur. En y comprenant les espaces occupés en plein air, à côté du palais, la surface totale d'exposition s'éleva à environ 7.000 mètres carrés.
Dans cette surface ne sont pas comptés les bureaux destinés aux différents services du Commissariat, ni les vastes locaux (réfectoire, salle de repos, etc.), agréablement aménagés à l'usage du personnel.
Le problème de l'eau est très important pour l'Allemagne. Pour définir exactement le rôle prépondérant de cet élément dans la vie actuelle et passée de ce pays, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'extrait suivant du Catalogue officiel de la Section allemande:
Dès les plus lointaines origines de notre histoire, nous voyons le rôle important que joue l'eau dans la vie de nos ancêtres. Les résultats des fouilles récentes prouvent que l'art de construire des bateaux était déjà fort développé chez les vieilles tribus germaniques. L'usage de bains chauds sembla si intéressant à Tacite qu'il le mentionne dans sa « Germania ». Les Romains établirent leurs camps sur le Rhin en tenant particulièrement compte du cours des rivières et de leur embouchure. De nombreuses villes allemandes (Coblence, Francfort, etc.) tirent leur nom du confluent de deux cours d'eau ou de gués importants. Charlemagne fit construire sa résidence impériale (Pfalz) aux sources chaudes d'Aix-la-Chapelle. Au moyen âge, la Hanse a donné une forte impulsion à la construction navale. Lorsque l'histoire du passé nous parle de grandes réalisations, il est toujours question de la construction de ports, de canaux, de digues, de l'asséchement de marais.
Nous reconnaissons aussi la forte influence exercée par l'eau sur notre vie culturelle dans les innombrables chants populaires et dans les poèmes qui célèbrent les étroits rapports entre l'homme et l'eau, rapports qui se sont encore approfondis dans les temps modernes par la pratique des sports nautiques. L'eau a inspiré non seulement la chanson populaire et la musique, mais aussi l'architecture et les arts plastiques.
Nous ne faisons donc que poursuivre une tradition historique en nous intéressant profondément, en Allemagne, aux questions ayant trait aux rapports de l'homme et de l'eau. La seule différence avec les temps anciens, c'est que nous disposons de moyens plus puissants. Ce ne sont plus, en effet, des individus ou des groupes d'intéressés qui étudient ces questions, c'est l'Etat lui-même qui a reconnu la nécessité d'une application systématique des découvertes modernes dans ce domaine de l'économie. On trouve encore de l'énergie hydraulique inutilisée, d'énormes quantités d'eau s'écoulent toujours à la mer sans avoir profité à l'agriculture et aux transports. Toutefois, la nécessité de les utiliser a été reconnue et nous connaissons aussi les voies à suivre pour mener rapidement à bien cette oeuvre pacifique, dans l'intérêt de l'individu et du peuple entier.
Ces quelques lignes font ressortir tous les éléments du problème de l'eau tel qu'il se pose en Allemagne et expriment, en outre, la façon dont il y est posé. L'accent est porté avant tout sur les rapports de l'homme et de l'eau, préoccupation de nature sociale qui sera la caractéristique principale de l'ensemble de la participation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce point dans les conclusions de ce chapitre.
Rappelons que la Section allemande était dirigée par M. le Dr. E. W. Maiwald, Commissaire général du Gouvernement du Reich près l'Exposition et deux Commissaires généraux adjoints: M. l'Oberregierungsrat Knothe et M. le Dr. Keim, attaché d'ambassade. Le directeur de la Section était M. l'architecte E. Walther, et les services techniques avaient à leur tête MM. Professor Fahrenkamp, Dipl.-Ing. Renner, Dipl.-Ing. Pixis, Reichsbaudirektor Voss et Reichsbauassessor Brinkmann.
2. VUE D'ENSEMBLE
L'entrée monumentale du Palais de l'Allemagne donnait accès à un hall d'honneur d'allure majestueuse dont la décoration ne manquait pas d'impressionner le visiteur. Celui-ci était conduit ensuite vers la salle principale d'exposition et commençait sa visite en s'appuyant toujours sur la droite. Dans le fond, il faisait ainsi le tour d'une autre salle s'étendant perpendiculairement à la première. L'ensemble du bâtiment était, en effet, disposé en forme de T et se visitait suivant un circuit continu.
Les stands que l'on traversait, au nombre de vingt-quatre, se rapportaient chacun à une matière différente dont l'objet était soigneusement mis en évidence. L'ordre dans lequel ils se présentaient ne correspondait à aucun classement idéologique. Le but était d'intéresser le visiteur jusqu'au bout, et il fut atteint. Les éléments d'ordre abstrait (cartes, statistiques, notices, etc.) étaient particulièrement bien présentés.
Les matières passées successivement en revue étaient les suivantes
1° L'aménagement des eaux, en général, et les travaux hydrauliques agricoles, en particulier, la pisciculture.
2° Les transports par eau les travaux concernant les voies navigables, leur outillage, les problèmes intéressant la navigation.
3° La construction de machines: moteurs marins, pompes, compresseurs, turbines, appareils de mesure et de contrôle.
4° La métallurgie: possibilités de rendement des métaux, procédés de galvanisation, placage, etc.
5° L'alimentation en eau: le captage, l'épuration, la distribution des eaux.
6° Les eaux usées: leur évacuation, épuration et utilisation.
7° Les eaux minérales les sources, les villes d'eaux, les instituts de balnéothérapie. A cet endroit, se trouvait également une grande carte en relief de l'Europe centrale indiquant les voies navigables existantes ou en construction, les barrages établis dans les vallées et les terrains récupérés au profit de l'agriculture à la suite des travaux hydrauliques effectués depuis 1933.
8° L'industrie chimique: l'imprégnation des bois, la protection des métaux, la fabrication des isolants et ignifuges.
9° La section scientifique: revue saisissante des travaux scientifiques entrepris en rapport avec l'eau.
10° Les instruments de précision, de l'optique et de l'électrotechnique, en liaison directe avec les éléments du stand précédent.
11° Les modèles les plus récents de bateaux et de navires.
12° La section historique de la navigation : modèles de bâtiments anciens, documents, sceaux, livres, tableaux, etc.
13° La bibliothèque technique renfermant une documentation remarquable sur toutes les matières traitées à l'Exposition et surtout sur les progrès de la cartographie.
14° Les villes d'eaux, stations balnéaires et climatiques du pays (ce stand complétait le n° 7 que l'on rencontrait à l'aller).
15° Les installations d'hygiène dans les villes, dans les campagnes et à la mer, dans les habitations, les hôpitaux et les usines.
16° L'éducation professionnelle et la prévoyance sociale: ce qui a été fait pour former et protéger le travailleur.
17° Le sauvetage en mer et sur les voies navigables intérieures: le matériel approprié.
18° Les sports nautiques: les installations, appareils et accessoires.
19° L'industrie textile: les étoffes spéciales en rapport avec l'eau.
20° La construction navale: tous les éléments intervenant dans la construction et l'aménagement du navire.
21° Les constructions du génie civil: le bâtiment et les ouvrages hydrauliques.
22° Les installations de l'industrie hydro-électrique.
23° Les travaux exécutés sur les cotes.
24° La pêche en haute mer: le matériel et les installations.
A côté du palais, se trouvait une vaste exposition en plein air de matériel de chantiers de travaux publics, dont notamment une puissante pelle mécanique montée sur chenilles. En outre, dans un petit pavillon spécial, était présentée la maquette d'une région fluviale montrant les divers phénomènes de l'aménagement des eaux.
De plus, quelques exposants présentaient, dans certains palais de la Section belge, des objets de complément: il s'agissait entre autres de matériel non fabriqué en Belgique servant à effectuer des démonstrations, et aussi d'objets rassemblés dans la Section historique de l'adduction des eaux.
Enfin, pour que l'aperçu sur l'ensemble de la participation de l'Allemagne soit complet, il faut signaler que ce pays prit une part importante à toutes les manifestations à caractère international qui se déroulèrent à l'Exposition: congrès et conférences, salons d'art, concours et fêtes, épreuves sportives. Nous reviendrons sur ces différentes collaborations dans les chapitres spéciaux s'y rapportant. La description qui suit concerne exclusivement la Section allemande proprement dite, soit tout ce qui se trouvait dans le palais officiel et aux abords, de même que les objets disséminés dans la Section belge. Tout cela rentrait dans la Classification générale de l'Exposition, et c'est l'ordre des classes qui sera suivi au cours de cette analyse.
3. ANALYSE
La première section que nous avons à examiner était peut-être la plus remarquable de la participation: c'est la SECTION SCIENTIFIQUE (stand n° 9). Elle occupait, avec la SECTION DES APPAREILS ET DES INSTRUMENTS DE PRECISION ET DE L'OPTIQUE (stand n° 10), toute l'aile droite de la halle transversale. L'ensemble ressortissait aux classes 1, 2 et 3 de la Classification générale.
A la classe 1, les quatre branches biologie, physique, chimie et hygiène, étaient traitées. De grands tableaux illustrés et des préparations en bocaux figuraient les résultats de l'analyse biologique de l'eau et les recherches concernant les saprobies, organismes végétaux et animaux qui se trouvent dans l'eau. La marche de ces recherches pouvait d'ailleurs être suivie dans des laboratoires avoisinants, au moyen de nombreux appareils modernes. Une sous-section était consacrée aux méthodes de recherches quantitatives de la vie animale au fond de la mer du Nord. On voyait également l'installation complète d'un laboratoire pour l'étude du plancton à bord d'un navire spécial, et les résultats obtenus.
Les sections de physique et de chimie pures présentaient, outre de nombreux appareils en série, deux intéressants modèles d'une molécule d'eau en bois et en verre, montrant la position de l'atome d'oxygène par rapport aux deux atomes d'hydrogène. En outre, l'Institut allemand de Physique technique exposait un certain nombre de ses propres appareils pour déterminer la pureté de l'eau, la chaleur de vaporisation et la pression de saturation de l'eau. Ce stand était complété par des reproductions des tables internationales de la vapeur d'eau et le diagramme i-x de Mollier qui a trouvé application dans tous les calculs de thermodynamique pour les machines à vapeur.
A la classe 2, les matières suivantes étaient particulièrement développées: la physique des courants, les constructions navales, hydrauliques et terrestres, l'hydrographie, l'hydrométrie.
La physique des courants était représentée par de nombreux appareils en fonctionnement, la plupart mis au point, ou même construits, dans les hautes écoles du pays. Les constructions navales, par des expériences relatives à la traction sur amarres, aux effets de propulsion de l'hélice et de ses rotations, etc. Les constructions hydrauliques, par une documentation abondante et variée qui intéressait d'ailleurs aussi les classes 4 et suivantes. Enfin, les constructions terrestres étaient figurées par la maquette d'une digue élevée sur sol marécageux, par plusieurs appareils pour déterminer le tassement des sols marécageux et du limon putrescent, la vitesse de décomposition des sols consistants, etc.
Le stand de l'hydrographie réunissait de nombreux et précieux appareils de mesure du niveau d'eau et de l'écoulement. De plus, des cartes synoptiques indiquaient les travaux de nivellement effectués sur les cours d'eau, ainsi que la répartition des précipitations atmosphériques dans le pays.
Outre de nombreux éléments communs aux classes précédentes, ressortissait particulièrement à la classe 3, le stand de l'océanographie. Des photographies reproduisaient la machine à calculer les marées de Wilhelmshaven. Des marégraphes, des instruments enregistrant les courants, l'atlas Echolot, une station fluviométrique avec appareil enregistreur électrique à distance et des cartes, complétaient cette section.
L'ensemble, qui serait digne d'être décrit dans un volume important, comprenait donc deux grandes catégories d'exposants: les institutions scientifiques, toutes à caractère public, qui présentaient, soit des travaux de laboratoire, soit des appareils spéciaux construits par elles-mêmes, et des firmes privées qui exposaient du matériel scientifique dont, par exemple, des instruments d'optique. Toute la participation était de premier ordre. Le Jury international des Récompenses lui décerna d'ailleurs 88 % de récompenses de premières catégories. Ce pourcentage fut respectivement de 97 et de 77 pour les institutions scientifiques et les exposants privés.
L'ordre de la Classification générale nous amène ensuite à décrire la SECTION DES EAUX MINÉRALES à laquelle il avait été donné une certaine ampleur par le fait qu'un vaste comptoir de dégustation des eaux du pays y était aménagé. Les principales sources y étaient représentées. En outre, de nombreux éléments graphiques, disposés sur les parois, rappelaient l'activité des instituts de balnéothérapie dont nous dirons quelques mots.
Le pouvoir curatif des sources et des terres fangeuses est connu empiriquement depuis les temps les plus reculés. Ces dernières années, cependant, la balnéothérapie a quitté le domaine de l'empirisme et la science moderne lui a fourni des bases solides, à la suite d'expériences cliniques approfondies.
Le problème était important pour l'Allemagne. Certaines de ses villes d'eaux étaient déjà connues du temps des Romains, et on sait le nombre et la valeur de ses sources minérales et thermales actuellement exploitées. Aussi y voit-on les recherches balnéothérapiques poursuivies par des instituts spéciaux installés dans plus de vingt stations thermales. La centralisation des études est assurée par un institut national dont le siège est à Breslau. C'est celui-ci qui donne l'impulsion à l'ensemble des recherches scientifiques entreprises sur la matière, et cette organisation a réalisé des progrès rapides. Il en est résulté, par voie de conséquence, un essor considérable des villes d'eaux et des stations climatiques du pays.
La participation aux CLASSES 4 (RIVIÈRES ET CANAUX) ET 5 (FLEUVES A MAREE ET MERS) était très importante également. Elle comprenait, en effet, un effectif de 92 exposants, soit environ 14 % du nombre total d'exposants allemands. Elle occupait les stands n° 1, 2 et 21, ainsi que le petit pavillon annexe dont nous avons déjà fait mention.
On y voyait des plans d'ensemble de canaux achevés ou en construction, des modèles de barrages, de réservoirs, d'écluses, d'ascenseurs de différents types, les constructions spéciales de têtes d'écluses, de sas, de vannes, les constructions de ponts, etc. Il s'agissait autant de travaux exécutés en Allemagne qu'à l'étranger, et notamment en Belgique. C'est ainsi, par exemple, qu'une firme exposait (dans le Palais belge du Génie Civil) le diorama de la partie d'un secteur du Canal Albert construite par elle.
Plus spécialement pour la classe 5, en plus d'appareils scientifiques du domaine de l'océanographie, déjà cités à propos de la classe 3, figuraient des documents et objets ayant trait à des travaux de correction de rivières à marée, à des travaux d'endiguement et de dragages, à l'éclairage et au balisage des côtes.
Dans ces deux classes, bien que la participation des services officiels (toutes les directions des voies hydrauliques, par exemple) fût importante, les exposants privés l'emportaient en nombre (53 contre 39). La proportion de récompenses de premières catégories obtenues au Jury prouve que la participation était de premier ordre.
D'ailleurs, dans le domaine de l'aménagement des voies d'eau, un effort considérable avait été fait en Allemagne au cours de ces dernières années. Il n'y eut donc aucune surprise à trouver, à l'Exposition, une documentation abondante mettant en relief les caractéristiques principales des ouvrages réalisés ou en voie de réalisation, avec l'indication des problèmes techniques particuliers résolus ou à résoudre.
Parmi les grands travaux dont il était fait état, il faut citer la canalisation du Neckar, le canal Rhin-Mein-Danube, le canal Dortmund-Ems, le Mittellandkanal, le canal Elster-Saale, etc., et les nombreux ouvrages d'art y relatifs. Signalons encore les barrages des vallées de l'Eder et de la Diemel (bassin du Weser), le barrage de Kachlet, sur le Danube (en amont de Passau), le barrage de Bleiloch, sur le cours supérieur de la Saale (bassin de l'Elbe), d'une contenance de 215 millions de mètres cubes, le barrage de la Neisse de Glatz près d'Ottmachau (bassin de l'Oder), l'écluse Hindenburg de 15 mètres de chute, sur le Mittellandkanal; l'ascenseur de Niederfinow rachetant une dénivellation de 36 mètres, etc.
Les CLASSES 6 (PORTS INTERIEURS), 7 (PORTS MARITIMES) ET 8 (PORTS DE PÊCHE) n'étaient pas représentées avec la même importance.
On trouvait cependant des documents intéressants relatifs au port de Duisbourg, à la construction d'un môle dans la mer du Nord, des plans d'un port de pêche dans la mer du Nord et d'un autre dans la Baltique. Quelques firmes exposaient du matériel approprié.
Par contre, un effort extraordinaire avait été fait à la CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX). C'est dans cette classe que l'Allemagne compta le plus d'exposants, soit 104 ou 16 % du total. Les stands portaient les numéros 1, 5 et 15.
Rappelons tout d'abord que l'Allemagne avait prêté quelques éléments de valeur à la Rétrospective de l'adduction des eaux, installée dans les palais belges et dont nous avons parlé dans la première partie de ce rapport.
En ce qui concerne l'aspect actuel des activités ressortissant à la classe 9, il était présenté à la fois une étude approfondie des problèmes de captage et de distribution d'eau dans leur ensemble, et au point de vue agricole en particulier. Ces recherches étaient illustrées par une collection complète de produits et de travaux industriels.
Les problèmes généraux d'alimentation en eau potable et industrielle étaient rappelés par des modèles d'installations de captage des sources et des nappes souterraines, d'installations de distribution aux usagers, de châteaux d'eau, etc. De grandes cartes renseignaient sur l'aménagement des eaux dans les contrées industrielles et sur les mesures prises à Berlin, à la suite de transformations de la ville.
La question de l'eau dans l'agriculture retenait particulièrement l'attention. On faisait état de travaux de protection contre les inondations, d'assèchement de terrains marécageux (marais de l'Oder), d'endiguement des rivières. L'irrigation des terrains trop secs, de même que le drainage des terres trop humides, étaient traités par des exemples suggestifs. On ne manquait pas de signaler les résultats importants obtenus depuis quelques années dans ce domaine. Enfin, l'accent était porté sur l'importance de la question de l'eau dans les communes rurales en vue d'améliorer les conditions d'existence à la campagne et d'enrayer ainsi l'exode vers les villes.
Quant à l'évacuation des eaux usées, elle était surtout envisagée au point de vue de leur utilisation notamment dans l'agriculture, comme nous le verrons plus loin.
Les autres questions du problème de l'eau urbaine et rurale, les installations sanitaires et d'hygiène, auxquelles on attache de plus en plus d'intérêt, ne manquaient pas d'être développées avec soin. A titre indicatif, un stand renfermait des modèles des différents types d'installations de bassins de natation et de piscines étudiés respectivement pour le petit village, pour la commune d'importance moyenne et pour la ville. Plus loin, le problème de l'emploi de l'eau dans le ménage faisait l'objet de démonstrations très suggestives.
Faut-il dire que ces stands ne contenaient pas seulement des éléments d'ordre abstrait, mais que de nombreux industriels y exposaient, souvent en grandeur d'exécution, une foule d'objets caractéristiques? On trouvait tous les genres de conduites d'eau avec leurs accessoires, tous les appareils et tous les systèmes d'installations sanitaires et de distribution domestique, des appareils de mesure et de contrôle, des tuyauteries, etc. Le matériel d'incendie, qui ressortissait à la deuxième section de la classe 9, était également représenté.
Dans l'ensemble, les exposants allemands de la classe 9 obtinrent au Jury 80 % de hautes récompenses, ce qui prouve la qualité des objets exposés.
C'est dans les stands n° 5 et 6 que l'on découvrait les matières de la CLASSE 10 (EPURATION DES EAUX).
Au moyen d'exemples soigneusement choisis, on montrait comment on obtient une eau irréprochable du point de vue hygiénique, comment on améliore une eau dont on n'est pas sûr, en la filtrant, en détruisant les germes pathogènes, comment on en fait disparaître les éléments superflus (manganèse, acide carbonique), comment on abaisse la teneur en calcium ou on la débarrasse des matières organiques, comment on lui enlève certaines propriétés nuisibles aux matières industrielles, etc.
On trouvait une série d'installations et d'appareils pour améliorer l'eau, soit celle destinée aux usages domestiques, soit celle utilisée dans les industries.
On avait tenu à faire ressortir l'effort collectif réalisé par les nombreuses sociétés constituées en vue d'assurer la fourniture d'une quantité suffisante d'eau pure et de recueillir les eaux industrielles nuisibles. En ce qui concerne les eaux usées, une maquette représentait la plus grande installation d'utilisation des eaux d'égouts, en voie d'achèvement à Hambourg, dont l'épandage s'étendra sur 23.000 hectares. Ces eaux seront utilisées pour l'irrigation et la fertilisation des terres de culture.
Au point de vue scientifique et technique, la participation allemande à la classe 10 fut tout à fait remarquable. C'est dans cette classe que le Jury a décerné aux exposants allemands le plus de récompenses supérieures (95 %).
Relativement à la CLASSE 11 (MOTEURS ET MACHINES HYDRAULIQUES), le stand n° 3 comprenait les différents types de pompes dont le haut degré d'efficacité et le caractère économique étaient démontrés pratiquement. Des coupes de compresseurs et de pompes permettaient de reconnaître la haute précision des machines les plus robustes. On remarquait, en outre, l'installation d'une turbine Kaplan et le modèle d'une aube de la roue mobile de la plus puissante turbine à action du monde (85.000 CV.).
Peu de documents se rapportaient à la CLASSE 12 (CENTRALES HYDRAULIQUES ET HYDRO-ÉLECTRIQUES). Signalons cependant qu'une société importante présentait un modèle de génératrice hydro-électrique.
Par contre, la CLASSE 13 (TECHNIQUE DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ) comptait une vingtaine d'exposants. Ils ne constituaient pas une section spéciale, mais étaient répartis dans tout le palais, suivant la spécialité à laquelle se référait l'application électrique étudiée.
Quant à la CLASSE 14 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS DE L'INDUSTRIE DU FROID), on aurait pu s'attendre à une participation plus copieuse de la part de l'Allemagne. Citons simplement la maquette d'une patinoire artificielle, les autres objets étaient de moindre intérêt.
Dans la CLASSE 15 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS METTANT EN RELIEF LE ROLE TECHNIQUE SPÉCIAL DE L'EAU DANS L'INDUSTRIE), la participation fut inexistante, en fait.
Par contre, en ce qui concerne la CLASSE 16 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS DE RECHERCHES, D'EXÉCUTION ET DE RÉALISATION DES OUVRAGES REPRIS AUX CLASSES PRÉCÉDENTES), un effort considérable avait été accompli, surtout au sujet du matériel de chantiers.
Dans le domaine des conceptions scientifiques, recherches et essais, quelques éléments intéressants d'études de matériaux ou de procédés de construction, étaient présentés.
En fait de matières et matériaux, le stand n° 4 démontrait le haut rendement de certains métaux, notamment des aciers spéciaux. S'y trouvaient aussi des applications de protection des métaux procédés de galvanisation, placage, etc. Dans le même ordre d'idées, le stand n° 8, consacré à l'industrie chimique, renseignait sur les procédés d'imprégnation des bois, de protection des métaux contre la rouille, le gel et l'eau, ainsi que sur la fabrication des isolants et des ignifuges.
Mais, disions-nous, l'effort avait porté principalement sur le matériel destiné aux chantiers de travaux publics. Une vaste exposition en avait été faite en plein air, à côté du palais officiel. Une puissante pelle mécanique d'une capacité de 3 mètres cubes, montée sur chenilles, dominait l'ensemble. En outre, on voyait des dragues, compresseurs, grues, etc.
Signalons, pour terminer, qu'aucun exposant allemand n'était inscrit à la 4 section de la classe 16, section réservée aux entrepreneurs de travaux de tout genre.
Le groupe C de la Classification générale intitulé « Navigation » et comprenant les classes 17, 18 et 19 était brillamment représenté.
En commun pour les CLASSES 17 (NAVIGATION INTÉRIEURE) ET 18 (NAVIGATION MARITIME), était organisée une fort belle exposition des services de sauvetage en mer et sur les voies intérieures, avec tout le matériel approprié (stand n° 17).
En commun pour les trois classes dont les deux premières déjà citées et la CLASSE 19 (CONSTRUCTIONS NAVALES), figurait une brillante section historique (stands 11, 12 et 13) : modèles d'anciens navires et bateaux, sceaux, livres, tableaux, documents divers, renseignaient le visiteur sur l'histoire de la navigation et des constructions navales. La bibliothèque technique faisait ressortir les résultats obtenus dans le domaine de la cartographie, et spécialement dans la confection des cartes nautiques.
Rappelons que le stand n 2, dont nous avons déjà parlé à propos des travaux du génie civil, présentait les mesures prises pour assurer la sécurité de la navigation sur les voies intérieures et en mer, ainsi que les questions de droit concernant la navigation fluviale et maritime.
Enfin, le stand n° 20 était consacré uniquement au domaine de la construction navale. A côté de bateaux spéciaux, de démarreurs, d'installations pour aviron, de porte-gouvernail, de projecteurs, de bouées lumineuses, figuraient des appareils de mesure et de contrôle, des feux à éclipse, des constructions spéciales de parois, portes, escaliers, fenêtres, des installations de radiogoniométrie, de postes émetteurs, et de téléphone. On y voyait aussi différents types de câbles sous-marins, des couteaux spéciaux pour travailler des plaques de blindage, qui voisinaient avec des pièces de machines, outils, dragues en aciers résistant à la corrosion, etc.
Les CLASSES 20 (PECHE MARITIME ET D'EAU DOUCE) ET 21 (AQUICULTURE) étaient également bien représentées.
Le stand n° 24 était entièrement consacré à la pêche en haute mer. On sait que, ces dernières années, la pêche maritime s'est fort développée en Allemagne: la flotte a été améliorée et augmentée, et de nouvelles pêcheries ont été aménagées. Le stand montrait des projets d'installation de ports de pêche, un modèle de chalutier à vapeur moderne, les moyens de transport, soit du poisson vivant, soit, par isolement, du poisson frais, de la côte aux régions les plus éloignées. En 1938, la pêche maritime a assuré une production de plus de 7 millions de quintaux métriques de poisson, pour une valeur de plus de 100 millions de Rm. La consommation annuelle par tête s'est élevée dans le pays à 12,4 kilos (contre 5 kilos en 1913).
La pêche fluviale a également pris une grande extension. Son rendement est extrêmement élevé et tend encore à s'accroître dans les lacs et étangs. La pêche industrielle porte actuellement sur 1,25 million d'hectares. Elle assure une production annuelle atteignant 150 millions de kilos représentant une valeur de plus de 100 millions de Rm.
C'est dans le stand n° 1 que le haut niveau atteint par la pisciculture était développé. Les principales espèces de poissons étaient présentées. Figurait aussi une installation conçue pour lutter contre le plus grand ennemi du poisson: la dromie (petit crabe velu). Enfin, des machines empêchant l'envasement et une échelle à poissons permettant au poisson en migration de franchir une hauteur de 4 m 30, donnaient un aperçu des travaux accomplis pour protéger et favoriser la multiplication du poisson dans les eaux fluviales.
En ce qui concerne les CLASSES 22 et 23 (LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE DE L'EAU DANS LES PAYS TROPICAUX ET AUX COLONIES), un seul exposant présentait la construction d'un port dans un pays tropical.
Par contre, dans la CLASSE 24 (ÉCONOMIE SOCIALE), l'Allemagne avait fait une effort remarquable. C'était le thème « L'eau source de santé » qui dominait. Il avait été fait appel aux formules de présentation les plus originales pour mettre en valeur les installations réalisées ou en voie de réalisation dans ce domaine. Nous avons déjà parlé de ces éléments à propos des stands 14 et 15. Nous n'avons toutefois pas encore eu l'occasion de dire que la section comprenait une installation complète d'hydrothérapie pour hôpitaux.
De même, la CLASSE 25 (OEUVRES SOCIALES - DOCUMENTATIONS DIVERSES) avait réuni un nombre d'exposants imposant.
Le stand 16 était consacré à l'éducation et à l'orientation professionnelles, à la prévoyance sociale. Modèles, maquettes, photos, graphiques abondaient pour documenter le visiteur sur toutes les mesures prises pour protéger la santé du travailleur et pour le former.
En outre, cette classe se rapportait aussi à la documentation de toute espèce concernant les matières comprises au Programme de l'Exposition. La bibliothèque technique (stand 13) était largement fournie à ce sujet.
Enfin, dans le domaine de la CLASSE 26 (ORGANISATION DES ENTREPRISES), deux exposants officiels présentaient des éléments intéressant l'organisation modèle d'une entreprise.
Dans la CLASSE 27b (MODES), l'Allemagne montrait quelques produits de la mode dans ses rapports ave l'eau (stand 19).
Dans la CLASSE 27d (MATERIEL SPORTIF), le stand n° 18 faisait une propagande active en faveur des sports nautiques, des modèles d'installations, des pistes de régates, des bateaux et leurs accessoires étaient présentés.
Enfin, la CLASSE 27e (TOURISME) était également traitée avec un certain éclat. Le tourisme en bateau, ses auberges, ses tentes, ainsi que les auberges de la jeunesse au bord de l'eau, étaient exposés au stand des sports nautiques (n° 18).
Faut-il ajouter qu'en fait la propagande touristique était disséminée dans toute la participation, notamment par le soin artistique apporté dans l'exécution des photomontages? A cet égard, les éléments figurant les villes d'eaux, les stations balnéaires et climatiques étaient particulièrement bien étudiés.
4. CONCLUSIONS
A première vue, on serait tenté de penser que la Section allemande comprenait surtout des participations d'organismes officiels et que les exposants privés n'y intervenaient qu'à titre accessoire, pour compléter ou illustrer certaines démonstrations. Ce n'était cependant pas le cas. Un examen rapide des tableaux de statistiques figurant à la fin du chapitre nous montre, au contraire, que le nombre d'exposants privés fut plus du double de celui d'exposants officiels.
La discrétion avec laquelle le nom du producteur était renseigné sous chaque objet pouvait donner l'impression, au cours d'une visite un peu hâtive, que toute la participation ne formait qu'une vaste collectivité conçue selon un plan bien défini et dédiée à la Science, à la Technique et à l'Industrie du pays.
Certes, l'ensemble était parfaitement ordonné, et l'unité autant que l'harmonie dans la présentation des moindres objets prouvaient à suffisance que les exposants avaient laissé aux dirigeants de la Section, tout le soin de présenter leurs produits. Le résultat fut des plus heureux. La décoration toute de sobriété, la simplicité et la netteté dans la disposition des vitrines et des tables, contribuaient à créer, à l'intérieur du Palais, une atmosphère de distinction et d'équilibre.
Il va de soi que les objets que les industriels furent admis à faire figurer, avaient été soigneusement sélectionnés. Ce principe est actuellement de pratique courante - surtout pour les grands pays - dans les participations aux expositions organisées à l'étranger. Il est parfaitement justifié.
Le plan d'ensemble qui présida à la conception et à la réalisation de la Section allemande de l'Exposition, était basé sur l'idée fondamentale de l'importance du rôle de l'eau dans la vie propre du pays, en mettant l'accent, chaque fois que possible, sur le profit direct ou indirect qui en résulte pour l'homme, pour sa santé, pour son bien-être.
Il paraît donc normal que les efforts se soient portés principalement sur les matières suivantes:
1° Les sciences (classes 1, 2 et 3);
2° Les travaux du génie civil (surtout les classes 4, 5, 9 et 10);
3° La navigation (classes 17, 18 et 19);
4° Les oeuvres sociales (classes 24 et 25).
Que les travaux scientifiques aient été mis à l'honneur, cela semblera tout à fait naturel étant donné la faveur et les encouragements dont ils ont toujours bénéficié dans le pays.
Quant aux ouvrages hydrauliques du génie civil, ils devaient forcément retenir l'attention parce que la question de l'aménagement des eaux en général présente une importance capitale pour l'Allemagne.
La navigation, matière attrayante pour une exposition, devait naturellement tenter un grand pays de commerce tant intérieur, qu'extérieur.
Enfin, les oeuvres sociales - ou plutôt les diverses préoccupations d'ordre social - se trouvaient non seulement exprimées par les objets ressortissant particulièrement aux classes 24 et 25, mais étaient mises en relief par bien d'autres manifestations. Les soucis d'hygiène, de santé, de sports, de protection du travailleur, étaient spécialement mis en vue dans presque toutes les parties de la participation, même dans les classes proprement techniques, comme les constructions navales et les ouvrages hydrauliques agricoles.
L'Allemagne aurait pu briller également dans d'autres classes. Certains points du Programme ne furent pas traités dans sa participation. Le cas le plus caractéristique est celui de la classe 15 dans laquelle elle aurait pu développer des thèmes techniques de grand intérêt. Cela aurait permis une utile confrontation avec d'autres sections nationales, notamment la Section belge, dans laquelle la classe 15, pour reprendre l'exemple cité, fit l'objet d'un effort très méritoire de la part de nos industriels.
Nous insérons à la suite un tableau statistique donnant l'état détaillé des récompenses décernées par le Jury international aux exposants allemands. Ce document se passe de commentaires: les chiffres sont suffisamment éloquents et prouvent la qualité exceptionnelle des produits exposés.
Faisons simplement ressortir ici que, pour l'ensemble des classes, les exposants officiels (colonnes O) se sont vu décerner 84 % de récompenses de premières catégories, et les exposants privés (colonnes P), 78 %. En totalisant ces deux catégories d'exposants (colonnes T), le pourcentage général de hautes récompenses s'élève à 80.
Le Jury a également attribué des récompenses à un certain nombre de collaborateurs d'exposants. Ces distinctions, au nombre de 248, se répartissent comme suit 27 Grands Prix, 96 Diplômes d'Honneur, 112 Médailles d'Or, 12 Médailles d'Argent et 1 Diplôme Spécial.
CHAPITRE II
L'ÉGYPTE
Au Palais International n° 22 situé à gauche de l'entrée principale de Bressoux, sur la rive droite de la Meuse, une surface de 200 m2 avait été réservée à la participation officielle de l'Egypte. Elle était constituée par un ensemble de tableaux et maquettes relatifs aux aménagements du Nil en vue de l'irrigation des terres de culture.
L'Egypte est un don du Nil, disaient les Anciens.
En effet, le pays apparaît comme une large vallée au milieu de laquelle coule le Nil qui la féconde par ses inondations régulières, après l'avoir formée par ses alluvions. Il s'est créé ainsi une vaste oasis longue de plus de 1.000 kilomètres, large seulement de 15 kilomètres en moyenne. Les pluies sont si rares en Egypte, que l'agriculture y est entièrement assujettie à l'eau du fleuve.
Dans le passé, on avait recours uniquement au système d'irrigation par bassins. Les terres soumises à ce système ne rendent annuellement qu'une seule récolte. C'est encore le cas actuellement dans certaines régions de la Haute-Egypte où l'irrigation pérenne, de plus en plus généralisée, n'est pas encore pratiquée.
L'application du système d'irrigation pérenne exigea la construction d'une série d'ouvrages destinés à régulariser le débit du fleuve. Elle s'étend actuellement sur plus de 18.000 kilomètres carrés, soit environ 87 % des terres cultivées, et assure une exploitation intensive, notamment en ce qui concerne la culture du coton.
Il était normal que la participation égyptienne à l'Exposition de Liège 1939 fût consacrée exclusivement aux travaux entrepris sur le Nil, en vue de l'aménagement des eaux pour l'agriculture.
Une pièce remarquable du stand était la maquette à grande échelle du barrage d'Assouan, érigé en 1902. La disposition ingénieuse des divers éléments du modèle permettait de se rendre compte des modifications apportées à l'ouvrage en 1912 et en 1933, de manière à en augmenter la capacité. Celle-ci fut ainsi portée à 5.500 millions de mètres cubes.
Les travaux d'irrigation de la Basse-Egypte étaient évoqués par une autre grande maquette du barrage du Delta. Cet ouvrage déjà ancien - il fut achevé en 1861 - a lui aussi subi de nombreux aménagements destinés à augmenter son rendement. Ces divers stades étaient également figurés avec précision sur la maquette.
La reproduction du barrage éclusé d'Esna (Haute-Egypte) et celle d'un barrage régulateur sur le Canal Ibrahimieh complétaient l'ensemble. Toutes ces maquettes, exécutées en marqueterie de bois durs polis, étaient à la fois d'une grande précision technique et d'un goût parfait de présentation.
Deux grandes cartes d'Egypte reproduisant essentiellement la vallée du Nil et les barrages, et une série d'agrandissements photographiques montrant l'état d'avancement du nouveau barrage du Delta, étaient également exposées.
Comme il faut que l'irrigation soit effectuée avec régularité, le débit de l'eau prélevée aux ouvrages doit être parfaitement contrôlé. La participation nous montrait la maquette d'une vanne-déversoir réglable ainsi que celle d'une machine enregistreuse de débit d'un fonctionnement très ingénieux.
A titre historique, était présentée une collection de modèles anciens: shadouf-seau, vis d'Archimède simple et double, ainsi qu'une roue élévatrice mue par des boeufs, finement réalisée.
Bien que limitée, la participation égyptienne présentait le plus vif intérêt. Elle répondait parfaitement au Programme de l'Exposition. Elle était officiellement représentée par S. E. Kamel Ghaleb Bey, sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics d'Egypte, par S. E. Abdel-Khalek Saber Bey, sous-secrétaire adjoint audit ministère et par le Docteur Hassan Zaky, inspecteur général du Nil, Commissaire général près l'Exposition.
Le Jury international des Récompenses accorda au Ministère des Travaux publics d'Egypte, le Grand Prix dans les classes 4 et 9VI, auxquelles la participation ressortissait principalement, et le Diplôme d'Honneur dans la classe 12 qui ne concernait qu'accessoirement les objets présentés.
CHAPITRE III
LA FRANCE

1. INTRODUCTION
Il revient à la France l'honneur d'avoir été le premier pays à répondre à l'invitation du Gouvernement belge à participer à l'Exposition internationale de Liège 1939. Cet empressement lui valut l'avantage de pouvoir se réserver une place privilégiée pour l'édification des palais qui allaient porter, pendant de longs mois, son pavillon tricolore sur les rives majestueuses de la Meuse.
La Section française se composait de trois grands bâtiments alignés bout à bout, sur la rive droite de la Meuse et parallèlement à celle-ci, reliés entre eux par des galeries couvertes. En y comprenant les rotondes, les galeries aux étages et le restaurant, elle développait une surface brute de plus de 10.000 mètres carrés. Côté fleuve, dans la même ligne que les Palais belges de la Mer, du Génie Civil et de la Navigation Intérieure, les trois palais français formaient fond à la grande esplanade dont les gradins s'appuyaient à leur base. Quant aux grandes façades postérieures, elles donnaient sur le prestigieux jardin d'eau. Le dernier bâtiment, à l'aval, s'incurvait dans la direction du fleuve, épousant la courbe majestueuse du grand hémicycle du Lido dont il fermait une des extrémités.
Dans ses grandes lignes, l'architecture rappelait l'allure générale des palais belges environnants. L'utilisation de la même ossature métallique standard y contribuait pour beaucoup. La note caractéristique fut donnée par les grandes verrières qui constituaient les éléments principaux des façades et des rotondes. L'ensemble, tout de simplicité et de clarté, rehaussé de deux grands mâts de marine de 35 mètres de hauteur entre les bâtiments, produisait une impression qui ne manquait ni de grandeur, ni d'élégance.
La Section comprenait essentiellement deux parties bien distinctes: d'une part, la participation des services publics, de loin la plus importante, et d'autre part, celle des firmes privées, organisée par le Comité français des Expositions. Ces deux groupes d'exposants occupaient des emplacements indépendants.
Comme pour la plupart des autres sections nationales, le thème de l'Exposition offrait à la France un vaste champ d'exploration, se prêtant admirablement à des démonstrations de prestige. Les études scientifiques, les captages d'eaux minérales et thermales, les travaux du génie civil, la navigation, la pêche, la mise en valeur des colonies, le tourisme, fournissaient une ample matière pour illustrer les problèmes variés de la technique de l'eau. Nous verrons, dans la suite, comment elle fut développée à l'Exposition.
Le Commissaire général du Gouvernement français était M. Ch. Crescent, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur des Voies navigables et des Ports maritimes au Ministère des Travaux publics de France. Il était assisté de M. Sarrien, consul général de France à Liège, Commissaire général adjoint. L'architecte en chef était M. Louis Allix, S.A.D.G., architecte des Bâtiments civils et des Palais nationaux. La Section industrielle et commerciale était présidée par M. Paul Chaleil, président du Syndicat des Industries mécaniques de France.
2. VUE D'ENSEMBLE
Malgré la distribution de la Section française en trois palais distincts, la matière avait été répartie de telle façon que la visite ne laissait aucune impression de morcellement, ni d'incohésion. Les inconvénients inhérents à l'existence de galeries assez élevées étaient largement compensés par les belles perspectives qu'elles ménageaient tant sur les intérieurs, que vers les jardins et la grande esplanade. Il est à remarquer que par suite de la forte différence de niveau entre le jardin d'eau et l'esplanade, de celle-ci on accédait directement aux galeries des palais, tandis que le rez-de-chaussée se trouvait au niveau du jardin d'eau.
Le Palais central était affecté à l'exposition des travaux publics de tout l'empire français. Quatre grands services publics y avaient collaboré. C'étaient les Ministères des Travaux publics, des Colonies et des Affaires étrangères, ainsi que le Gouvernement général de l'Algérie. Le Palais latéral courbe groupait les participations des Ministères de l'Air, de l'Agriculture, de l'Intérieur, de la Santé publique et des Marines marchande et militaire. En outre, il s'y trouvait des éléments provenant du Musée historique de la Marine et un stand du Centre national d'Expansion du Tourisme, du Thermalisme et du Climatisme. Enfin, le Palais latéral droit abritait la Section industrielle et commerciale réservée aux exposants privés ainsi que la brillante participation de la Ville de Paris. La rotonde et une partie de l'espace adjacent étaient occupées par le restaurant de la Section avec une salle de dégustation des vins.
En commençant la visite par le Palais courbe, on trouvait successivement les stands suivants:
A l'étage
1° L'aéronautique maritime: maquettes animées d'hydravions transatlantiques, base d'hydravions et modèles divers;
2° La marine militaire: essais relatifs à l'hydrodynamique, appareils de bord produisant ou véhiculant l'eau, instruments de navigation, travaux hydrographiques, rétrospective de maquettes de navires de guerre;
3° La marine marchande : maquettes de bateaux, trafic des principaux ports, grandes lignes de navigation, croisières et pêche;
Au rez-de-chaussée
4° L'aéronautique maritime (2e stand) : recherche sur la corrosion, mécanique des fluides, navigation aérienne;
5° L'agriculture : les ressources en eau, expériences sur le débit des sources et des puits, l'eau au village et à la ferme, le drainage, l'irrigation, l'érosion et le reboisement, la pisciculture et la pêche;
6° L'urbanisme, l'hygiène des villes, la santé : protection des sites urbains, alimentation en eau et assainissement, l'eau comme source de santé;
7° Le tourisme: les beautés naturelles et artistiques du pays, la gastronomie et les eaux de source;
8° La marine marchande (2° stand): bassin de port marchand, deux grands dioramas d'ensemble.

Dans le Palais central, on découvrait ensuite:
A l'étage
9° Un grand stand des Travaux publics: la Machine de Marly opposée à une turbine Kaplan moderne, une pompe à déblais, les phares et balises, les ports maritimes (Dunkerque, Boulogne, Calais, Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille), les ports fluviaux (Strasbourg, Bordeaux, Rouen);
Au rez-de-chaussée
10° Les colonies françaises: l'eau dans la nature, l'hydrographie, la météorologie, l'hydraulique, l'irrigation, les forages et adductions d'eau, les ouvrages d'art, les ports maritimes et fluviaux, la navigation fluviale, la pêche;
11° L'Algérie: les eaux souterraines, les distributions d'eau, les grands barrages-réservoirs, l'hydraulique agricole, les ports maritimes, les voies de communication avec la métropole, le tourisme;
12° Le Maroc: les barrages-réservoirs et l'électrification, les ports modernes, la pêche fluviale et maritime;
13° La Syrie-Liban: les barrages et l'électrification, l'irrigation;
14° Les travaux publics dans la métropole (2e stand): les grands barrages du Massif Central, des Pyrénées, des Vosges et des Alpes; les divers modes de traction dans la navigation intérieure, les efforts des lames et les effets de la houle, le plan des phares du Finistère.

Enfin, dans le troisième palais, on présentait
A l'étage
15° La Ville de Paris: les eaux de Paris historique), l'alimentation en eau, le contrôle et l'épuration des eaux d'alimentation, la protection contre les inondations, l'assainissement de la ville, son port, ses installations de pisciculture;
Au rez-de-chaussée
16° La Section industrielle et commerciale comprenant les branches ci-après:
a) La construction des barrages et écluses, les travaux hydrauliques;
b) Le matériel de distribution et d'utilisation des eaux;
c) Les appareillages pour l'épuration des eaux;
d) Les turbines hydrauliques et l'industrie hydro-électrique;
e) Les métaux spéciaux, les machines et moteurs;
f) La navigation : matériel et exploitation.
Nous ne pouvons omettre d'ajouter que dans le passage couvert reliant, au niveau du rez-de-chaussée, le Palais courbe au Palais central, était logé un stand important de monnaies et médailles où une presse frappait, sous les yeux des visiteurs et à leur intention, une breloque-souvenir intitulée « La Meuse », oeuvre du médailliste Marcel Renard. Dans la galerie correspondante, entre les deuxième et troisième palais, était installée une belle exposition du livre français les ouvrages de vulgarisation, les revues techniques y voisinaient avec une collection remarquable d'éditions maritimes et géographiques.
La participation de la France ne se limitait pas à ses trois grands palais officiels. Comme beaucoup d'autres nations, elle était brillamment représentée dans les deux Sections internationales des Beaux-Arts (Art ancien et Art moderne). En outre, elle prit une part importante à toutes les manifestations internationales de l'Exposition, comme les congrès et les conférences, les concours et les fêtes.
Enfin, il faut signaler la collaboration capitale que la France a apportée à la Section historique de l'adduction des eaux, organisée dans les palais belges. Par le prêt d'éléments historiques de la plus grande valeur, par le concours éclairé de bon nombre de ses spécialistes réputés, elle s'y est fait des titres à notre plus vive reconnaissance.
3. ANALYSE
Dans le domaine scientifique, faisant l'objet des CLASSES 1, 2 ET 3, la participation française comprenait quelques éléments de valeur dans les stands de l'aéronautique maritime et de la marine militaire. L'attention était attirée en particulier sur les problèmes de mécanique des fluides, présentés par les Instituts de Mécanique des Fluides de Lille, Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse, sur des études relatives à la corrosion des métaux, développées par le Groupement pour le Développement des Recherches aéronautiques, et sur des essais concernant l'hydrodynamique et des travaux hydrographiques, exposés par la marine militaire.
En ce qui concerne les EAUX DE CURE ET DE BOISSON (CLASSE 3, SECTION III), le stand du tourisme renfermait une belle carte de la « France Thermale », rappelant les principales stations du pays réputées pour la qualité de leurs eaux et l'importance de leurs installations thérapeutiques.
Relativement aux TRAVAUX DU GENIE CIVIL, la documentation était beaucoup plus abondante: les matières des classes 4 (rivières et canaux) et 7 (ports maritimes) étaient particulièrement bien traitées.
Les objets ressortissant à la classe 4 se trouvaient dans le grand stand des travaux publics métropolitains et dans ceux consacrés aux territoires coloniaux. On se référait spécialement aux grands travaux d'art hydraulique entrepris, au cours de ces vingt dernières années, soit en vue de la production de l'énergie hydro-électrique, soit pour l'irrigation de certaines terres de culture.
En France, le développement de la production de l'énergie hydro-électrique constitue, depuis quelques années, un point essentiel du programme des grands travaux publics. Le but visé est surtout de réduire les importations de charbon pour lequel le pays est fortement tributaire de l'étranger. Des résultats significatifs ont déjà été obtenus. En 1938, sur une production globale de 19,2 milliards de KWH, la part de l'énergie hydraulique représentait déjà 55 %, contre 40 % de la production totale en 1923. Un vaste programme est encore en cours comportant des travaux dans le Massif Central, dans les Pyrénées et dans la région des Alpes. En fait de construction de barrages, la section de la France métropolitaine pouvait faire état de réalisations tout à fait remarquables, se distinguant autant par l'ampleur des entreprises que par la hardiesse et la nouveauté dans les conceptions.
Pour des travaux analogues, le stand de l'Algérie n'en présentait pas moins d'intérêt. Les grands travaux hydrauliques mis en chantier depuis 1921 y étaient naturellement présentés avec soin. Ici, la production de l'énergie hydro-électrique constitue un but secondaire, car il s'agit surtout de la mise en valeur de grandes surfaces que la nature du climat et le régime irrégulier des cours d'eau rendaient impropres à la culture, par manque d'eau. Le programme comportait la construction de neuf grands barrages dont les caractéristiques sont toutes remarquables, surtout eu égard à la nature du sol. Le plus grand est celui du Ghrib qui forme un réservoir de 280 millions de m3, capacité pouvant même facilement être portée dans l'avenir à 350 millions de m3. Cette réserve d'eau servira à irriguer une étendue de 30.000 hectares dans la grande plaine du Chéliff (département d'Alger). L'ensemble des travaux permettra de constituer une réserve de 700 à 900 millions de m3, susceptible d'assurer l'irrigation de 100.000 à 140000 hectares de bonnes terres!
De leur côté, les exposants privés de la classe 4, au nombre de sept, présentaient de la documentation technique d'un vif intérêt sur les travaux hydrauliques récents, notamment sur la construction des nouveaux barrages et de certaines écluses. Il est à noter que, dans cette classe, tous les exposants français participant à l'attribution des récompenses ont obtenu au moins la Médaille d'Or.
A la classe 7, on notait une participation abondante des ports maritimes français, tant de la métropole que de ceux établis aux colonies.
La France dont environ les deux tiers du commerce extérieur s'effectuent par la voie maritime et qui occupe une situation privilégiée sur les routes transocéaniques, a tenu à maintenir ses installations portuaires à la hauteur du progrès. La participation ne manquait pas d'attirer l'attention sur l'importance du port de Marseille, le premier port maritime français, ainsi que sur les travaux récents effectués au Havre (approfondissement du chenal de navigation, déplacement de la digue sud de l'avant-port), sur l'établissement d'une nouvelle passe à Bordeaux et l'équipement modernisé du port de Dunkerque. Les ports de Calais et de Saint-Nazaire, ce dernier avec la grande forme de radoub destinée au paquebot « Normandie », étaient également représentés.
Dans les territoires d'outre-mer, les travaux portuaires ont aussi été poussés au cours de ces dernières années. Le port de Dakar était bien représenté, de même que Tamatave (Madagascar), Pointe-Noire (A.E.F.), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Djibouti (Somalie).
Un effort avait visiblement été fait dans cette classe où la France compta la moitié du nombre total d'exposants de tous les pays.
Les classes 5 et 6 figuraient plus modestement. A la CLASSE 5 (FLEUVES A MARRE ET MERS), le Service des Phares et Balises exposait du matériel d'éclairage et de balisage des côtes, et trois entreprises privées montraient des travaux hydrauliques.
A la CLASSE 6 (PORTS INTERIEURS), il y avait un ensemble de ports fluviaux de l'Association des grands Ports français et, au stand de la Ville de Paris, des documents concernant le port qui est, comme on sait, le port fluvial le plus important, se classant avant Strasbourg et Rouen.
Enfin, à la CLASSE 8 (PORTS DE PECHE) figurait le port de Boulogne dont les installations complètement transformées et agrandies en ont fait le premier port de pêche du continent.
Dans un autre domaine des travaux du génie civil, la CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX) ne pouvait manquer d'attirer un assez grand nombre d'exposants français.
En matière historique, nous avons déjà signalé la contribution importante de la France à la Section historique de l'adduction des eaux, installée dans les palais belges. En outre, se trouvait au stand de la Ville de Paris, une belle documentation sur la période gallo-romaine, l'île de Lutèce à travers les âges et les problèmes de l'alimentation de la ville en eau jusqu'à nos jours. Une belle reproduction de la Machine de Marly, due au Liégeois Rennequin Sualem, figurait au stand des Travaux publics.
La période contemporaine comprenait notamment une fort belle participation de l'agriculture dans laquelle toutes les questions de la technique de l'eau étaient envisagées: le drainage, l'irrigation, l'érosion, le reboisement, etc.
L'alimentation en eau des villes était traitée au stand général des villes et à celui de la Ville de Paris. Dans la section coloniale, il en était question également à certains endroits, entre autres à l'Algérie.
Quelques industriels exposaient du matériel approprié (tuyauteries, appareils de distribution et d'utilisation des eaux) dans la Section industrielle et commerciale.
Dans le domaine de la CLASSE 10 (EPURATION DES EAUX), on remarquait particulièrement la reproduction de la station d'épuration d'Achères (stand de la Ville de Paris) et un petit ensemble ayant trait à l'assainissement des eaux (stand de l'hygiène). Peu d'exposants privés figuraient dans cette classe.
Par contre, la CLASSE 11 (MOTEURS ET MACHINES HYDRAULIQUES) comprenait assez bien d'exposants privés. Le matériel présentait un réel intérêt, surtout les pompes. Au stand des Travaux publics, se trouvait un modèle de turbine Kaplan.
Aux CLASSES 12 (CENTRALES HYDRAULIQUES ET HYDROÉLECTRIQUES) ET 13 (LA TECHNIQUE DE L'EAU ET L'LECTRICITE), un contingent important d'exposants privés ou mixtes présentaient des éléments de valeur. En plus du matériel hautement perfectionné des centrales électriques et des installations de transport et de distribution de l'énergie, il était fait état de nombreuses réalisations récentes en vue de l'extension des réseaux distributeurs, qui comportent actuellement plus de 11.000 kilomètres de lignes à haute tension, et du développement de la consommation d'électricité principalement dans la sidérurgie, l'électro-chimie et aussi dans les usages domestiques. Le développement remarquable de l'électrification des chemins de fer, qui porte à l'heure actuelle sur environ 3.300 kilomètres de lignes, était également mis en évidence.
Dans la CLASSE 14 (L'INDUSTRIE DU FROID), la Section française n'était pas figurée et, à propos de la CLASSE 15 (L'EAU DANS L'INDUSTRIE), on notait seulement quelques participations dans le domaine de l'électrométallurgie (aluminium, etc.).
A la CLASSE 16 (MATERIEL ET PROCDES DE RECHERCHES, D'EXÉCUTION ET DE REALISATION DES OUVRAGES DU GENIE CIVIL), on découvrait quelques recherches de laboratoires, des études sur des métaux spéciaux, des moteurs et la participation d'entrepreneurs de travaux publics, ces derniers étant inscrits à la quatrième section de la classe.
La participation à la CLASSE 17 (NAVIGATION INTERIEURE) était plus copieuse. Au stand des Travaux publics, étaient figurés notamment les divers modes de traction sur les voies navigables intérieures, domaine dans lequel des progrès récents pouvaient être mis en relief. De nombreuses sociétés de remorquage et de transports fluviaux faisaient ressortir le champ de leur activité et les problèmes de navigation fluviale étaient également assez bien développés dans les stands des possessions d'outre-mer.
D'autre part, par la surface occupée, les CLASSES 18 (NAVIGATION MARITIME) ET 19 (CONSTRUCTIONS NAVALES) formaient un ensemble très impressionnant dans la Section française. Presque tout le Palais courbe, étage compris, leur était réservé. Il y avait là, en effet, deux grands stands de l'aéronautique maritime, deux de la marine marchande et un autre de la marine militaire. Manifestement, la France fit un effort considérable dans ces différents domaines. Le public s'intéressa vivement aux belles maquettes animées des hydravions transatlantiques et, en particulier, de l'hydravion transatlantique stratosphérique. Ces pièces, d'une technique remarquable, constituaient les éléments les plus attractifs de la Section.
D'un autre côté, les principales compagnies de navigation étaient représentées et schématisaient leurs grandes lignes mondiales qui occupent une place enviable dans les transports maritimes. Au stand de la navigation militaire, on découvrait des instruments de navigation, et quelques firmes privées exposaient du matériel de construction navale.
En ce qui concerne les CLASSES 20 ET 21 (PECHE ET AQUICULTURE), les éléments dignes d'intérêts se trouvaient dans les stands de la marine marchande, de l'agriculture, de la Ville de Paris et aux colonies.
L'analyse des matières ressortissant aux classes précédentes nous a déjà conduit souvent à faire allusion aux stands réservés aux territoires d'outre-mer. Ces participations, dans ce qu'elles avaient de particulier à la technique de l'eau dans les pays tropicaux, ressortissaient aux CLASSES 22 ET 23. Tous les aspects de cette technique toute spéciale étaient envisagés. L'accent était naturellement porté sur la construction des grands barrages-réservoirs et l'électrification. Les ports, l'agriculture, la pêche, y faisaient également l'objet d'études bien documentées.
Il y avait quatre grands stands trois respectivement pour l'Algérie, le Maroc et les Etats du Levant sous mandat français, et un quatrième pour les autres territoires. Ils occupaient tout le rez-de-chaussée du Palais central. Leur aménagement, soigneusement étudié, contribuait à rendre l'ambiance des différentes régions représentées.
A la CLASSE 24 (ECONOMIE SOCIALE), figuraient quelques ensembles au stand de l'urbanisme et à celui de la Ville de Paris. La protection des sites urbains traversés par des rivières faisait l'objet d'un stand particulier, et les problèmes d'assainissement des villes étaient envisagés également.
A la CLASSE 25 (DOCUMENTATION - OEUVRES SOCIALES), ressortissait le grand stand de librairie situé dans l'intervalle de deux palais. Cette documentation assez abondante sortait, d'une manière générale, du cadre de la Classification, elle ne manquait cependant pas de valeur scientifique et didactique.
Rien n'était exposé dans la CLASSE 26 (ORGANISATION DES ENTREPRISES) et, en fait de MODES (CLASSE 27b), quelques exposants français était compris dans la Collectivité de la Parfumerie, au Lido.
Pour le MATERIEL SPORTIF (CLASSE 27d), un exposant français de moteurs de bateaux sportifs exposait dans la Section belge, au Palais des Sports. C'est également à cette classe que ressortissait la très belle participation de l'Administration française des Monnaies et Médailles qui alignait une brillante collection de médailles sportives, aux reliefs variés.
Enfin, au TOURISME (CLASSE 27e), un stand d'une certaine ampleur avait été consacré. On y rappelait les principaux monuments historiques de France, et ceux de Paris en particulier, les stations thermales, de même qu'on y faisait une propagande en faveur de la carte touristique. Une carte gastronomique était fort bien mise en évidence. Un effort touristique important avait également été réalisé dans les stands de l'Algérie et du Maroc.
Mais le tourisme était partout dans la Section française. Ici, la photographie technique d'un barrage faisait découvrir une vallée enchanteresse. Là, un château d'eau modèle dominait un paysage plein de charme. Plus loin, la vue d'un port caractéristique était l'occasion de montrer dans le fond, quelque belle cathédrale, ou tel monument classé. Tous les photomontages, tous les dioramas, même les plus techniques, parlaient aux amateurs de voyages et servaient à mettre en valeur les beautés naturelles et artistiques du pays, et l'attrait des paysages coloniaux.
4. CONCLUSIONS
Chemin faisant, nous avons fait ressortir les éléments les plus caractéristiques de la participation française. Le programme de l'Exposition convenait à merveille pour faire valoir l'ampleur des travaux entrepris récemment dans le pays afin de tirer profit de ses importantes disponibilités en énergie hydraulique. On sait que la France occupe dans ce domaine une des premières places parmi les pays d'Europe. De plus, au cours de ces dernières années, le pays a consacré également une part importante de ses ressources à l'expansion économique de ses possessions d'outre-mer, principalement pour y étendre les cultures et développer leurs relations commerciales avec la métropole. Ces réalisations fournissaient des matières qu'il était tout indiqué de mettre en relief à l'Exposition de Liège, puisqu'elles comportent essentiellement des travaux du domaine de l'eau, comme la construction de barrages-réservoirs, l'aménagement de ports de commerce et l'amélioration des conditions de navigation maritime.
Une pareille spécialisation allait forcément amener à des stands dans lesquels les éléments d'ordre abstrait (cartes, dioramas, statistiques, etc.) seraient en majorité par rapport aux objets sensibles, souvent animés, dont le public se montre le plus friand. Ces grands problèmes de la technique hydraulique ne sont pas toujours fort accessibles à la masse, ni faciles à présenter sous une forme qui soit à la fois synthétique et attrayante. On courait le risque d'avoir un ensemble un peu aride, d'un abord quelque peu déconcertant pour le visiteur. Disons tout de suite qu'il n'en fut rien.
La décoration générale, et celle de chaque stand en particulier, avaient été traitées de telle sorte que partout se créait une atmosphère agréable, susceptible d'attirer et de retenir l'attention du visiteur. Tous les murs au-dessus des entrées étaient garnis de grandes fresques décoratives dues aux talents de jeunes élèves de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Les sujets « Les Joies de l'Eau », « L'Eau, Force industrielle », « L'Eau vue par l'Ingénieur », « L'Eau tranquille », « L'Eau en mouvement », « L'Eau dans le Port de mer », « L'Eau dans la Ville », évoquaient avec bonheur les interventions multiples de l'élément liquide dans la vie de l'homme. En outre, pour décorer les stands, les musées français avaient prêté un grand nombre de toiles de peintres réputés ayant choisi l'eau pour sujet.
Que dire ensuite de la note de fraîcheur et de gaieté donnée par les fleurs et les plantes, disposées en grappes touffues dans tous les coins?
Que dire, enfin, de certains stands comme celui de la Ville de Paris, orné dans le fond par un vaste paysage représentant l'Institut, les quais de la Seine avec, en grandeur nature, les boîtes des bouquinistes contenant, outre des spécimens d'éditions rares, des estampes et des bibelots d'art?
L'Art avait envahi les Palais de ses expressions sensibles et coloriées, rehaussant l'ambiance et donnant l'impression la plus favorable pour accueillir le visiteur, l'invité de la France.
Par rapport à la surface occupée, la Section française ne comportait pas un nombre élevé d'exposants. Cela s'explique aisément par le fait que les services publics occupaient de loin les plus grands espaces et que, en général, c'est en favorisant les participations privées qu'un pays parvient à aligner un grand nombre d'exposants. Le tableau inséré à la suite renseigne sur les récompenses que le Jury international a décernées aux exposants français. Les résultats reflètent assez exactement la valeur de la participation. Pour certaines classes, ils trahissent quelques faiblesses qu'il faut imputer probablement au fait que les objets ne furent pas toujours sélectionnés avec le maximum de sévérité. On constatera également que, malgré le nombre relativement peu élevé de ses exposants, la France participa dans toutes les classes du Programme, sauf dans trois seulement. Cela marque une certaine dispersion des efforts pouvant avoir une répercussion sur la qualité des objets, surtout si ceux-ci, comme ce fut le cas à Liège, sont jugés d'un point de vue purement scientifique ou technique. D'autre part, on ne comprend pas pourquoi la France ait négligé certaines classes comme celle des eaux de cure et de boisson dans laquelle il ne lui aurait pas été difficile de briller avec éclat.
Dans l'ensemble, elle se vit décerner 72 % de récompenses de premières catégories. Les exposants d'ordre public, au nombre de 95, obtinrent 83 % de hautes récompenses et ceux d'ordre privé, au nombre de 120, 63 %.
Aux collaborateurs des exposants, le Jury attribua au total 146 récompenses, dont 14 Grands Prix, 44 Diplômes d'Honneur, 50 Médailles d'Or, 28 Médailles d'Argent, 8 Médailles de Bronze et 2 Diplômes spéciaux.
CHAPITRE IV
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1. INTRODUCTION
La série des grands palais industriels belges allant de l'entrée principale de Bressoux vers le Gay Village mosan, était interrompue, à hauteur de la station du téléphérique, par le très attirant Palais du Grand-Duché de Luxembourg. Sa masse elle-même ne heurtait pas l'harmonie de l'ensemble: l'ossature et la construction avaient été établies d'après les mêmes plans que les autres bâtiments. Les travaux en avaient même été exécutés par les soins de la Société coopérative de l'Exposition. Mais les organisateurs de la participation grand-ducale avaient réussi à lui donner un aspect original, par la décoration tant intérieure qu'extérieure. Celle-ci avait été confiée à quelques bons artistes luxembourgeois, sous la direction de l'architecte M. Arthur Thill. A l'extérieur, l'attention était attirée par un grand écusson en ferronnerie d'art et, à l'intérieur, des fresques de valeur représentaient les applications de l'eau dans les industries et dans la vie privée.
Le Palais couvrait une superficie bâtie d'environ 900 mètres carrés. La participation était en fait beaucoup plus étendue car, autour du pavillon, de larges espaces étaient occupés, en plein air, par des exposants. En outre, en face, sur l'esplanade du Lido, se trouvait un vaste restaurant, agréablement aménagé, où les visiteurs pouvaient déguster les spécialités culinaires ainsi que la bière et les vins du pays. Cela ne manquait pas d'ajouter à l'éclat de la participation luxembourgeoise.
Comme on le verra dans la suite, celle-ci fut mieux qu'une représentation officielle. Ce fut une brillante et importante section, abondamment documentée et présentant le plus vif intérêt. L'effort du Luxembourg en vue de donner le plus de relief possible à sa participation à l'Exposition de Liège 1939 est d'autant plus méritoire que le pays n'est pas approprié aux grands travaux d'art hydraulique, thème fondamental de la manifestation.
La participation était dirigée par M. F. Simon, ingénieur en chef au Ministère des Travaux publics luxembourgeois, Commissaire général du Gouvernement. Le Commissaire général adjoint était M. A. Diederich, secrétaire général de la S. A. Minière et Métallurgique de Rodange. M. J. Schroeder, ingénieur des Travaux publics, remplissait les fonctions de Secrétaire général.
2. VUE D'ENSEMBLE
Le Palais comprenait deux parties distinctes se détachant d'ailleurs sur la façade principale une section technico-scientifique et une section industrielle. L'entrée se faisait par un hall d'honneur, richement décoré, dont les espaces étaient réservés à la première section constituée par les participations des Administrations publiques de l'Etat ainsi que des Communes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette.
Au centre, une carte topographique en relief montrait l'approvisionnement en eau du pays. Elle permettait de se faire une idée de l'étendue des différentes conduites d'eau et des difficultés de terrain rencontrées dans la pose de ces conduites.
L'Administration des Travaux publics présentait ensuite la réalisation d'un captage avec puits dans la vallée de la Moselle et celle d'une station élévatoire de relai dans un réseau local existant. Ces deux études étaient remarquables par plusieurs applications mécaniques inédites et ingénieuses. Le Service géologique de cette administration exposait des coupes géologiques en rapport avec la formation des sources.
Dans un stand voisin, les deux Syndicats de distribution d'eau du pays, celui du nord et celui du sud, faisaient ressortir toute l'importance de leurs installations d'un intérêt intercommunal et intercantonal. Cette participation complétait tout naturellement la carte topographique déjà citée.
Le Service agricole montrait des réalisations dans le domaine des drainages, des régularisations de cours d'eau et des canalisations de cours d'eau au passage des localités, tandis que l'Administration des Eaux et Forêts attirait l'attention sur des dispositifs de capture de poissons, ainsi que sur des statistiques relatives à la pisciculture.
Cet ensemble des administrations centrales était complété par les participations des Villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette. La première, dans un stand particulièrement remarquable, illustrait, au moyen d'un grand tableau lumineux, le chemin parcouru par une eau urbaine, depuis la source jusqu'à son retour au cours d'eau, après avoir servi à tous les usages et après avoir subi un traitement d'épuration. C'est ainsi que, dans son stade final, la maquette représentait la station d'épuration de Beggen.
Quant à la Ville d'Esch, elle faisait état, d'une façon heureuse, de ses efforts dans le domaine de la distribution d'une eau saine et abondante, et dans celui de l'évacuation des eaux usées. Un projet d'établissement de bains était exposé sous forme de maquette.
Signalons encore, dans ce vaste hall, les hautes parois que le Département du Tourisme avait garni de grands tableaux sur toile représentant des vues de la capitale.
Le grand hall qui y faisait suite, sur la droite, était réservé à la deuxième section de la participation luxembourgeoise, c'est-à-dire aux exposants industriels.
En faisant le tour par la droite, on découvrait successivement
- Une grande vanne de 600 mm de diamètre et une presse hydraulique de dimensions appréciables (Fonderie Duchscher et Co),
- Un stand original du Canoë Club de Luxembourg donnant une idée des possibilités des sports nautiques,
- Une représentation, sous la forme d'un grand tableau artistique, de la fabrication de la bière, organisée par la Fédération des Brasseurs,
- Un stand des Eaux minérales d'Echternach;
- Des vitrines contenant des robinets d'un type spécial (Céodeux) et des appareils de mesure (Ateliers de Construction de Diekirch),
- Un stand des Etablissements thermaux de Mondorf exploités en régie par l'Etat;
- Un stand collectif de la Société des Chaux de Contern et de la Société des Ciments luxembourgeois, montrant les rapports de ces industries avec l'eau,
- Un stand réservé aux carreaux céramiques (Cérabati) en application dans le domaine du bâtiment (une cabine de douche était aménagée) ;
- Un emplacement réservé aux ardoisières (Haut-Martelange)
- Une participation de la Société de Radio-diffusion « Radio Luxembourg », avec photos d'appareillage et maquette de la station d'émission.
Signalons aussi qu'il fonctionnait en permanence dans cette salle un bureau de renseignements touristiques avec la collaboration des principaux syndicats d'initiative du pays.
Le centre du hall était occupé par une splendide fontaine lumineuse mettant en valeur toute une gamme de palplanches d'une importante usine métallurgique (Minière et Métallurgique de Rodange). Le mur du fond était garni d'une grande carte du pays reproduisant les cours d'eau avec tout un lot d'industries s'y rattachant, notamment de vieux moulins. Un balcon auquel on accédait de l'extérieur permettait de jouir d'une belle vue d'ensemble du Palais. On y avait installé un beau stand de la Fédération des Comices viticoles.
A l'extérieur, se trouvait une imposante fontaine lumineuse d'une autre grande société métallurgique (A.R.B.E,D.) et servant également à la présentation de palplanches. Cette fontaine placée à gauche du Palais faisait pendant à une autre, en céramique, placée à droite (Cérabati). Une hampe de drapeau, formée par une poutrelle Grey de 16 mètres, constituait une participation caractéristique d'une troisième société métallurgique (Hadir).
Enfin, diverses carrières, ardoisières et fabriques de céramiques avaient contribué à l'ensemble par la fourniture de matériaux servant à l'aménagement des abords du Palais, ainsi qu'au dallage intérieur. Une de ces firmes avait notamment fourni un abreuvoir, modèle Administration des Travaux publics.
3. ANALYSE
Si nous envisageons la participation luxembourgeoise dans l'ordre des matières traitées par la Classification générale de l'Exposition, nous sommes amenés à faire les constatations ci-après.
La CLASSE 3''' (EAUX DE CURE ET DE BOISSON) comportait les participations de l'Etablissement thermal de Mondori-Etat et des Eaux minérales d'Echternach. Deux beaux stands, bien dans la note de l'Exposition, avec photos, reproduction des sources et dégustation des eaux.
Aux CLASSES 4 (RIVIÈRES ET CANAUX) ET 6 (PORTS INTERIEURS), figurait seulement l'Administration des Travaux publics présentant des avant-projets de canaux de navigation Ourthe-Moselle et Moselle-Chiers.
Par contre, à la CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX), les participations, tant officielles que privées, étaient abondantes.
On relevait celles de l'Administration centrale des Travaux publics et des administrations des Villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, du Service agricole de l'Etat, du Service de la carte géologique et des deux Syndicats de conduites d'eau. En outre, quelques exposants privés montraient des objets fort remarqués. Le détail en a été donné plus haut dans cette étude (voir vue d'ensemble). Il convient de constater que cette participation à la classe 9, sans être fort étendue, était cependant à peu près complète. Tout le programme, d'ailleurs très vaste, de cette classe était traité, depuis le captage des sources jusqu'aux accessoires de la distribution et de la consommation d'eau, sans excepter les problèmes particuliers de la technique hydraulique agricole et les installations de bains et piscines.
Dans la CLASSE 10 (ÉPURATION DES EAUX), nous trouvions un seul exposant grand-ducal (R. Loesch) dont le stand se trouvait à la Collectivité belge de la Défense nationale, Il en a été du reste question au cours de l'analyse de la participation belge à cette classe.
A la CLASSE 11 (MOTEURS ET MACHINES HYDRAULIQUES), s'inscrivait un seul exposant présentant la presse hydraulique déjà citée.
A la CLASSE 13 (LA TECHNIQUE DE L'EAU ET L'ELECTRICITE), figurait la Compagnie luxembourgeoise de Radio-diffusion (Radio Luxembourg), mais cette participation était en réalité en marge du programme de l'Exposition. Il n'y avait, en effet, aucun élément relatif aux rapports de l'eau et de l'électricité.
A la CLASSE 15v1 (L'EAU DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES), on notait une belle exposition de la Fédération des Brasseurs, ayant pour objet les diverses phases de la fabrication de la bière. Bien que cette démonstration n'eût pas été faite sous une forme technique, c'était là une des rares participations à la classe considérée qui fût réellement conforme au programme de l'Exposition. Et c'est tout à l'honneur des Brasseurs luxembourgeois dont les produits sont d'ailleurs réputés depuis longtemps.
En plus, il y avait quelques exposants de vins dont une importante collectivité, celle de la Fédération des Comices viticoles.
En ce qui concerne la CLASSE 16'' (MATIÈRES ET MATÉRIAUX), le visiteur trouvait des produits métallurgiques, du ciment, de la chaux, des ardoises et de la céramique. Il est à remarquer que l'on avait eu soin, dans la plupart des cas, de montrer le rôle de l'eau, soit dans la fabrication, soit dans l'utilisation de ces produits.
La CLASSE 16''' (MATERIEL ET OUTILLAGE) comprenait trois belles participations que nous avons déjà soulignées: celles des grandes usines métallurgiques du pays. Deux d'entre elles présentaient des palplanches, la troisième une grande poutrelle Grey.
Dans le domaine des CLASSES 20 ET 21 (PÊCHE ET AQUICULTURE), on enregistrait l'Administration des Eaux et Forêts avec des maquettes de dispositifs de capture de poissons et des statistiques concernant la pisciculture.
A la CLASSE 24 (ECONOMIE SOCIALE), s'inscrivaient l'Administration de la Ville de Luxembourg et celle d'Esch-sur-Alzette.
A la CLASSE 27d (SPORTS), figurait le Canoë Club de Luxembourg.
Enfin, à la CLASSE 27e (TOURISME), ressortissaient la belle participation du Département du Tourisme ainsi qu'une partie du stand de la Ville de Luxembourg. En outre, 13 syndicats d'initiative locaux exposaient également, d'une façon plus modeste.
4. CONCLUSIONS
Il ne peut surprendre personne que la participation luxembourgeoise n'ait pas été complète. Certaines classes du Programme général ne pouvaient manifestement tenter les organisateurs de cette section. Il en était ainsi, par exemple, des classes scientifiques (1, 2 et 3), de celles concernant les voies de communication par eau (4 à 8), des autres ayant trait à la navigation et aux constructions navales (17, 18 et 19) et des classes coloniales (22 et 23).
L'effort principal de la participation a donc porté sur
a) Les travaux urbains et ruraux (classe 9);
b) Certains produits métallurgiques (palplanches) et du domaine de la construction (céramiques, etc.)
c) Le tourisme.
En outre, mention doit être faite des eaux minérales et thermales, des bières et des vins.
Dans les domaines traités, et qui étaient les seuls que le Luxembourg pouvait aborder dans une compétition internationale de ce genre, les organisateurs ne se sont visiblement ménagé aucun effort et ont réussi à réaliser une représentation bien digne de leur pays. Peut-être, aurait-on pu s'attendre à une participation un peu plus étendue encore du tourisme qui, comme on le sait, constitue une des industries vitales du pays. C'était une matière qu'il eût été facile de développer avec plus d'ampleur: les mystères de quelques belles vallées, qui chaque année attirent une foule de touristes, auraient pu être mieux encore mis en valeur.
Le tableau statistique ci-joint renseigne le nombre de récompenses obtenues par les exposants. On constate que le pourcentage de récompenses de premières catégories s'élève à 88 pour les exposants officiels et à 48 pour les exposants privés. Mais, pour ces derniers, ce pourcentage traduit fort mal la valeur des produits exposés. Cela provient du fait que dans la classe du tourisme (27e), tous les syndicats d'initiative locaux ont été inscrits individuellement. Leur participation était fort modeste et le Jury leur a attribué à chacun seulement la Médaille d'Argent. Leur nombre assez élevé par rapport au chiffre total d'exposants influe fortement sur la moyenne générale. Si l'on excepte la classe 27e, le pourcentage de hautes récompenses décernées aux exposants privés s'élève à 76 au lieu de 48. Cela correspond mieux à la valeur des produits industriels présentés. Ils ne figuraient pas en grand nombre, mais leur qualité était de premier ordre.
Aux collaborateurs des exposants, il a été attribué en outre 37 récompenses dont 2 Grands Prix, 9 Diplômes d'Honneur, 8 Médailles d'Or, 10 Médailles d'Argent, 5 Médailles de Bronze et 3 Diplômes Spéciaux.
CHAPITRE V
LA NORVEGE

Montrer combien le destin des habitants de la Norvège est intimement lié aux choses de la mer et à la force prodigieuse de ses innombrables chutes d'eau: tel était le but primordial de la participation du pays à l'Exposition internationale de Liège 1939. La Section occupait un stand de 400 mètres carrés au Palais international n° 23, situé sur la rive droite de la Meuse, à proximité de l'entrée principale de Bressoux.
Le Commissaire général du Gouvernement norvégien était M. Axel Goemaere, d'Anvers. Il était assisté de M. RoIf Munk, consul de Norvège à Bruxelles, Commissaire général adjoint. Le Comité exécutif de la participation était présidé par M. H. Horn, administrateur-directeur général de la Compagnie norvégienne de Zinc, S.A., à Odda. L'aménagement avait été confié à l'architecte norvégien M. Pran.
Au centre du stand, se déployait en contre-bas une grande carte en relief mesurant 20 mètres sur 8. Elle nous montrait le pays baigné au sud, à l'ouest et au nord par la mer qui pénètre profondément à l'intérieur des terres et forme ces fjords célèbres, aux contours sinueux et d'une rare beauté. Les nombreux ports attestent le développement de la vie maritime. Des navires et des barques de pêche longent les côtes. Aussi, la flotte marchande norvégienne est-elle une des plus importantes du monde, comparativement à la densité de la population.
En s'éloignant de la mer, on atteint peu à peu les régions montagneuses. Les pentes douces des collines, excellentes pour les skieurs, gagnent lentement des sommets de 1.000 à 1.500 mètres. Un réseau important de lignes de chemins de fer couvre les plaines et les versants des monts. Ci et là, on aperçoit les villes et leurs bâtiments caractéristiques tel, par exemple, l'Hôtel de ville d'Oslo. La carte indiquait encore le rôle considérable que jouent, dans l'économie nationale, les industries minières et du bois, les pêcheries et l'agriculture.
Mais ce qui frappait surtout, c'est la puissance énorme de la houille blanche qui alimente en courant électrique les grandes industries. Cette carte en relief donnait ainsi une excellente impression d'ensemble du pays, de ses conditions climatiques et géologiques, de sa production industrielle et de la vie maritime et commerciale.
Autour de la carte qui synthétisait en quelque sorte les intérêts communs des divers exposants, étaient groupés les stands particuliers.
On présentait ainsi la route maritime qui relie la Belgique à la Norvège. Un armement exposait le modèle d'un de ses navires assurant le service hebdomadaire pour passagers et marchandises entre Anvers et Oslo.
Diverses usines montraient des vues de leurs installations, et certaines, des échantillons de leurs produits. On trouvait entre autres du zinc, du ferro-manganèse, du carbure, etc.
Un stand, consacré à l'industrie électrique, était aménagé par l'Union des Usines d'Electricité. A l'aide de cartes, de plans, de tableaux, de schémas et de graphiques, était mise en évidence l'importance des forces hydrauliques dont dispose la Norvège. Elles dépassent de loin celles de tous les autres pays. Elles sont estimées à 13 millions de KW dont à peine 2 millions sont actuellement installés. A mesure que les progrès de la technique rendront plus précieux l'emploi de la houille blanche, ces quantités ne feront qu'augmenter.
Une carte montrait les chutes d'eau d'au moins 2.000 KW et l'énergie récupérée et employée. Les chutes exploitées étaient marquées différemment selon qu'elles appartiennent à l'Etat, aux communes ou aux particuliers. Les chutes non exploitées, ainsi que celles de moindre importance étaient également indiquées. Un grand nombre d'entre elles se trouvent à proximité de ports libres de glaces.
Une autre carte faisait ressortir la progression constante de l'exploitation de la houille blanche, depuis 1908 jusqu'à nos jours. On voyait aussi comment la force électrique de l'eau avait été répartie dans tout le pays au prix de difficultés énormes. D'autres cartes et des statistiques complétaient fort heureusement cet ensemble intéressant.
La participation norvégienne montrait donc d'une façon saisissante comment les grandes entreprises maritimes et industrielles surent créer des conditions avantageuses d'existence à des centaines de milliers d'êtres vivant sur une terre qui n'offrait, par sa nature, que de médiocres ressources.
Aussi la Norvège est-elle un des pays les plus prospères d'Europe. Malgré sa situation septentrionale, elle possède un climat relativement doux. La température moyenne y est fort élevée comparativement à d'autres pays situés sous la même latitude. Il y a une trentaine d'années, la Norvège était encore peu visitée. Aujourd'hui, elle est devenue le lieu de prédilection de milliers de touristes.
Au Jury, furent seulement inscrites, à la classe 13, la Collectivité des industriels exposants et, à la classe 16'', l'Electric Furnace Products Company Ltd, à Sauda (ferro-manganèse). C'est par deux brillants Grands Prix que leurs mérites furent consacrés officiellement.
CHAPITRE VI
LES PAYS-BAS

1. INTRODUCTION
Sur les bords de la rive gauche de la Meuse, à mi-chemin entre le pont de Coronmeuse et l'entrée principale, s'élevait le magnifique Palais des Pays-Bas. D'une superficie bâtie de 950 mètres carrés, il enjambait la grande artère de la rive gauche et, avec l'étage, développait une surface brute d'exposition de 1.200 mètres carrés.
Au-dessus du passage, à l'extérieur, deux cartes géographiques symbolisaient en quelque sorte la participation. L'une représentait les lignes néerlandaises de navigation; l'autre, les voyages d'exploration entrepris par des pionniers néerlandais.
En effet, comme nous le verrons dans la suite, la participation des Pays-Bas était, à peu de chose près, consacrée entièrement à la navigation et à l'aménagement des voies navigables. On sait que, dans ces domaines, le pays n'a cessé de déployer la plus grande activité, tant à notre époque, qu'au cours des siècles passés. Mais l'eau y joue un rôle de premier plan dans toute la vie économique et sociale. C'est tout le commerce, toute l'industrie, toute l'agriculture du pays qui en sont tributaires. Tous ces aspects n'avaient pas été envisagés dans la participation. Plutôt que de disperser leurs efforts, les organisateurs ont tenu, en présentant des éléments soigneusement choisis, à réaliser une manifestation symbolique de ce que le pays est à même de faire en matière d'hydraulique.
La Section avait à sa tête M. J. P. van Vlissingen, directeur général du Rijkswaterstaat, Délégué du Gouvernement. M. H. A. Hooft, chef de la Direction consulaire et commerciale au Ministère des Affaires étrangères, était président du Comité exécutif de la participation dont M. le Dr. H. van Romburgh, conseiller commercial près la Légation des Pays-Bas à Bruxelles, était vice-président. M. le Dr. J. Visser, secrétaire de Légation au Ministère des Affaires étrangères, remplissait les fonctions de secrétaire. L'architecte était M. H. C. Pieck.
2. VUE D'ENSEMBLE
Le rez-de-chaussée du Palais était occupé, en ordre principal, par le Ministère du Waterstaat dont la participation était prépondérante. En particulier, le Service des Travaux du Zuiderzee, qui dépend de ce ministère, y avait un stand séparé. En outre, le rez-de-chaussée abritait le stand du Ministère des Affaires sociales consacré à l'Hygiène publique.
Le long de l'escalier conduisant à l'étage, Dordrecht et Flessingue exposaient quelques photographies.
A l'étage, on découvrait d'abord l'importante exposition du Service des Phares. Les stands d'Amsterdam et de Rotterdam se partageaient les parois latérales, tandis que le centre était occupé par l'Union des Industriels métallurgistes, la Centrale de Dragage, la Province de Limbourg et l'Office national du Tourisme.
La Section néerlandaise ne comptait donc, en fait, qu'une douzaine d'exposants : il est vrai qu'ils étaient d'importance
3. ANALYSE
Voici comment se répartissaient ces exposants, en suivant l'ordre de la Classification générale.
Dans les CLASSES 4 (RIVIÈRES ET CANAUX) ET 5 (FLEUVES A MAREE ET MERS), s'inscrivaient le Ministère du Waterstaat, le Service des Travaux du Zuiderzee et la Centrale de Dragage. Particulièrement dans la classe 4 figuraient également la Fondation « Havenbelangen » de Rotterdam (tunnel sous la Meuse) et l'Union des Industriels métallurgistes (ponts, écluses, etc.). Spécialement à la classe 5 relevait évidemment le Service des Phares.
Le stand du Ministère du Waterstaat (Rijkswaterstaat) occupait une place très importante dans le Palais. La pièce de résistance était constituée par une impressionnante maquette (la plus grande dimension était de 11 mètres) des principales voies navigables des Pays-Bas.
Cette maquette faisait ressortir le réseau des voies navigables dans son aspect nouveau, au moyen de petits bateaux mus à l'électricité. Quelques voies secondaires étaient indiquées aussi, et le tout était illustré par une représentation schématique des ports, des centres d'industrie, des aérodromes, des phares, des bateaux-phares, etc. La maquette portait également les voies navigables qui seront achevées dans un avenir prochain.
La grande artère est la communication de l'ouest à l'est Rotterdam-Lobith, dite Rhin-Waal. La plus fréquentée du monde (en 1937 pas moins de 84 millions de tonnes y passèrent), elle a été améliorée de 1920 à 1925. Des vaisseaux de 4.000 t, avec un tirant d'eau de 3 mètres, peuvent circuler aisément jusqu'à Cologne et plus loin.
La maquette permettait également de se faire une idée des aménagements de la Meuse et comment celleci dessert le bassin houiller du Limbourg méridional. Par le Canal Juliana et la Meuse régularisée, des bateaux de 2.000 t peuvent atteindre le Rhin-Waal en quatre endroits à Nimègue par le Canal Meuse-Waal (1928), à Sint-Andries par le Canal de Sint-Andries (1931), à Gorkum par l'ancienne Meuse barrée et à Moerdijk-Dordrecht par le Kil.
Au nord de la grande artère, le centre industriel de Twente est relié au Rhin-Waal (canaux de Twente, 2.000 t), et un canal d'Amsterdam au Rhin, pour bateaux de 4.000 t, est en construction. La communication entre Amsterdam et Rotterdam par l'IJssel et le Gouwe a été rendue accessible aux bateaux de 2.000 t.
L'extrême nord du pays, centre d'agriculture, d'industrie et de cabotage, sera relié au Rhin-Waal, par Amsterdam et par l'IJssel (de Gueldre), pour bateaux de 2.000 t également.
Cette maquette reproduisait bien l'effort réalisé par les Pays-Bas, au cours de ces dernières années, pour aménager et perfectionner leurs voies d'eau. On sait que ce pays possède le réseau le plus dense de l'Europe et il tient naturellement à le tenir à la hauteur du progrès et des nécessités du trafic.
A côté, une place avait été réservée à une maquette d'un bac roulant transbordeur. Cette nouvelle invention s'emploie maintenant sur le Canal Amsterdam-Rhin. Le service en est simple, rapide et peu coûteux. Le bac peut être arrêté immédiatement en cas de danger et le niveau de la plate-forme est indépendant du niveau de l'eau.
Enfin, la participation du Waterstaat était complétée par une série de photographies des grands ouvrages réalisés par ce département (construction de ponts, d'écluses, etc.). Un vitrail fixé à la paroi du fond du Palais figurait, au moyen de diapositives, les travaux d'assèchement réalisés par des Néerlandais en Europe au cours des siècles, les travaux d'asséchement aux Pays-Bas et plus particulièrement ceux du Zuiderzee.
Le Service des Travaux du Zuiderzee montrait, au moyen d'une carte lumineuse, les diverses étapes de l'asséchement. On pouvait voir également un modèle du moulin à assécher, nouvellement conçu et destiné à Urk, le plan de lotissement du polder nord-est qui va être mis en valeur et un profil transversal de la grande digue de clôture.
Le Service des Phares, qui ressortit au Ministère de la Défense nationale, s'attachait à démontrer les efforts faits, depuis quelques années, pour l'amélioration du balisage lumineux des côtes.
Les premiers pas datent de 1904 et conduisirent à la création, en 1909, d'une station d'essai à Scheveningen, ce qui ouvrit la possibilité de faire des mesurages photométriques et des expériences de toute nature. On mit successivement au point différents types de lampes et, parmi les résultats atteints, on peut citer que le pourcentage des jours d'année où la plupart des grands feux étaient visibles à leur portée géographique a monté de 25 à 40 %, jusqu'à 60 à 80 % actuellement.
Une collection moderne de lampes, lanternes et lentilles était présentée, de même que plusieurs modèles de phares et de bateaux-feux. Au point de vue technique, l'emploi de la T.S.F. était mis en évidence dans les nombreuses applications ayant amené des perfectionnements importants, grâce entre autres aux radiophares, aux postes émetteurs et récepteurs installés à bord des bateaux-feux et des bateaux-pilotes et sur la terre ferme, grâce aussi aux récepteurs de radio pour la radiodiffusion à bord des bateaux-feux.
Enfin, une carte lumineuse du pays donnait l'emplacement des principaux feux d'atterrissage et des radiophares. Actuellement, il y a trois radiophares qui fonctionnent sur les bateaux-feux « Terschellingerbank », « Maas » et « Noordhinder » et un quatrième, sur la terre ferme, à IJmuiden.
Aux CLASSES 6 (PORTS INTERIEURS) ET 7 (PORTS MARITIMES), ressortissaient naturellement les participations d'Amsterdam et de Rotterdam.
Le Service municipal de Commerce d'Amsterdam (GemeenteHandels-Inrichtingen) exposait une grande maquette à l'échelle de 1/2.500 de tout le complexe du port avec la reproduction de toutes les installations et des principaux services appartenant ou rattachés au port. Un bas-relief en cuivre figurait dans le fond l'agglomération urbaine qui se trouve à quelque distance du port. Au moyen d'un dispositif électrique, le visiteur pouvait faire apparaître sur l'arrière-fond de la maquette des diapositives reproduisant la partie ou l'installation du port qui retenait spécialement son attention.
A gauche et à droite, se trouvaient des vues du port et des cartes-reliefs représentant les communications avec l'hinterland. De nombreux graphiques renseignaient sur le trafic maritime et rhénan du port d'Amsterdam.
D'autre part, c'est la Fondation « Havenbelangen » qui présentait le port de Rotterdam. Elle s'était assurée de la collaboration de l'Académie des Arts plastiques et des Sciences techniques de la ville. Le stand comprenait cinq tableaux. La grande toile du milieu schématisait les entrées et les sorties du port avec, au centre, le plan du port. Deux tableaux de côté figuraient le chargement et le déchargement des bateaux au mouillage et à quai.
La paroi de gauche portait une carte de l'Europe indiquant la part prise par Rotterdam dans le trafic rhénan. Celle de droite montrait que, des nombreux bâtiments de mer visitant le port, deux tiers sont manutentionnés à quai et un tiers au mouillage.
Un diorama complétait l'ensemble en donnant une idée des installations vues des hangars à marchandises.
Enfin, par un modèle, on montrait les procédés de mise en place et d'assemblage sous l'eau des éléments du tunnel sous la Meuse, en voie d'achèvement à Rotterdam. On sait que cet ouvrage est construit suivant d'autres principes que ceux appliqués pour l'établissement du tunnel sous l'Escaut, à Anvers.
La CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX) était représentée, en ordre principal, par le Ministère des Affaires sociales et par le Service des Travaux du Zuiderzee. La participation de ce dernier a déjà été décrite.
En matière d'hygiène publique, le Ministère des Affaires sociales présentait les éléments suivants
a) Une carte d'ensemble de l'état actuel de l'approvisionnement en eau potable, avec la désignation des services locaux et régionaux,
b) Une représentation générale destinée à faire ressortir les préoccupations de l'Etat dans ce domaine, et l'organisation de l'Office national d'Approvisionnement en Eau potable,
c) Une carte de la Province de la Hollande septentrionale avec le réseau des conduites du Service provincial des Eaux,
d) Des photos et maquettes de châteaux d'eau, ainsi que des graphiques relatifs à la consommation d'eau potable dans le pays.
A la CLASSE 13 (LA TECHNIQUE DE L'EAU ET L'LECTRICITE), était inscrit le Service des Phares dont nous avons déjà parlé.
A la CLASSE 16''' (MATERIEL ET OUTILLAGE), figurait l'Union des Industriels métallurgistes dont les objets ressortissaient également aux classes 16iv et 19.
L'Union des Industriels métallurgistes (Vereeniging van Metaal-Industrieelen) groupe aussi bien les grands chantiers maritimes que les ateliers de constructions mécaniques.
Le stand comportait les modèles des grands paquebots « Nieuw Amsterdam » et « Sibajak », encadrés de diapositives donnant une image des diverses activités des exposants. Ainsi étaient représentés: le pont-levis de Barendrecht, l'écluse d'IJmuiden (la plus grande du monde), des photographies de dragues, grues, turbines, etc.
Les constructeurs présentaient également des modèles de sous-marins et autres navires de guerre, de bateaux de charge et de remorque, etc. Parmi les maquettes figurait celle de l'écluse de Vreeswijk, une des plus grandes écluses du monde pour la navigation intérieure.
A la CLASSE 16iv (ENTREPRISES), nous trouvions en plus d'exposants dont la participation a déjà été examinée comme l'Union des Industriels métallurgistes, le Service des Travaux du Zuiderzee et le port de Rotterdam, une participation remarquable et intéressante de la Centrale de Dragage.
Ce stand constituait une participation collective des dragages néerlandais (Vereeniging Centrale Baggerbedrijf). A côté de grands travaux aux ports et le travail d'entretien annuel, il y a lieu de citer la régularisation des rivières et, surtout, les travaux du Zuiderzee. Le caractère titanesque de cette dernière entreprise était mis en évidence par quelques chiffres particulièrement saisissants dont nous retiendrons que les terrassements se sont élevés à plus de 100 millions de m3. Quant aux travaux de dragage actuels exécutés chaque année dans le pays, ils portent en moyenne sur 30 millions de m3.
L'attention du visiteur était bien attirée sur l'importance et la valeur du matériel de dragage, ainsi que sur les nombreux travaux que les entrepreneurs néerlandais ont effectués à l'étranger.
Aux CLASSES 17 (NAVIGATION INTERIEURE) ET 18 (NAVIGATION MARITIME), se rapportaient particulièrement les participations déjà décrites du Waterstaat et des ports d'Amsterdam et de Rotterdam. Celle du Service des Phares figurait également à la classe 18.
La CLASSE 19 (CONSTRUCTIONS NAVALES) était représentée par l'Union des Industriels métallurgistes dont le stand a déjà été détaillé.
Quant à la CLASSE 23 (MATERIEL ET PROCÈDES CONCERNANT LA TECHNIQUE DE L'EAU DANS LES COLONIES), le Waterstaat s'y était fait inscrire pour certains travaux effectués aux colonies.
A la CLASSE 24 (ECONOMIE SOCIALE), se rattachait le stand de la Province de Limbourg.
On y avait tenu tout d'abord à rappeler, par des documents historiques, les liens qui existent entre Liège et le Limbourg néerlandais, depuis de longs siècles.
Puis, des statistiques et de nombreuses photographies servaient à caractériser l'industrie et l'agriculture de cette province, et des cartes lumineuses donnaient un aperçu des principales voies de communication par terre et par eau, ainsi que des nombreux ports situés sur la Meuse et le Canal Juliana. Une grande statue de saint Servais symbolisait la vie spirituelle de cette contrée des Pays-Bas.
Enfin, à la CLASSE 27e (TOURISME), était inscrit l'Office national du Tourisme (A.N.V.V.) qui avait réalisé une brillante participation destinée à montrer ce que le pays offre en fait de tourisme et de sport nautiques.
Une table-maquette figurait les centres aquatiques du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest. Les traits caractéristiques de ces régions étaient représentés et de nombreuses photographies illustraient la variété des attractions qu'offrent aux Pays-Bas, le sport et le tourisme de l'eau. Dans ce stand, se trouvaient également des cartes touristiques de la Société néerlandaise de Tourisme (A.N.W.B.).
4. CONCLUSIONS
On ne pourrait assez rendre hommage aux organisateurs de la participation néerlandaise pour le soin qu'ils avaient pris à lui donner le plus d'éclat possible. La présentation était parfaite et les objets de toute première valeur.
Comme nous le disions dans l'introduction, cette participation fut strictement limitée à certains aspects caractéristiques du programme de l'Exposition. L'effort principal a porté sur les travaux du génie civil, ainsi que sur la navigation et les constructions navales. Une mention doit être faite du stand de l'Hygiène publique, de celui du Limbourg et de la participation du Tourisme.
On ne peut évidemment reprocher aux organisateurs d'avoir systématiquement négligé certains points du Programme. Ils ont traité les problèmes les plus importants et surtout ceux qui s'apparentaient davantage aux travaux du Canal Albert dont l'inauguration était l'occasion de l'Exposition. On peut seulement regretter que les Pays-Bas n'aient rien présenté dans le domaine de la pêche, non plus que dans celui de la technique de l'eau dans les colonies. Une contribution de ce pays à ces deux éléments importants du Programme aurait été certainement du plus vif intérêt.
Nous ne pouvons passer sous silence la part réservée aux artistes dans l'aménagement du Palais. Nous avons eu l'occasion, au cours de l'analyse détaillée, de citer de nombreuses oeuvres d'art décoratif. Nous épinglons tout particulièrement la participation de la Fondation « Havenbelangen » (Rotterdam). Elle témoignait d'un soin artistique remarquable qui faisait honneur à l'Académie dont faisaient partie les artistes-collaborateurs. L'attrait de l'ensemble ne provenait pas seulement des peintures proprement dites, mais des mosaïques, découpages, éclairages spéciaux et dioramas réalisés à cet effet. Pendant la première quinzaine du mois d'août, le Palais fut orné d'une profusion de glaïeuls fournis par l'Union des Cultivateurs de Glaïeuls du pays.
Comme pour les autres sections nationales, nous insérons à la suite le tableau détaillé des récompenses décernées par le Jury international aux exposants néerlandais. Il révèle que les exposants officiels ont obtenu 89 % de récompenses de premières catégories et les exposants privés, 50 %.
Il est cependant facile de se rendre compte que ces chiffres ne correspondent pas à la qualité réelle des objets présentés. En effet, parmi les récompenses attribuées, il n'y eut que des Grands Prix et des Diplômes d'Honneur! Les pourcentages, qui expriment le rapport entre le nombre de hautes récompenses et le chiffre total d'exposants inscrits au concours, sont fortement influencés par le nombre relativement élevé d'exposants non récompensés, principalement par déclassement. Ils sont donc tout à fait théoriques.
En plus, 24 collaborateurs d'exposants, la plupart des artistes, furent récompensés individuellement, dont 1 par la Médaille d'Or, 2 par la Médaille d'Argent et 21 (les artistes) par des Diplômes Spéciaux.
CHAPITRE VII
LA SUEDE
La participation officielle de la Suède avait pris place au Palais international n° 22 situé sur la rive droite de la Meuse. Elle couvrait une surface de 150 mètres carrés.
On sait combien la vie économique et sociale de ce pays est intimement liée à l'eau. C'est dans tous les domaines: production, transport, économie domestique, que cet élément y joue un rôle primordial. Peut-être, cette situation particulière aurait-elle pu justifier, de la part d'un grand pays, une participation plus importante, sinon plus spacieuse? Mais les industriels suédois ne témoignent, depuis quelques années, que d'un faible intérêt pour les expositions. Et c'est l'Etat seul qui dut supporter les charges de la participation. Comme nous le verrons dans la suite, il réussit à donner une idée complète des relations de l'eau avec l'activité économique du pays.
La participation fut organisée par un comité présidé par M. W. Borgquist, directeur général de la Direction royale des Forces hydrauliques. La commission pour l'exécution matérielle était conduite par M. Torsten Althin, directeur du Musée polytechnique de Stockholm, Commissaire général de la Section. La direction artistique de l'aménagement était assurée par M. Jerk Werkmäster.
Le thème général était naturellement la présentation de la Suède comme pays possédant de nombreuses forces hydrauliques, et l'illustration de l'importance de l'eau pour l'industrie et comme voie de communication.
Un grand panneau décoratif formait le fond du stand. Il représentait les industries, les travaux agricoles, la vie en général le long du Klarälven, fleuve caractéristique qui avait été pris comme type.
Depuis des temps les plus reculés, il y eut de nombreuses et importantes industries au bord de ce fleuve et dans les environs. Des ruines centenaires, des moulins à eau, des fonderies de fer et des forges rappelaient les anciens établissements et l'importance de l'eau comme force motrice et comme moyen de communication.
Actuellement, les entreprises industrielles, de même que les chemins de fer de l'Etat (en grande partie électrifiés) reçoivent l'énergie dont ils ont besoin, des nombreuses usines hydrauliques modernes. Rappelons que la production d'énergie électrique du pays atteignit, en 1938, 8.150 millions de KWH, soit 1.300 KWH par habitant. 90 % de cette production provenait de la houille blanche, et les disponibilités d'énergie électrique par forces hydrauliques, s'élèvent à une puissance de 6,5 millions de KW, mais environ 25 % seulement des chutes d'eau sont aménagées et utilisées, à l'heure actuelle.
La frise représentait également entre autres les plus grandes turbines Kaplan du monde (8.50 m de diamètre), l'usine hydro-électrique la plus importante du pays (puissance installée: 150.000 KW), ainsi que le réseau fluvial et les lacs, notamment le lac Vânern, le plus grand de Suède et le troisième de l'Europe, formant un des plus grands réservoirs d'eau du monde.
On faisait aussi ressortir que l'agriculture emploie de plus en plus l'énergie électrique actuellement 65 % des entreprises agricoles sont électrifiées.
Le stand contenait, en outre, un modèle de démonstration en fonctionnement de la turbine Kaplan.
L'importance spéciale de l'eau pour les fabriques de papier et de pâtes à papier était schématisée par les statistiques concernant l'usine de Skoghall, fabrique de pâte de bois consommant 300.000 mètres cubes d'eau purifiée par jour, ce qui équivaut à la consommation d'eau d'une ville de 1 million d'habitants.
Il était rappelé, de même, l'importance des entreprises métallurgiques qui de tous temps ont dépendu fortement du concours des forces hydrauliques. Les mines de fer suédoises produisent annuellement 15 millions de tonnes de minerais affinés grâce aux forces hydrauliques du pays. Une série d'intéressantes photographies se rapportaient à l'industrie métallurgique qui tend de plus en plus à produire des articles de haute qualité.
D'autre part, on sait que l'exploitation des forêts de pins et de sapins, qui couvrent 55 % de la superficie du pays, constitue pour celui-ci une ressource considérable. Grâce à la déclivité du sol et à la longueur des cours d'eau, le transport du bois par flottage a pu être organisé rationnellement. La longueur totale des voies de flottage du pays dépasse les 33.000 kilomètres, et 150 millions de troncs d'arbres sont transportés chaque année de cette façon. Des photographies et une représentation schématisée de la technique du flottage figuraient au stand.
Une carte indiquait que les usines productrices de sulfate et de bisulfite, ainsi que les ateliers de polissage du bois sont principalement situées le long de la côte et dans le Nord, tandis que les scieries et les ateliers de mise en oeuvre sont répartis uniformément sur tout le territoire. Divers échantillons de produits finis (contreplaqué, acier inoxydable, etc.) étaient montrés.
Figuraient, en outre, un modèle de locomotive électrique, un autre d'un transformateur sur rails et un troisième d'un steamer à vapeur faisant le service régulier entre Anvers et la Suède.
Enfin, comme exemple de ce que les artistes suédois trouvent comme source d'inspiration dans le domaine de l'eau, on avait exposé une statue caractéristique du sculpteur renommé Anders Jônsson.
Il est intéressant de signaler qu'à l'occasion de l'Exposition, M. W. Borgquist, président de la Section, avait fait paraître un livre traitant, d'une façon complète et très scientifique, de la technique de l'eau dans l'économie suédoise.
En résumé, la participation fut une fort belle représentation officielle qui faisait particulièrement ressortir la perfection technique à laquelle est arrivé le pays, parmi ceux qui dépendent de l'eau et qui ont réussi à utiliser les moyens mis à leur portée en forces hydrauliques, voies fluviales et lacs.
Elle ne comprenait guère d'exposants privés. La Direction royale des Forces hydrauliques (Kungl. Vattenfallsstyrelsen) avait été inscrite dans les classes 4, 12 et 24 et y obtint, dans chacune d'elle, le Grand Prix. La Société Karlstads Mekaniska Verkstad, à Karlstad, se vit décerner le Grand Prix dans la classe 11, pour le beau modèle de démonstration de la turbine Kaplan. Enfin, un exposant suédois qui figurait individuellement dans la Section internationale, l'Aktiebolaget Kanthal, à Halistahammar, reçut la Médaille d'Or, dans la classe 16'' (produits métallurgiques).
Les collaborateurs d'exposants obtinrent 3 récompenses dont 1 Diplôme d'Honneur, 1 Médaille d'Or et 1 Diplôme Spécial.
CHAPITRE VIII
LES SECTIONS ÉTRANGÈRES
NON OFFICIELLEMENT REPRÉSENTÉES
Les Sections étrangères non officiellement représentées à l'Exposition n'étaient pas d'une importance exceptionnelle. Elles occupaient quelques stands dans les deux Palais internationaux nos 22 et 23.
L'ANGLETERRE était représentée par trois exposants. Le premier, la « Metafiltration C° Ltd » de Londres, exposait, dans la classe 10, du matériel relatif à l'épuration des eaux et y obtint la Médaille d'Or. Le deuxième, les Aciéries « Firth Sheffield Ltd », présentait des produits en aciers spéciaux ressortissant à la classe 16''; il fut récompensé par le Grand Prix. Le troisième, la firme « Ramsomes et Rapier Ltd » d'Ipswich, obtint également le Grand Prix, dans la classe 16''', pour du matériel d'entrepreneurs de travaux publics.
La POLOGNE était figurée par le Ministère des Communications avec un stand de propagande touristique. Dans la classe 27e, cet organisme reçut la Médaille d'Or.
La ROUMANIE était représentée d'une façon plus brillante. C'étaient les Usines communales de Bucarest (Uzinele Comunale Bucuresti) qui exposaient des problèmes d'alimentation en eau potable et des canalisations d'égouts de la capitale du pays.
Des coupes géologiques du terrain où se font les captages et des éléments se rapportant aux installations épuratrices et aux moyens de pompage des eaux résiduaires figuraient au stand. Etaient également schématisés, le cours de la rivière Colentina qui s'étale en marécages au nord de Bucarest, ainsi que les modes d'assainissement utilisés, la conformation des digues de réservoirs, les vannes des barrages mobiles et l'aménagement des centres hydroélectriques échelonnés le long de la rivière.
Les Usines communales de Bucarest se virent décerner la Médaille d'Or et le Grand Prix, respectivement dans les classes 4 (rivières et canaux) et 9 (travaux urbains et ruraux), ainsi que quatre récompenses pour leurs collaborateurs (1 Grand Prix, 1 Diplôme d'Honneur et 2 Médailles d'Or).
La SUISSE comptait un plus grand nombre d'exposants.
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich exposait du matériel scientifique dans les classes 1 et 2 (sciences) et dans la classe 9vi (l'eau dans l'agriculture). Le Jury lui attribua deux Grands Prix.
A la classe 4 (rivières et canaux), figurait la S.A. François Rittmeyer de Zoug qui y obtint la Médaille d'Or. La firme Brunner et C° était inscrite dans les classes 9 (travaux urbains et ruraux) et 16' (matériel de laboratoire, recherches) et y recueillit respectivement la Médaille d'Argent et le Diplôme d'Honneur, ainsi qu'une Médaille d'Or pour un collaborateur.
La Fabrique d'Appareils électriques Fr. Sauter, S.A. à Bâle, figurait dans les classes 11 (moteurs et machines hydrauliques), 14 (les industries du froid) et 19 (les constructions navales) et reçut la Médaille d'Or dans les deux premières et le Diplôme d'Honneur dans la troisième.
H. E. Grüner et Fils (Bâle) exposaient du matériel relevant à la classe 16' et y obtinrent la Médaille d'Or. Gaspard Winkler et C° présentaient des produits ressortissant à la classe 16'' (matières et matériaux) et furent récompensés de la Médaille d'Or également. Une semblable récompense échut à un de leurs collaborateurs. Enfin, le Schiffahrtsamt de Bâle, organisme de navigation intérieure, exposait quelques vues touristiques et obtint le Diplôme d'Honneur dans la classe 27e (tourisme).
Quelques autres exposants étrangers, d'un intérêt inférieur, figuraient également dans divers palais mais ces participations ne présentaient aucune particularité caractéristique en liaison avec le thème fondamental de l'Exposition.



