
Sceau de Notger
CHAPITRE PREMIER
INTRODUCTION
C'est un beau spectacle que présente le royaume d'Allemagne au Xe siècle. Sous la conduite d'une dynastie intelligente et active, il marche à pas de géant dans les voies de la civilisation. Ce siècle qui fut, pour d'autres pays, un siècle de fer, fut pour l'Allemagne, Leibniz l'a dit avec raison, un siècle d'or (1). Et déjà Sigebert de Gembloux, le plus grand chroniqueur du XIe siècle, proclamait heureux l'âge des Ottons.
La raison que Sigebert donne de son admiration pour cette époque est aussi celle qu'a reconnue l'histoire. Quand on cherche à se rendre compte des causes qui ont produit l'étonnante prospérité du royaume d'Allemagne à une époque où les pays voisins étaient plongés dans la nuit, on s'aperçoit bientôt que les souverains qui présidaient à ses destinées ont été admirablement servis. Une pléiade de grands évêques ont été, dans les provinces, les soutiens du trône et les intelligents collaborateurs des rois.
« D'illustres prélats et des hommes doués de sagesse restauraient l'État, rendaient la paix aux églises, restituaient à la religion sa pureté première. On pouvait constater, par les faits, la vérité de cet adage d'un philosophe, qu'heureux est l'État où les rois sont des sages, où les sages sont rois. Ce n'étaient pas des mercenaires, c'étaient de vrais pasteurs qui étaient assis alors sur les sièges épiscopaux » (2).
Ces paroles contiennent l'expression d'une vérité qui a frappé les historiens du XIXe siècle autant que les chroniqueurs du XIe. « Le clergé, écrit l'un d'eux, avait seul le sens de l'intérêt public, et seul lui avait montré un véritable dévouement (3). »
« Jamais, dit un autre, l'Allemagne n'a possédé un épiscopat à ce point distingué par l'intelligence, par la culture d'esprit et par les qualités morales (4).»
Et un troisième ajoute, presque dans les mêmes termes: « Jamais plus, par la suite, l'Eglise d'Allemagne ni aucune autre n'a pu se glorifier d'un épiscopat aussi riche en prélats pieux et zélés (5).
Si l'on veut contrôler ces affirmations générales, il est facile d'en constater la justesse. On peut dire que chaque siège épiscopal, pour ainsi dire, eut alors son grand homme, et parfois plus d'un. A leur tête, il faut mentionner leur modèle et leur maitre à tous, saint Brunon de Cologne, qui aura d'ailleurs un digne continuateur dans saint Héribert. A Trèves, nous rencontrons Henri et Egbert; à Mayence, il faut mentionner Guillaume et Willigis. Les suffragants sont dignes des métropolitains. Pour ne pas sortir de la Lotharingie, nous nommerons saint Ansfrid à Utrecht, Thierry à Metz, Wicfrid à Verdun, saint Gérard à Toul. Le reste de l'Allemagne n'est pas moins riche en prélats de haute sainteté et de première valeur comme chefs d'État; il suffit de citer saint Ulric à Augsbourg, saint Wolfgang à Ratisbonne, Reginald à Eichstaett, Piligrim à Passau, saint Bernward et saint Godehard à Hildesheim, saint Meinwerk à Paderborn. Tel est le sénat épiscopal au milieu duquel Notger, évêque de Liège, tient dignement sa place.
C'est l'oeuvre collective de ces hommes qui fait la beauté du règne des rois, leurs maîtres. Ceux-ci ont eu le mérite très grand de les deviner, de les mettre en valeur, de les sertir comme des joyaux, en quelque sorte. L'épiscopat allemand a levé, si je puis ainsi parler, dans l'atmosphère de paix et de quiétude que la forte épée des princes saxons a fait régner sur l'Allemagne. Le souffle printanier qui passe sur le jeune royaume ottonien ravive la sève du vieux tronc taillé et greffe par saint Boniface et par Charlemagne; une poussée de progrès se fait sentir dans tous les domaines; la vie intellectuelle, morale et matérielle reprend au sortir de la crise qui a secoué la civilisation du IXe siècle expirant.
Les évêques allemands sont donc dignes de la confiance de la royauté qui les appelle au partage de leur autorité temporelle. Les principautés ecclésiastiques naissent autour de leurs crosses, et ils sentent peser sur leurs épaules un double fardeau. On se tromperait beaucoup si l'on se persuadait que tous ont vu avec le même plaisir cet accroissement de leur responsabilité. Plus d'un en éprouva de la répugnance, et il en fut, comme Ulric d'Augsbourg, qui demandèrent à être soulagés. Il ne manquait pas d'esprits, au XIe siècle, qui blâmaient le cumul des attributions religieuses et politiques, et un écrivain quelque peu officiel a cru devoir répondre à leurs objections (6). Plus tard, il est vrai, on s'habitua à la nouveauté; les évèques s'accomodèrent de leur rôle de princes, et, plus d'une fois, le prince prima l'évêque au grand détriment de l'Église et de la religion.
Il n'en fut pas ainsi dans ce siècle d'or de la monarchie allemande. Les caractères du prince et du prélat se fondaient harmonieusement dans le même homme. Beaucoup d'évêques de ce temps ont été des saints; plusieurs ont l'auréole, beaucoup d'autres la méritent. Nous les connaissons surtout comme princes, parce que leur activité extérieure est celle qui a le plus frappé leurs contemporains. Mais quand on veut, guidé par les indications trop parcimonieuses des biographes, pénétrer dans l'intimité de ces hommes de gouvernement, on rencontre à la base de toute leur existence la conception chrétienne du but de la vie et des devoirs qu'elle impose à l'homme ici-bas.
Il est frappant de voir combien, la tâche civilisatrice se présentant la même partout, la carrière, l'activité de ces hommes sont identiques dans leurs grandes lignes. Tous agrandissent et protègent la propriété ecclésiastique, bâtissent et restaurent des églises, pourvoient aux besoins des pauvres par d'abondantes fondations charitables, ont au plus haut degré l'amour des études, multiplient les écoles et vont jusqu'à enseigner eux-mêmes, protègent les arts et parfois les cultivent. Tous font la guerre aux abus, soumettent les factieux, fortifient leurs villes, abattent les châteaux-forts des pillards ou en bâtissent d'autres pour les tenir en respect, ont la passion de la justice et sont zélés pour le service du roi. Leur souvenir s'imprime profondément dans la mémoire populaire; on leur fait des légendes pour ainsi dire dès leur vivant. Et, d'autre part, les écrivains s'emparent de leur vie, et la biographie épiscopale s'élève à la hauteur d'un genre littéraire.
Notger est une des figures à la fois les plus intéressantes et les moins connues de cette famille ecclésiastique. Il fut pour la dynastie des Ottons un agent fidèle aux jours de la prospérité, un conseiller sûr dans les moments de crise, un défenseur courageux aux heures mauvaises. Par lui, la monarchie allemande trouva pour un siècle, dans la principauté de Liège, son plus solide boulevard en Lotharingie.
Mais le rôle joué par Noter dans l'empire ne nous révèle qu'un aspect de sa physionomie. Il nous intéressera davantage encore si nous l'envisageons comme fondateur de l'état liégeois. Ici, il ne travaille pas en sous-ordre et, en quelque sorte, pour le compte d'autrui. Il est souverain; c'est son initiative que nous rencontrons partout, ce sont ses idées originales et civilisatrices qui trouvent leur expression dans cette ville qu'il crée, dans cet état dont la trame s'ourdit sous ses mains. La scène, sans doute, n'est pas si vaste que celle de l'Empire, mais l'intérêt n'est pas diminué par les proportions du cadre: il semble même que, pouvant plus facilement embrasser du regard le tableau, on le comprenne mieux et on l'admire davantage.
La difficulté, pour un livre qui veut faire revivre cette physionomie, c'est de fondre en une seule figure historique les traits du feudataire impérial et ceux du chef d'État. Je m'y suis employé comme j'ai pu. Si, dans mon exposé, le chef d'État apparait plus souvent que le feudataire, c'est d'abord la nature de mes matériaux qui l'a voulu ainsi; Notger, comme chef d'État, a attiré l'attention de l'histoire; Notger, comme feudataire, n'a laissé sa trace que dans quelques diplômes. C'est ensuite la proportion même des deux rôles qu'il a rempli. Dans l'Empire, il est au quatrième ou au cinquième rang; à Liège, il occupe le premier. Là, il apporte son concours à une tâche commune, dont le programme ne lui appartient pas; ici, il exécute, pendant un long règne, un plan qui est le sien, et qui nous donne la vraie mesure de sa valeur.
Notger cependant est inconnu, que dis-je? il est méconnu. Si, au dernier siècle, quelques Liégeois ont fait, dans une certaine mesure, réparation à sa mémoire, ç'a été seulement pour la laver d'une accusation infamante, et leur voix n'a pas eu d'écho à l'étranger. Les titres de gloire de Notger restent plongés dans l'oubli, et les légendes calomnieuses continuent de circuler. Sous ce rapport, il y aura quelque plaisir pour le lecteur à voir reparaitre graduellement, dans ces pages, la figure authentique d'un grand homme qui peut se dire le créancier de l'histoire.
|
CHAPITRE II
L'ÉTAT LIÉGEOIS AVANT NOTGER
De tous les royaumes issus du morcellement de l'héritage de Charlemagne, la Lotharingie était celui qui contenait le plus d'éléments de vitalité, et ce fut au contraire, grâce à un concours de circonstances tragiques, le plus éphémère et le plus malheureux. Sa dynastie nationale s'éteignit avec son premier roi (869). A partir de cette date, elle est ballottée entre la France et l'Allemagne, qui, tantôt, essayent de se l'arracher l'une à l'autre, tantôt, se la partagent, jusqu'à ce qu'enfin, en 879, elle reste à l'Allemagne seule. Grâce à la tendresse du roi Arnoul pour son fils Zwentibold, qu'il voulait mettre à la tète d'un royaume, la Lotharingie retrouva son autonomie nationale en 895. Mais cette seconde phase d'indépendance nationale fut encore plus courte que la première: Zwentibold périssait dès 900, en luttant contre les grands révoltés, et le pays était de nouveau rattaché à l'Allemagne en 911. Peu après, il se jetait encore une fois dans les bras de la France, lorsque l'extinction des Carolingiens d'Outre-Rhin fournit à l'aristocratie un prétexte pour changer de suzerain. Mais la France ne devait pas garder longtemps une possession qui avait été de sa part l'objet de tant de convoitises: dès 924, le roi d'Allemagne, Henri I, devenait le maitre de la Lotharingie, et, cette fois, le pays entrait définitivement dans l'orbite du plus puissant des royaumes francs. Les Carolingiens de France ne s'y résignèrent pas facilement; jusqu'à la fin, comme on le voit par les tentatives désespérées du roi Lothaire, ils rêvèrent de regagner ce qu'ils appelaient alors l'héritage de leurs pères, ce que leurs successeurs devaient appeler les frontières du Rhin. Ce fut peine perdue: la Lotharingie demeura à l'Allemagne.
Mais le sentiment national était resté vivace dans le pays, et ses nouveaux maîtres surent le respecter. Alors qu'en 879, lors de sa première annexion à l'Allemagne, il n'avait été pour celle-ci qu'un accroissement de territoire, qu'une province de plus, il n'en fut pas ainsi après la mort de Zwentibold. La restauration de l'indépendance, si précaire qu'elle eût été sous ce roi, avait ravivé le patriotisme dans l'ancien royaume de Lothaire; on ne voulait pas renoncer à ce titre, et les nouveaux souverains respectèrent les susceptibilités de nos ancêtres en leur laissant l'apparence de l'autonomie. Le royaume de Lotharingie garda donc, de 900 à 911, sa chancellerie propre et ses plaids nationaux distincts de ceux de l'Allemagne; et il en fut de même de 911 à 923, pendant les quelques années qu'il fut, pour la dernière fois, rattaché au royaume de France (7).
Cette situation ne se maintint pas, il est vrai, à partir d'Henri I; toutefois, pendant tout le Xe siècle et pendant une bonne partie du XIe, la Lotharingie resta un royaume dans la pensée ou dans le langage de ses enfants et de ses voisins. Elle est le royaume de Lothaire pour la plupart des chroniqueurs contemporains, et l'usage est ici un indice trop significatif pour qu'on puisse n'en pas tenir compte: il atteste tout au moins qu'on a gardé la conscience de certains caractères nationaux propres, qui ne permettent pas de voir dans notre pays un simple prolongement de l'Allemagne (8).
Il n'en faut pas douter: c'est sur ce sentiment national que s'appuya la famille de Régnier au Long Col, au cours de ses incessantes rébellions contre les souverains français et allemands. Quand on voit cette maison, dont l'ambition était si grosse de menaces pour la liberté et pour le patrimoine de tant d'autres, soulever à diverses reprises, contre les rois, un ensemble si imposant de forces, n'en faut-il pas conclure qu'elle disposait d'un mobile assez puissant pour contrebalancer toutes les jalousies et toutes les inquiétudes qu'elle devait inspirer? Et ce mobile, quel pouvait-il être, sinon ce que nous avons le droit d'appeler le patriotisme lotharingien?
C'est cet esprit national, souvent fourvoyé, il est vrai, ou mis au service d'ambitions personnelles, qui fut toujours le grand danger de l'autorité des rois d'Allemagne en Lotharingie. Il régnait spécialement dans la partie occidentale du pays, celle que le partage de 870 avait assignée à la France, et qui d'ailleurs, à plusieurs égards, se distinguait nettement de l'orientale. Somme toute, la Lotharingie orientale et la Lotharingie occidentale appartenaient à deux groupes ethniques différents: la première était germanique et la seconde romaine (9), et malgré les efforts de la politique pour ignorer ou pour pallier cette opposition nationale, elle s'affirmait en dehors de la vie officielle avec une force croissante (10). Tant qu'on n'en était pas venu à bout, tant qu'on n'avait pas donné une autre direction au puissant courant, les rois d'Allemagne n'étaient chez nous que des conquérants étrangers, dont l'autorité était toujours menacée par « l'indomptable barbarie » des provinces occidentales du royaume de Lothaire (11).
Les rois firent ce qu'ils purent; ils imaginèrent de s'attacher les grands du pays par des mariages (12), mais cela ne réussit point. II fallut l'arrivée de saint Brunon pour sauver la situation. Otton le Grand fut bien inspiré le jour où il confia à son frère, avec la chancellerie du royaume d'Allemagne, le gouvernement de cette orageuse et turbulente Lotharingie. Les dix années (955-965) pendant lesquelles, sans titre officiel d'ailleurs (13), l'archevêque de Cologne tint en mains les rênes du pays furent décisives pour l'avenir de celui-ci. Brunon sut concilier à la dynastie, par sa douceur, et dompter, par sa fermeté, un peuple habitué aux révolutions et ennemi de ses maîtres. II mit fin au schisme funeste de la Lotharingie romane et de la Lotharingie germanique, en renversant l'axe du partage de cette vaste contrée, et en la divisant géographiquement en Haute et en Basse. Ce partage fut décisif; à partir de ce jour, mises chacune sous l'autorité de ducs différents, la Haute et la Basse Lotharingie n'eurent plus rien de commun entre elles. Le Lothier, qui correspond à la Basse, et la Lorraine, qui est le nom de la Haute, suivront désormais des destinées différentes.
Pour longtemps, l'opposition nationale entre les populations de race diverse que chacune contenait dans son sein cessa de se faire sentir. Mais ce n'était pas encore assez. Même réduite dans ces proportions, même désorientée par ces combinaisons nouvelles, l'autorité ducale pouvait rester redoutable, et la suite le fit bien voir. Que d'embarras ne causèrent pas aux Ottons les remuants descendants de Régnier au Long Col! Mais, s'il ne put entièrement les brider, Brunon sut leur donner des contrepoids. En face de ces grandes familles laïques qui étaient la terreur des rois, il plaça les puissances ecclésiastiques, dont la fidélité ne se démentit pas. Il y avait en Lothier trois sièges épiscopaux: ceux de Cambrai, de Liège et d'Utrecht. Brunon voulut qu'ils fussent autant de citadelles impériales. Il devint l'âme de cet excellent épiscopat qui présida pendant la plus grande partie du Xe et du XIe siècles aux destinées du pays. Maitre de la chancellerie du royaume allemand, il y formait sous ses yeux les hommes de valeur qui devaient ensuite, sur les sièges épiscopaux, travailler avec lui à consolider la dynastie, le royaume, la religion. Formés et façonnés à son école longtemps après qu'il aura disparu, les évêques de l'époque ottonienne y apprendront l'amour des lettres, le dévouement à la famille royale, le sens des choses publiques (14). Et c'est ainsi que de la Lotharingie, qu'il avait trouvée si barbare, Brunon fit une province pacifique et civilisée (15).
Le diocèse de Liège se ressentit particulièrement de la sollicitude de ce grand homme. A deux reprises, il y plaça des hommes lettrés et austères qui sortaient de son entourage et dont le caractère lui inspirait toute confiance. Le premier ne parvint pas à se maintenir, et l'on peut dire que son échec fut le seul insuccès de la carrière politique du saint. Mais l'insuccès ne fut pas de longue portée, et ce sont encore des hommes selon le coeur de Brunon qui, après sa mort, continueront à Liège l'oeuvre à laquelle il avait consacré sa vie.
L'histoire de saint Brunon est, de la sorte, comme l'introduction de celle de Notger: on ne comprendra bien celui-ci qu'en se rappelant le milieu d'où il est sorti et les influences qui ont formé sa personnalité. D'autre part, on ne se rendra bien compte du rôle joué par le premier prince-évêque de Liège que si l'on connaît le domaine dans lequel va s'exercer son activité. C'est pourquoi l'aperçu que nous venons de présenter de la carrière lotharingienne de saint Brunon sera suivi logiquement d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'état liégeois avant Notger.
L'État liégeois n'est pas seulement ecclésiastique par son caractère, il l'est aussi par son origine. II doit sa naissance au diocèse dont il faisait partie, et dans lequel, petit à petit, s'est constitué son domaine temporel. Ce diocèse, qui avait pour tête la ville de Tongres, était identique, au point de vue territorial, avec la cité romaine du même nom, qui était elle-même l'une des subdivisions de la seconde Germanie. Qui connaît les frontières du diocèse peut tracer exactement celles de la civitas. Celle-ci était immense, ayant été formée de la réunion des territoires de plusieurs peuplades dont les unes, comme les Éburons, avaient été exterminées par les Romains, et dont les autres étaient trop petites pour constituer chacune une cité à elle seule. Le diocèse ou la cité de Tongres - c'est tout un au point de vue territorial - comprit donc, jusqu'en 1359, année de son morcellement, toute la Belgique orientale jusqu'à la Semois inférieure avec des parties considérables des provinces limitrophes, c'est-à-dire du Brabant septentrional, du Limbourg hollandais, de la Prusse rhénane et du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'étendait du nord au sud, de Bois-le-Duc à Bouillon, et on aura tracé ses confins en y comprenant Berg-op-Zoom, Bois-le-Duc, Venlo, Ruremonde, Wassenberg, Aix-la-Chapelle, Eupen, Stavelot, Saint-Vith, Bastogne, Bouillon, Chimay, Thuin, Nivelles, Louvain, Arendonek, Eeckcren. On peut préciser quelques points. A l'est, la limite passait entre Stavelot et Malmedy, entre Aix-la-Chapelle et Borcette; à l'ouest, elle passait entre Thuin et Lobbes, entre Nivelles et Bornival, entre Louvain et Hérent, entre Arendonck et Turnhout. Au nord, le diocèse était limité par le cours de la Meuse (16). Neuf diocèses se partagent aujourd'hui le vaste territoire sur lequel régnait la crosse de saint Servais et de ses successeurs (17).
De bonne heure, la libéralité des rois francs, des évêques eux-mêmes et des fidèles avait fait passer dans le patrimoine de l'église de Tongres des fractions considérables de ce beau domaine. Au Xe siècle, l'église de Liège possédait encore dans ses archives des actes qui attestaient ces largesses, celles de saint Remacle notamment (18).
II est fort probable que des évêques qui possédaient leur patrimoine dans le pays, comme saint Monulfe (19), saint Jean l'Agneau (20), saint Lambert (21), peut-être encore saint Perpète et saint Domitien (22), et d'autres saints personnages issus de riches familles hesbignonnes, comme saint Trond, saint Bavon, saint Chrodegang de Metz, n'ont pas oublié dans leurs libéralités le diocèse de Tongres. Nous en dirons autant des rois mérovingiens. Ils s'intéressaient à ce pays, qui était pour eux la terre des aïeux; ils y avaient, dans la giboyeuse Ardenne, des villas royales où ils aimaient à résider, comme Longlier (23) et Bessling (24), qu'ils visitaient souvent à la saison des grandes chasses, et nous connaissons le séjour que deux d'entre eux ont fait dans la ville de Maestricht (25), qui était pour lors la résidence des évêques. C'est un prince de cette dynastie, Sigebert II, qui a donné à saint Remacle, évêque de Tongres, les vastes solitudes où il bâtit les abbayes de Stavelot et de Malmedy (26). Qui ne voit qu'une donation de cette importance en laisse deviner bien d'autres qui nous sont restées inconnues? Le crédit dont on sait que saint Lambert jouissait auprès du roi Childéric II et de ses successeurs n'a pas laissé de profiter à son église (27). Ce ne sont pas ici de simples conjectures au XIIIe siècle, on possédait encore à Liège le diplôme par lequel le roi Clovis III (691-695), à la demande du saint, avait confirmé à l'église de Tongres ses possessions avec la jouissance de l'immunité (28). Or, un domaine territorial considérable, soustrait par l'immunité à l'intervention des officiers royaux, qu'était-ce autre chose qu'une principauté ecclésiastique en germe?
Les Carolingiens ne se montrèrent pas moins généreux envers l'église de Tongres que les Mérovingiens. Plus encore que ceux-ci, ils étaient attachés à la Belgique orientale, qui était le berceau de leur famille et le centre de leurs propriétés territoriales. Leurs libéralités étaient consignées dans un grand nombre de diplômes conservés, à côté de ceux des descendants de Clovis, dans les archives de l'église cathédrale. Au dixième siècle, elle pouvait exhiber encore ceux de Pépin le Bref, de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire I et de Charles le Gros, et il s'en faut que cette énumération fût complète (29). Les actes de Pépin et de Charlemagne étaient perdus dès le XIIIe siècle, à l'époque où l'on compila le cartulaire de l'église de Liège, puisqu'ils n'y ont pas été transcrits; toutefois, il est à remarquer que l'on connaissait encore, en 1250, un diplôme de Charlemagne pour l'évêque Agilfrid (30). Les actes de Louis le Débonnaire ont disparu également (31). De Charles le Gros enfin, le cartulaire de Saint-Lambert n'a conservé qu'un acte de 884 par lequel il donne à l'église de Tongres la terre de Maidières au pays de Charpeigne, avec les serfs qui lui appartiennent à Tongres et à Liège (32).
Mais, si les documents visés par Otton II ont entièrement disparu (sans doute parce qu'ils étaient écrits sur papyrus), les archives de Saint-Lambert ont conservé un certain nombre d'actes émanés de rois carolingiens dont il n'est point parlé dans les diplômes des Ottons.
Cette nouvelle série s'ouvre par la riche donation de l'empereur Arnoul, qui, en 888, confirma à l'église de Liège la possession de la grande abbaye de Lobbes, avec le château de Thuin et 153 villages, et elle se continue au cours des années suivantes par d'autres libéralités importantes (33). En 894, Charles le Simple restitue à l'évêque Francon la terre d'Arches (Charleville) dans le Porcien (34). En 898, le roi Zwentibold lui fit don de Theux (35). Vers ce même temps, Gisèle, fille du roi Lothaire II, lui donna l'abbaye de Fosse (36). En 908, Louis l'Enfant lui confirma la possession du droit de monnaie et de tonlieu à Maestricht. (37) En 908-915, Charles le Simple lui accorda l'abbaye d'Hastières et lui confirma la possession de celle de Malines (38). En 915, le même roi lui concéda le forestum de Theux, complétant ainsi la donation de Zwentibold (39). Enfin, en 952, Otton Ier ajouta à toutes ces richesses la donation de l'abbaye d'Aldeneyck (40).
Le domaine territorial de l'église de Liège formait un vaste ensemble de terres non pas contiguës, à la manière d'un État moderne, mais disséminées et isolées, comme le sont d'ordinaire celles qui constituent les patrimoines privés. Et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'en somme il s'était constitué comme ces derniers, par des donations, par des achats et par des échanges. Ce qui faisait l'unité de ce domaine épiscopal, c'était, outre la personnalité du propriétaire, la situation juridique spéciale qui lui était assurée. Cette situation était désignée par le nom d'immunité. L'immunité était un privilège très précieux, dont un grand nombre de terres ecclésiastiques et quelques laïques jouissaient dès l'époque mérovingienne. II consistait, comme on sait, en ce qu'aucun officier public, ni le comte ni aucun de ses agents, ne pouvait entrer dans le domaine immunitaire sous quelque prétexte que ce fût, soit pour juger des procès, soit pour lever des amendes, soit pour prendre des fidéjusseurs, soit pour exercer le droit de gîte, soit pour percevoir des impôts. C'est l'immuniste lui-même, ou l'agent choisi par lui, qui procédait à tous ces actes de la vie publique. Nous avons des formules du VIIe siècle qui nous montrent que tous les droits enlevés par les actes d'immunité aux agents royaux sont conférés aux propriétaires exemptés. Et il n'est pas douteux que les évêques de Liège n'aient été de très bonne heure au nombre de ces derniers. Non seulement cela résulte de l'existence du diplôme de Clovis III, mais les actes impériaux qui, sous Notger, viennent confirmer les droits de nos évêques, le font avec des expressions empruntées aux plus anciens documents qui conféraient l'immunité. II est manifeste qu'ils se bornent à copier des documents de l'époque mérovingienne (41).
L'évêque de Liège était donc, depuis quelques siècles au moins, un grand seigneur immuniste. Entre lui et le souverain, il n'y avait personne. Il était lui-même, dans ses terres, l'officier royal, et il exerçait sur toute la population qui dépendait de lui les pouvoirs de ce dernier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent de son choix (42). La juridiction que son immunité interdisait à tout autre officier royal, c'est lui qui l'exerçait. Son pouvoir judiciaire faisait partie de sa qualité d'immuniste (43).
Cette situation était belle; toutefois, elle était bien loin d'être exempte d'ennuis et même de dangers. En un temps d'anarchie et de violence, les richesses de l'église tentaient beaucoup de gens, et comme il n'y avait personne pour la défendre, elle était à la merci de tous les déprédateurs. La vie même des évêques n'était pas toujours protégée. Coup sur coup, deux évêques de Tongres, saint Théodard et saint Lambert, périrent pour avoir voulu défendre contre les pillards l'intégrité du patrimoine ecclésiastique (44). Mais la mort de saint Lambert devait amener un changement considérable. L'extraordinaire affluence des fidèles autour de son tombeau, donna en peu d'années à la modeste bourgade de liège une importance suffisante pour lui valoir le premier rang dans le diocèse. Treize ans après la mort du saint, son successeur Hubert y transférait le siège de l'évêché.
C'était là une détermination grave. Elle fut exécutée d'une manière solennelle et en quelque sorte avec le caractère d'un véritable exode. Quelles raisons saint Hubert avait-il d'abandonner les deux chefs-lieux du diocèse, non seulement la vénérable ville de Tongres, qui en était le siège officiel, mais la belle Maestricht, où s'élevaient de si nobles sanctuaires, et où la tombe de saint Servais semblait avoir à jamais fixé la résidence de ses successeurs? S'il est permis de chercher ailleurs que dans une inspiration de la piété l'origine de la migration de saint Hubert, je ferai remarquer qu'à Liège, les évêques étaient chez eux, sur un sol qui leur appartenait, tandis qu'à Maestricht, dont ils ne possédèrent jamais que la moitié, ils avaient pour voisins gênants et souvent pour rivaux et pour ennemis les comtes francs. Cette considération ne doit pas être restée indifférente à saint Hubert. A Liège, il put désormais exercer en toute liberté l'autorité presque illimitée attribuée à l'évêque sur la vie sociale de ses diocésains. Il fut, dans une certaine mesure, le créateur de la ville de Liège, et l'on voit vaguement, sous lui, s'ébaucher la principauté future (45).
Les conditions d'existence du diocèse et du domaine ecclésiastique ne se modifièrent pas d'une manière essentielle sous le règne de Charles-Martel. L'église de Liège, comme toutes les autres, dut donner en fief une quantité de ses biens, et gagna à ce prix un certain nombre de vassaux. D'autre part, la dynastie carolingienne, qui s'appuyait sur la grande propriété et sur l'Église, ne cessa de favoriser celle-ci, confirma ou multiplia ses immunités, lui fit des concessions territoriales. L'église de Liège possédait des diplômes d'immunité qui lui avaient été concédés par tous les rois carolingiens depuis Pépin le Bref et son frère Carloman (46) jusqu'aux deux Lothaire et à Charles le Gros (47). Elle prenait donc de plus en plus, et par ces concessions réitérées du pouvoir souverain, et par les inféodations auxquelles elle avait dû se prêter, le caractère d'une institution féodale, reflétant ainsi dans son mode d'existence les conditions générales de la société dont elle faisait partie. Et ni les troubles qui éclatèrent après la mort de Louis le Débonnaire, ni les partages réitérés mais précaires de la Lotharingie, ni les terribles ravages des Normands ne changèrent rien à la situation territoriale des évêques. On voit au contraire progresser leur influence, et la royauté se dépouiller de plus en plus en leur faveur.
Dès le Xe siècle, nous trouvons l'église de Liège en possession de privilèges nouveaux, qui accentuent sa marche lente et graduelle vers la souveraineté. Nous avons déjà vu qu'en 908, en vertu d'une donation de Louis l'Enfant, elle possédait à Maestricht le droit de tonlieu ou de marché et celui de monnaie (48). Nous savons aussi qu'à une date que nous ne pouvons préciser, elle avait reçu également le droit de tonlieu et de monnaie à Huy (49). Ce droit régalien n'était pas de ceux qui faisaient partie, jusqu'alors, des concessions d'immunité: il appartenait essentiellement au pouvoir souverain, et Charlemagne se l'était toujours réservé. C'est Louis le Débonnaire qui donna le premier l'exemple de l'abandonner (50), et peut-être est-ce à ce prince que l'église de Liège devait celui qu'elle exerçait à Huy. Il faut noter ici l'étroite connexité qu'il y avait entre les droits de marché, de tonlieu et de monnaie. Abandonner à un évêque celui de marché, c'était lui céder les redevances payées au prince du chef des transactions commerciales, et c'est ce qu'on appelait droit de tonlieu. C'était lui céder aussi la police du marché et le droit de punir les infractions, en d'autres termes le droit de ban. C'était, enfin, lui donner la haute main sur une institution dont ne pouvait se passer aucun marché, à savoir, l'établissement qui transformait en numéraire les métaux servant aux transactions commerciales, et qui remplissait en l'espèce l'office d'une vraie banque d'échange (51). Sous le nom de droit de marché, il faut donc comprendre en général ce triple droit de tonlieu, de ban et de monnaie, qui, sans être toujours exprimé complètement dans les concessions de marché, n'en est cependant pas séparable (52).
Qui ne voit qu'un pareil droit dépassait de beaucoup la portée de l'immunité? Par celle-ci, un grand propriétaire était déclaré seul intermédiaire entre la population de son domaine et le souverain. Par le droit de marché, au contraire, une partie essentielle des droits du souverain était détachée du pouvoir royal et livrée au concessionnaire. Aussi voyons-nous qu'en 908, pour enlever à l'officier royal de Maestricht, c'est-à-dire au comte Alboin, une portion aussi considérable de ses attributions, le roi crut devoir commencer par prendre son consentement (53).
Au moment donc où s'éteignait la dynastie carolingienne, les évêques de Liège, comme un grand nombre de leurs collègues allemands, n'étaient plus de simples immunistes, et, s'ils n'étaient pas encore de vrais princes, ils tendaient sans relâche à le devenir. Déjà ils étaient en voie de supplanter l'autorité comtale dans les principales villes de leur diocèse: Maestricht, Huy et probablement Tongres. Leurs droits domaniaux d'une part, leurs naissantes attributions politiques de l'autre, constituaient une double autorité sur laquelle se posait le prestige de leur dignité religieuse. Quand on les voit, déjà sous Hartgar (841-855) et sous Francon (856-903) marcher contre les Normands à la tète de leurs propres troupes, et remporter des victoires sur ces redoutables envahisseurs (54), ce ne sont plus seulement des pasteurs, ce sont des princes qu'on reconnait en eux.
Aussi l'élection d'un évêque de Liège était-elle une affaire dont personne ne se désintéressait, et qui, le cas échéant, prenait les proportions d'un intérêt international. Ce fut le cas lorsque mourut l'évêque Etienne en 920. II y eut deux candidats en présence, alliés l'un et l'autre aux plus puissantes familles de France et d'Allemagne. L'un, Hilduin, était parent des comtes d'Arles et de Provence; l'autre, Richaire, abbé de Prüm, avait pour frères les fameux comtes Gérard et Matfried, qui, en 900, avaient triomphé du roi Zwentibold. Toute la Lotharingie prit parti dans cette querelle, qui bientôt se transforma en une rivalité de nations, l'Allemagne appuyant Hilduin et la France Richaire. C'est ce dernier qui l'emporta, parce qu'il avait pour lui le souverain du pays, alors Charles le Simple, et qu'il fut reconnu par le pape. Mais la lutte si âpre et si longue qui s'était livrée pour la possession du siège épiscopal entre les deux factions prouve bien que dès lors l'évêché était un pouvoir qui ne laissait plus personne indifferent (55).
L'avénement des rois d'Allemagne en Lotharingie accéléra le développement de ce pouvoir temporel qui, depuis plus d'un siècle, se formait peu à peu autour du siège épiscopal de Liège. Incessamment en lutte avec la maison de Régnier au Long Col et avec ses nombreux adhérents, la royauté trouvait dans les évêques ses meilleurs appuis, ses plus fidèles serviteurs. Aussi Liège devint-il, avec Cambrai et Utrecht, la citadelle où le pouvoir impérial avait ses arsenaux et ses refuges. Les évêques accompagnaient l'empereur dans ses expéditions; nous rencontrons Rathier et Eracle à la suite d'Otton I en Italie, et nous lisons dans un document de 980 que l'église de Liège envoie à l'armée impériale, cette année, un contingent de soixante hommes d'armes vêtus de la cuirasse ou broigne (56). Les deux évêques dont il vient d'être question ont bien déjà l'air de princes: des émeutes éclatent contre eux; le premier est renversé et chassé par les grands, et du second il est dit qu'il fut tellement doux qu'il ne punit pas les coupables (57). Et, dès les premières années de son règne, Notger peut affirmer son autorité souveraine à Liège: on nous dit qu'il punit avec la dernière sévérité les perturbateurs qui avaient troublé la vieillesse de son prédécesseur Eracle (58). Tous ces faits attestent que la principauté ecclésiastique de Liège n'est pas née tout d'un coup, qu'elle s'est formée à la longue, sous l'action du milieu ambiant, et que les diplômes d'immunité qu'elle reçut des Ottons consacrent plutôt qu'ils ne créent leur autorité territoriale.
Rendons-nous, si possible, un compte exact de cette situation, à la veille des faits qui vont donner un cachet officiel à l'existence de la principauté. Nous verrons que l'église de Liège est un grand propriétaire immuniste qui, comme tous ses semblables, a donné en fief une bonne partie de ses terres: celles-ci ont dès lors cessé de faire partie de son domaine direct pour aller enrichir la classe déjà nombreuse des vassaux de l'église. Le mouvement féodal qui déterminait ces aliénations de territoire était si intense que, dès le IXe siècle, la royauté chercha à en modérer les excès. C'est ainsi qu'en 884, Charles le Gros, en faisant don d'une terre à l'église de Liège, stipulait qu'elle ne pourrait jamais être donnée en fief (59). Mais il était impossible de remonter le courant, pour la raison qu'il était universel, et qu'il y avait pour l'église autant d'avantages que d'inconvénients à y céder. Si, en effet, d'une part, elle se voyait privée de la jouissance de plus d'un domaine par les laïques avides auxquels elle était obligée de l'inféoder, de l'autre, c'est l'inféodation seule qui lui procurait les vassaux formant son armée. Aussi voyons-nous les églises, à cette époque, travailler à se procurer le plus grand nombre possible de vassaux, et celle de Liège, au commencement du XIe siècle, continuait de faire de même (60). Dès la seconde moitié du Xe, ces vassaux ecclésiastiques, sous le nom de milites, apparaissent fréquemment dans nos textes. Chaque diocèse, chaque abbaye a les siens, en nombre plus ou moins considérable selon l'importance de ses propriétés territoriales. Les uns sont des hommes libres qui se sont fait céder des terres ecclésiastiques en fief pour s'enrichir et à qui l'église n'ose pas les refuser (61): pour eux, le vasselage et le serment de fidélité prêté au saint (62) ne sont guère que des formalités, ou du moins ne représentent pas leur vraie relation avec lui. Les autres, au contraire, sont des hommes non libres sur lesquels l'église exerce une autorité plus réelle, et dont elle fait des vassaux pour avoir en eux des défenseurs. L'armée épiscopale était ainsi composée d'un double élément, que les chartes ont soin de distinguer: les premiers sont les hommes libres (liberi homines), les propriétaires d'alleux qui se font accorder des fiefs; de l'autre, ce sont des gens de l'église (homines de familia, ou hommes ecclesiastici, ou ministeriales) (63). Mais ces deux catégories, si distinctes à l'origine, tendent à se fondre rapidement; dès le XIIIe siècle elles n'en forment plus qu'une seule, celle des barons et chevaliers. Tous seront nobles sans distinction d'origine, ennoblis par le fief et par le service militaire qu'il implique.
Disséminés sur toute l'étendue du domaine ecclésiastique ou groupés dans les villes et les bourgades, ces vassaux formaient l'élément militaire de la nation. Exclusivement préoccupés de leurs intérêts de caste, ils étaient pour l'évêque aussi dangereux qu'utiles. Ils aimaient à intervenir dans toutes les affaires publiques, principalement dans les élections épiscopales, pour favoriser les candidats desquels ils attendaient des augmentations de bénéfices (64). Ils ne cessaient d'en réclamer, de s'en faire accorder par l'évêque de gré ou de force (65). Les chroniqueurs du temps ne tarissent pas sur leurs exactions, leurs rébellions. A Cambrai, où le pouvoir épiscopal fut de tout temps désarmé vis-à-vis d'eux, les évêques eurent beaucoup à souffrir de leur insolence. Bérenger et Ansbert durent recourir l'un et l'autre à la protection du comte de Flandre (66); quant à Theudon (972-976), il fut littéralement mystifié par eux, et son pontificat lui devint tellement insupportable qu'un beau jour il se sauva pour retourner dans sa chère Cologne (67). Il n'allait pas si mal partout, mais partout les vassaux ecclésiastiques étaient prépondérants dans les diocèses, et tout pouvoir avait besoin de leur adhesion (68).
Ce qui faisait la force et l'audace de tous ces vassaux vis-à-vis de leurs suzerains, c'est que, depuis un siècle environ, ils étaient retranchés et protégés contre tout venant. Au cours des invasions des Normands, le besoin de la défense avait fait surgir partout, sur les hauteurs abruptes, dans les plaines marécageuses, des châteaux-forts qui, en cas de détresse, servaient de refuge non seulement au seigneur, mais à toute la population des environs, souvent même à des monastères entiers qui s'y réfugiaient avec les châsses de leurs saints. Le danger passé, le pays se trouva hérissé d'une multitude de bastilles qui, après l'avoir défendu contre l'ennemi, protégèrent désormais les feudataires contre leurs voisins et contre leur prince. La puissance de l'aristocratie féodale s'en trouva accrue démesurément, et rien ne contribua plus à détraquer les rouages de l'administration, à modifier les cadres des divisions territoriales. Aussi le mouvement de construction de châteaux-forts, loin de se ralentir après la période des invasions, continua-t-il avec plus d'entrain que jamais. Pendant un siècle environ, de 880 à 980, il surgit de terre une multitude de donjons féodaux (69). Non seulement chaque seigneur voulait avoir le sien, mais certains en possédaient un bon nombre (70). On peut dire que dans les Pays-Bas, et en particulier sur les bords inférieurs du Rhin et de la Meuse, ce sont les châteaux-forts qui sont les clefs de toutes les situations politiques (71). C'est là que se passent à peu près toutes les scènes de la résistance des vassaux à leurs suzerains. Régnier au Long Col à Durfoz, Giselbert à Harbure et à Chèvremont, les fils de Régnier à Boussoit, Baudouin IV à Gand, tiennent tête aux rois et aux empereurs (72).
Ces rois, qui bâtissaient eux-mêmes nombre de châteaux, n'avaient pas de plus grand souci que d'abattre ceux de leurs vassaux. Le mot d'ordre de la royauté du Xe siècle, comme celui des révolutionnaires du XVIIIe siècle, c'est guerre aux châteaux! Dès 864, par le capitulaire de Pitres, Charles le Chauve avait ordonné à ses comtes de détruire les châteaux-forts de leurs circonscriptions et défendu d'en bâtir de nouveaux (73). Et cette politique fut celle de tous les princes qui entendaient régner: du roi Lothaire, que nous voyons abattre un château-fort sur la Chiers (74); de son fils Louis V, qui somme l'archevêque de Reims de détruire ses châteaux de Mouzon et de Mézières, bien que situés en terre d'Empire (75), de saint Brunon qui, préposé au gouvernement général de la Lotharingie, ne trouva pas de moyen plus efficace pour y rétablir l'autorité royale que dc faire abattre les châteaux (76). Ce qui prouve jusqu'à quel point les mesures prises par saint Brunon entraient dans le vif des difficultés politiques, c'est qu'elles déterminèrent en Lotharingie un soulèvement général, auquel s'associèrent même ceux des vassaux qui avaient été jusqu'alors les plus fidèles (77).
Les évêques se firent les agents énergiques de la politique royale, dont, en l'occurence, les intérêts se confondirent avec les leurs. Tout en bâtissant des châteaux là où ils le pouvaient, ils ne cessèrent de travailler à abattre les bastilles féodales.
C'est certes une page bien curieuse de l'histoire du temps, celle qui nous montre ces princes crossés et mitrés qui montent à l'assaut des donjons, en attendant que, plus heureux, ils trouvent dans la création des Trêves-Dieu un emploi non moins efficace, mais plus digne d'eux, de leur zèle pastoral. La plupart des évêques de ce temps sont des briseurs de bastilles; je citerai notamment Adalbéron II de Metz (78), Adalbéron de Reims (79), Rothard de Cambrai (80).
Or, les bastilles ne manquaient pas au pays de Liège. Elles hérissaient les hauteurs abruptes du Condroz et de l'Ardenne, elles abondaient dans les plaines marécageuses de la Hesbaye (81). Les prédécesseurs de Notger, enserrés de toutes parts dans le cercle de fer qu'elles traçaient autour d'eux, avaient été littéralement à la merci des châtelains, et, si les annales de ce temps étaient plus explicites, elles nous feraient assister à bien des scènes de violence et d'iniquité impunies. En 933, Richaire se crut assez fort pour entreprendre de mettre à la raison un de ces rebelles, et il alla en personne démolir le château qu'un certain Bernard avait bâti à Arches (aujourd'hui Charleville), dans le comté de Porcien, sur une terre appartenant à l'église de Liège (82).
Mais, pour un ou deux succès de ce genre, que l'annaliste n'aurait pas enregistrés s'ils ne se présentaient à lui comme des faits extraordinaires et exceptionnels (83), que de rencontres dans lesquelles l'autorité du roi et celle de l'évêque, son représentant, étaient foulées aux pieds! L'édit de saint Brunon ne fut certainement pas exécuté, ou ne le fut que d'une manière partielle dans le diocèse de Liège, s'il en faut juger par l'exemple que voici. En 955, un certain comte du nom d'Etienne, dans lequel on s'accorde à voir un ascendant de la maison de Chiny, avait bâti le château de Mirwart sur une terre que l'abbaye de Saint-Hubert revendiquait comme sienne (84). Mirwart, malgré l'édit de 939, resta debout; Ie comte Etienne se contenta de dédommager l'abbaye pour le tort qu'il pouvait lui avoir causé, et c'est seulement au milieu du XIe siècle que la forteresse fut détruite au cours de la lutte entre le duc Godefroi IV et l'empereur Henri III (85), pour être d'ailleurs rebâtie quelques années ensuite.
Les féodaux étaient donc à peu près les maîtres des terres épiscopales, et il est naturel qu'ils aient considéré la dignité épiscopale elle-même comme une proie qui leur était réservée. Ce qui se passait vers cette époque à Rome, où, depuis le milieu du IXe siècle, la tiare pontificale était livrée à toutes les rivalités de l'aristocratie, se retrouvait en petit dans les diocèses. Il y avait longtemps qu'à Liège les grandes familles du pays se transmettaient l'une à l'autre les insignes épiscopaux. Walcaud sortait d'un riche lignage de la Famenne (86): Hartgar était certainement de haute naissance; Francon appartenait à la noblesse et avait fréquenté l'école du palais; Etienne, son successeur, était apparenté aux Carolingiens.
A partir du jour où la Lotharingie fut rattachée à l'Allemagne (923), il n'en alla plus ainsi. La dynastie était forte et avait conscience de ses droits; elle se rendait compte de l'importance politique des évêques, et elle se réserva de les choisir elle-même. Ce furent alors des personnages étrangers au pays, ou du moins à son aristocratie, qui occupèrent successivement le siège de saint Lambert. Les rois en pourvurent tour à tour Hugues, abbé de Saint-Maximin de Trèves, Farabert, abbé de Prüm dans le même diocèse, Rathier, né, il est vrai, dans le pays, mais issu de petite noblesse.
Comme on peut le croire, les grands ne se résignèrent pas à être évincés de cette manière systématique. Profitant des troubles qu'avait suscités en Lotharingie la révolte du duc Conrad (954), ils déterminèrent un soulèvement à Liège pendant l'absence de l'évêque, et ils introduisirent à sa place Baldéric, un parent de Régnier au Long Col et du duc Giselbert (955). Le coup était d'une hardiesse sans pareille, et il trahissait l'intention de faire retomber toute la Lotharingie sous le joug de cette famille puissante qui avait tant de fois trahi le souverain et balancé son autorité. Toutefois, aux prises avec des difficultés presque inextricables, et tremblant qu'une attitude plus résolue ne poussât les séditieux à quelque mesure désespérée, Brunon crut prudent de céder: il sacrifia à regret Rathier et laissa Baldéric prendre possession du siège (87), après avoir obtenu des grands la promesse qu'à ce prix ils défendraient avec zèle les intérêts de l'Église et ceux de l'empereur (88). L'épiscopat de Baldéric fut digne, au surplus, de son origine: il livra le diocèse à ses parents, à son oncle, Régnier de Hainaut, surtout, et l'on se souvint longtemps à Lobbes des déprédations et des violences de ce dernier (89).
La mort précoce de Baldéric, arrivée le 20 avril 939 (90) fut pour l'archevêque de Cologne l'occasion d'une revanche impatiemment attendue: il en profita jour donner l'évêché de Liège à un de ses compatriotes saxons, le savant Eracle, prévôt de l'église. de Bonn. L'aristocratie lotharingienne, qui venait d'être humiliée dans la personne de Régnier au Long Col, arrêté comme coupable de haute trahison, ne put ou n'osa s'opposer à la nomination, et, de nouveau, la royauté eut sur le trône pontifical de Liège un sujet fidèle à la place d'un vassal remuant. Eracle, il est vrai, ne connut guère de sa haute position que les angoisses et les épreuves. Savant distingué pour son époque et professeur admirable, il ne parait pas avoir possédé au même degré les qualités de l'homme de gouvernement. Il vit les terres de son église pillées et confisquées par les grands seigneurs sans pouvoir s'opposer à leurs déprédations, et, privé de ses revenus, se trouva plus d'une fois dans la détresse. Il faillit même partager finalement la destinée de son prédécesseur et ancien maître Rathier: un jour, déchainée sans doute par les grands, une émeute furieuse assaillit son palais épiscopal sur le Mont Saint-Martin, à Liège; les tonneaux (91) de cave furent défoncés, et des flots de vin de Worms rouge coulèrent jusque dans la Meuse, qui baignait le pied de la colline. Telle fut la première émeute dont l'histoire de la ville de Liège fasse mention. L'évêque, ajoute le chroniqueur, supporta patiemment ces épreuves et ne chercha pas à tirer vengeance des rebelles: apparemment, il y avait dans cette longanimité autant d'impuissance que de vraie mansuétude.
De tout ce qui vient d'être dit, on peut déduire quelle était vers le milieu du Xe siècle la situation des évêques de Liège. Ce sont des grands seigneurs entourés de toute une armée de vassaux à fidélité incertaine, désarmés comme princes et comme évêques, et dont le pouvoir a plus d'éclat que de solidité. Ils sont à la merci de leurs grands: sont-ils choisis sans l'aveu de ceux-ci, on leur rendra la vie impossible. On se permettra tout vis-à-vis d'eux, on dépècera graduellement le patrimoine de leur église, on leur substituera, si l'on peut, des usurpateurs laïques qui, comme Albéric l'a fait à Rome, géreront à leur gré le patrimoine de leur église.
Assurément, ce ne sont pas là des conditions favorables à l'éclosion d'une puissance ecclésiastique, et si l'on avait dû, à cette époque, pronostiquer l'avenir du pays de Liège, on se le serait figuré plutôt sous l'aspect d'une interminable anarchie féodale de laquelle aurait émergé, finalement, la prépondérance de quelque grand seigneur laïque. Il fallait, pour changer la tournure des événements, une force capable de réagir puissamment et de donner à la politique royale un appui solide dans le Lothier. Cette force s'appelait Notger.
|
NOTGER AVANT L'ÉPISCOPAT

Sceau de Otton I
Nous ne savons presque rien de l'origine et de la jeunesse de Notger (92). Son histoire ne commence, à proprement parler, que le jour où, dans la pleine maturité de l'âge, il monta sur le siège épiscopal de Liège. Des témoignages contemporains parfaitement dignes de foi nous apprennent qu'il était né en Souabe (93), et son biographe ajoute qu'il était de noble extraction (94). Il n'y a pas lieu de révoquer en doute ce dernier renseignement: à l'époque où vivait Notger, ce n'est guère qu'à titre exceptionnel que des hommes d'origine plébéienne revêtaient les insignes pontificaux (95), et les chroniqueurs avaient grand soin de relever la noblesse du sang de leurs héros (96).
A Liège même, il n'y eut à cette époque que Durand (97) et Wazon (98) qui fussent de petite naissance, et l'on s'émerveilla longtemps de voir la crosse épiscopale dans les mains de Durand (1021-1025), qui était d'origine servile et qui avait eu pour seigneur le prévôt de sa propre cathédrale (99).
Mais, si la noblesse de Notger n'est pas douteuse, la généalogie que lui ont forgée divers chroniqueurs peu dignes de foi doit être reléguée dans le domaine des fables. (100) La manie cyclique, si je puis m'exprimer ainsi, qui a porté les poètes épiques de tous les temps à rattacher entre eux les héros populaires par des liens de parenté, nos chroniqueurs, dont les procédés ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux des poètes, en ont été possédés aussi, et nul n'y a plus largement payé son tribut que le bon Jean d'Outremeuse, auteur responsable de toutes les fictions qui depuis cinq siècles font de l'histoire du pays de Liège un champ de broussailles. Bornons-nous à constater que la famille de Notger nous reste totalement inconnue: elle était noble et elle habitait la Souabe, voilà tout ce que nous avons le droit d'affirmer.
Ce n'est que par les conjectures que l'on peut arriver à fixer très approximativement la date de la naissance de Notger, aucun document ne nous fournissant à ce sujet la moindre indication. Mort en 1008, après trente-six ans d'épiscopat, il était, selon toute apparence, un homme d'âge mûr quand il devint évêque, et il n'est pas téméraire de lui attribuer une quarantaine d'années en 972, ce qui reporterait sa naissance aux environs de 930. II y aurait lieu de reculer notablement cette date, si l'on devait reconnaître Notger dans le Notkerus notarius qui, le 7 avril 940, à Quedlinburg, procéda à la place de l'archichancelier à la récognition d'un diplôme d'Otton I voue l'abbaye de Saint-Gall (101). Mais il est à peine besoin de faire remarquer qu'à ne donner à ce notaire qu'un âge de 25 ans - chiffre bien minime pour l'importance des fonctions qu'il r'emplit - il faudrait, si on voulait l'identifier avec l'évêque de Liège, faire naître celui-ci en 915 et le faire mourir à 92 ans. Or, si l'on réfléchit que jusque dans les dernières années de sa vie, Notger déploya une activité presque juvénile, qu'il fit son dernier voyage d'Italie en 997, qu'il y remplit des missions importantes et qu'on le trouve encore en 1007 au plaid impérial de Mayence, on sera d'accord pour reconnaître que cette conjecture est hautement improbable. Le notaire Notkerus qui a rédigé le diplôme du 7 avril 940 n'est qu'un notaire de circonstance qui ne reparaît plus dans la chancellerie d'Otton I; tout indique que son rôle est purement local, occasionnel, et ce n'est pas s'aventurer que d'attribuer la paternité de l'acte qui porte son nom à Notger le médecin, surnommé Grain de Poivre, qui, en 940, florissait à l'abbaye de Saint-Gall (102).
On ne sait où le futur évêque de Liège fit ses études. Une source à peu près contemporaine laisse entendre que ce fut à Saint-Gall, puisqu'elle dit que Notger fut moine et même prévôt de cette maison (103). Mais quelque valeur qu'il faille attribuer aux Annales de Hildesheim, ce renseignement est fort sujet à caution. Anselme (104), qui a ici une bien autre autorité, ne sait rien des fonctions monastiques remplies par Notger avant son épiscopat, et il est peu probable qu'il aurait omis de signaler une circonstance si importante à son point de vue. Quant au Vita Notgeri, il contredit implicitement les Annales de Hildesheim en nous apprenant que Notger, ayant brillé dans ses études dès ses plus tendres années, mérita d'être transféré de l'école au palais des empereurs (105). On ne peut guère nier qu'Anselme et l'auteur du Vita aient été mieux renseignés au sujet de la jeunesse de leur héros qu'un auteur qui écrivait à une assez bonne distance et de Saint-Gall et de Liège, et qui, n'ayant pas le même intérêt à se renseigner d'une manière exacte sur le point qui nous occupe, a fort bien pu se tromper ici. Selon toute apparence, il aura confondu l'évêque de Liège avec l'un des trois personnages de Saint-Gall qui ont rendu le nom de Notger célèbre dans l'histoire littéraire du moyen-âge (106). Entre ce nom et celui de leur abbaye, il avait comme une association d'idées qui évoquait naturellement l'un quand on rappelait l'autre, si bien que prononcer le nom de Notger, c'était faire penser à Saint-Gall. Encore au XVIe siècle, nous voyons que le plus illustre érudit monastique du temps, Tritheim, s'y est laissé prendre; il confond totalement l'évêque de Liège avec l'abbé Notger-le-Bègue, et, greffant une erreur chronologique sur cette confusion de personnes, il fait mourir ce double personnage en 850 (107)! Si une telle confusion a pu être faite par un homme à qui son érudition fournissait tant de moyens de contrôle, à combien plus forte raison ne s'explique-t-elle pas chez l'annaliste de Hildesheim, qui ne disposait pas de ces moyens d'information et que personne ne pouvait corriger en temps utile!
Mais, si nous devons renoncer à croire avec les Annales de Hildesheim que Notger a été prévôt de Saint-Gall, pouvons-nous conserver une partie quelconque de son information et admettre tout au moins que Notger a fait ses études dans cette célèbre maison? Je crois que rien ne serait plus contraire aux règles d'une bonne critique. Si le renseignement est le résultat d'une méprise, il disparait tout entier (108). Qu'après cela on admette, pour des raisons purement internes et d'ailleurs peu probantes, que Notger a étudié à Saint-Gall (109), je ne m'y opposerai pas, encore bien qu'on puisse croire avec la même vraisemblance que c'est à Reichenau ou dans n'importe quel autre monastère de la Souabe.
S'il n'est nullement établi que Notger ait jamais été moine à Saint-Gall, il est absolument faux qu'il ait été écolâtre de Stavelot. C'est Fisen qui a le premier avancé cette assertion, soutenant même que, d'abord moine à Saint-Gall, Notger fut appelé ensuite à Stavelot, où il dirigea les écoles pendant huit ans, et que de là il retourna à Saint-Gall pour prendre en mains la direction de l'abbaye (110). Je crois savoir où Fisen a pris ce petit roman, que Mabillon, sans se prononcer sur le fond, a précisé en ajoutant, par voie de conjecture chronologique, que dans ce cas Notger aura été appelé à Stavelot par l'abbé Odilon (111). Fisen a trop bien lu son Tritheim. Celui-ci avait, par erreur, attribué à Notger la première Vie de saint Remacle, écrite au IX siècle; Fisen, constatant que cette Vie a été écrite à Stavelot, en a tiré la conclusion que Notger avait été moine de cette abbaye (112). La conclusion est très naturelle, mais la prémisse était fausse. Notger n'étant pas l'auteur de la première vie de saint Remacle, les déductions de Fisen croulent avec l'hypothèse de Tritheim (113).
Ce qui parait probable, c'est que Notger n'a jamais été moine. Aucun trait monastique ne reparaîtra plus tard dans sa physionomie. Ses fondations religieuses seront toutes exclusivement réservées au clergé séculier; ce grand bâtisseur ne fondera pas un seul monastère, il ne terminera pas même celui de Saint-Laurent, laissé inachevé, aux portes de sa ville épiscopale, par son prédécesseur immédiat, et l'on verra que c'est par erreur qu'on lui a attribué la fondation des prieurés clunisiens de son diocèse. Et lorsque, plus tard. il voudra connaître le charme de ces heures bénies dans lesquelles l'âme se dérobe à toutes les préoccupations du monde pour ne vivre qu'en Dieu, ce n'est pas derrière les murailles d'un monastère, c'est dans le cloître de sa chère collégiale de Saint-Jean, à Liège, qu'il se retirera. S'il a été assis, dans son enfance, sur les bancs de quelque école monastique de la Souabe, ce n'a dû être que pour y faire ses premières études.
On ne sait comment il attira sur lui l'attention de l'empereur ou peut-être de saint Brunon (114), qui l'appela ou le trouva à la chancellerie impériale. Il n'est pas le seul exemple d'un clerc passant du cloître au palais, pour échanger ensuite le palais contre un siège épiscopal. La chancellerie allait même prendre dans leur cellule des moines, comme Boson, moine de Saint-Emmeram de Ratisbonne, qui après son service à la chancellerie, fut nommé ensuite, en 970, évêque de Mersebourg (115). Le second successeur de Notger, Walbodon, eut une carrière semblable à celle de Boson: sa jeunesse s'était écoulée à l'ombre du cloître de Saint-Martin d'Utrecht, où il s'éleva même aux fonctions de prévôt; l'empereur Henri III l'arracha malgré lui à ce doux nid pour l'attacher à sa chancellerie, et lorsqu'en 1018 le siège épiscopal de Liège fut devenu vacant, il l'y fit monter (116).
La chancellerie impériale était si bien le vestibule de l'épiscopat qu'Anselme croit devoir dire que lorsque Wazon y entra, il le fit sans intention d'acquérir un évêché (117). Et comme il n'y était resté que neuf mois, les courtisans voulurent s'opposer à sa nomination, alléguant qu'il ne méritait pas un tel honneur, puisqu'il n'avait jamais peiné à la cour du roi (118).
Notger, à la chancellerie, fut le collègue de Willigis, le futur archevêque de Mayence, de l'intrigant Giselbert de Mersebourg (119) et du célèbre Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, l'une des plus fortes têtes de ce siècle. La chancellerie exigeait des hommes sûrs et des esprits cultivés: Notger s'y distingua, c'est Otton III qui l'atteste (120), et les fonctions épiscopales que lui confia Otton I sont la preuve éloquente que ce prince fut content de ses services.
Nous ne savons d'ailleurs pas autre chose de cette part de la carrière de Notger. Il en serait autrement si l'on pouvait se fier à une indication d'Ughelli. D'après cet érudit, chapelain impérial, qu'il nomme Norticherus, fut, en 954 détaché par l'empereur Otton I d'auprès de sa personne; pour aller à Gaëte apaiser un conflit qui avait éclaté entre l'évêque Bernard et une partie de la population. Le document sur lequel Ughelli s'appuie est une lettre des ouailles de Bernard à leur évêque, dans laquelle elles rappellent qu'Otton I avait délégué, en qualité de missus, son chapelain, un clerc du nom de Norticherus, qui vint à Gaëte, à Traetto et Argenti, et devant lequel fut jugé tout le débat (121). Plusieurs historiens (122) ont vu dans ce personnage le futur évêque Liège. Mais il est établi aujourd'hui que le diplôme auquel Ughelli donne la date de 954 est en réalité de 999 (123). Il faut donc biffer de l'histoire de Notger le seul épisode qui nous donnât l'espoir de jeter quelque lumière sur les premières années de sa carrière publique (124).
C'est seulement en gravissant les marches du trône épiscopal de Liège que le grand homme dont nous retraçons l'existence devait émerger des ténèbres du Xe siècle. Au témoignage de nos sources, il passa directement de la chancellerie impériale sur le siège épiscopal (125), et il est parfaitement superflu de réfuter ici Jean d'Outremeuse, qui croit savoir qu'il fut d'abord chanoine de Saint-Lambert et que pendant deux ans il remplit les fonctions d'archidiacre de Campine (126).
Le siège avait été laissé vacant le 28 octobre 971 par la mort de l'évêque Eracle (127). On sait comment, en pareille occasion, les choses se passaient dès le temps d'Otton I. Le clergé de l'église veuve portait la crosse du défunt à l'empereur (128), et celui-ci faisait choix, pour lui succéder, d'un personnage à son gré. D'ordinaire il le prenait parmi les clercs de sa chancellerie, qui, attachés à sa personne et initiés à sa politique, lui semblaient présenter des garanties supérieures. Il faisait ensuite connaître son choix à l'église intéressée, et celle-ci s'empressait d'élire à son tour l'homme qui était déjà l'élu du roi. Parfois, sans attendre que le souverain lui manifestât sa volonté, le clergé de l'église veuve se réunissait, faisait un choix canonique, et envoyait prier le souverain de le ratifier (129). A prendre à la lettre les paroles du Vita Notgeri, on serait tenté de croire que c'est ce dernier procédé qui a été suivi pour l'élection de Notger. C'est, dit-il, à la demande du clergé et du peuple et par la faveur du prince que Notger passa du palais impérial au siège épiscopal de Liège. Mais les formules de ce genre étaient en quelque sorte de style, et pouvaient fort bien se concilier avec le cas d'une désignation royale antérieure, suivie d'une élection pro forma par le clergé et le peuple du diocèse. Ceux-ci, en effet, après avoir procédé à l'élection, en demandaient encore la confirmation au roi, tout comme s'ils n'avaient pas connu les intentions de celui-ci. Il est d'ailleurs bien peu probable que, si l'église de Liège avait eu l'entière liberté de son choix, elle eût jeté les yeux sur un étranger, qu'elle ne connaissait pas et dont peut-être elle ignorait même l'existence. Il y a donc lieu de croire que lorsqu'elle apprit le nom de l'évêque qu'on lui destinait, elle s'empressa de se conformer à la volonté royale en portent sur lui ses suffrages.
Ce fut au mois d'avril 972 que Notger fut consacré évêque dans l'église de Bonn, par les mains de son métropolitain Géron de Cologne. Toutes les sources sont unanimes sur l'année (130), et cette date s'accorde avec les autres témoignages. En premier lieu, avec la date de la mort d'Eracle, que nos documents, comme on vient de le voir, placent au 28 octobre 971. En second lieu, avec le chiffre de 36 ans de pontificat que les deux meilleures sources de l'histoire de Notger attribuent à ce prélat (131). En effet, Notger étant mort le 10 avril 1008, il a bien gouverné 36 années si l'on fait commencer son pontificat au printemps de 972. En troisième lieu, avec le témoignage, concluant à coup sûr, de Notger lui-mène, qui, le 19 juin 980, écrivant à l'abbé Womar de Gand, dit être dans la neuvième année de son pontificat (132). Cela est absolument exact si nous faisons courir la première année du pontificat de Notger à partir d'avril 972, et ne l'est plus si nous admettons une autre année.
Les Annales de Lobbes ont voulu nous apprendre le jour précis de la consécration, et elles le font en ces termes: 972. Dominus noster Notkerus mense aprili octavis paschae et 9 kalend, maii apud Bonnam a domino Gerone archiepiscopo instituitur Leodicensium episcopus.
Cette indication est contradictoire. En 972, l'octave de Pâques tombait le 14 avril et non le 23 (9 kal. maii), comme le veulent les Annales de Lobbes. C'est en 971 qu'elle coincide avec le 23 avril. L'erreur est facile à expliquer. L'annaliste, qui semble avoir puisé à de bonnes sources, y a lu que Notger fut consacré en 972, le jour de l'octave de Pâques. En cherchant dans sa table pascale le jour du mois qui correspondait à cette indication liturgique, il aura, par mégarde, lu une ligne trop haut, et sera tombé sur le jour qui correspond à l'octave de Pâques 971. Voilà l'explication toute simple d'une difficulté qui était, dans tous les cas, le résultat d'une erreur, et qui disparaît si l'on parvient à découvrir l'origine de celle-ci.
Est-il besoin, après cela, de réfuter longuement l'opinion des érudits qui, dans le témoignage des Annales de Lobbes, se sont attachés surtout à la date du 23 avril, et qui, voyant qu'elle ne concorde qu'avec 971, ont imaginé de placer en cette dernière année le couronnement de Notger? Nous ne le pensons pas, bien que cette date ait rallié le suffrage de plusieurs érudits (133). Pour l'adopter à notre tour, il nous faudrait corriger tous les annalistes qui font mourir Eracle en 971, et placer sa mort en 970; il nous faudrait ensuite donner un démenti à toutes les sources qui nous racontent l'avénement de Notger. Qui ne voit qu'au lieu d'un tel tissu de conjectures il est bien préférable de suivre les sources pas à pas, comme fait Foullon (134).
Nous concluons donc, en ne faisant subir à notre principale source qu'une modification très-légère, que Notger a été consacré à Bonn, le 14 avril 972, jour qui coïncidait cette année avec celui de l'octave de Pâques.
Le nouvel évêque de Liège héritait d'une situation troublée. Le pontificat de son prédécesseur avait été attristé par l'émeute. Lui-même, nouveau venu et étranger dans le pays, il ne savait pas la langue d'une moitié de ses ouailles (135), et, quant à l'autre, il ne pouvait s'adresser à elle que dans le dialecte haut-allemand, fort différent du thiois parlé dans les Pays-Bas. Il appartenait d'ailleurs à une peuplade qui était l'objet, de la part des autres Allemands, de lazzi sans nombre. Les Souabes avaient chez les Allemands du Nord la réputation que les Gascons ont en France: hâbleurs avec l'esprit en moins et une certaine lourdeur en plus. Anselme écrit en termes formels, au début de la notice qu'il consacre à Notger: « C'était, à la vérité, un Souabe, mais, pour le reste, un homme des plus distingués (136) ». Et l'on entendra plus tard un seigneur liégeois, en querelle avec son évêque, lui reprocher sa mauvaise foi de Souabe » (137).
Mais même s'il n'eût pas été Souabe, il était étranger, et ce défaut devait lui être difficilement pardonné par une noblesse remuante et ambitieuse qui voulait voir dans la dignité épiscopale l'apanage de ses cadets, et qui, dans les vingt dernières années, avait chassé un évêque et troublé le pontificat d'un autre.
|
CHAPITRE IV.
PREMIERE ANNÉE D'ÉPISCOPAT.
La carrière de Notger ne s'annonçait pas riante, on vient de voir pourquoi.
Etranger comme Eracle, et, comme lui, représentant au milieu d'une aristocratie turbulente le pouvoir impopulaire de la royauté, il pouvait s'attendre à passer par des expériences semblables à celles de ses prédécesseurs. Mais Notger possédait à un degré éminent les qualités qui avaient manqué à Rathier et à Eracle. II se distinguait du premier par un tact et par une prudence qui conjurèrent plus d'un conflit, et du second, par une énergie de fer qui avait raison des résistances les plus déterminées. Au surplus, s'il rencontra des difficultés, ce fut surtout dans le début de sa carrière, lorsqu'il eut à recueillir l'héritage quelque peu dangereux d'Eracle, puis encore après la mort d'Otton II (983), pendant les quelques années si orageuses qui ouvrirent le règne d'Otton III.
Son épiscopat n'aurait pas été si merveilleusement fécond en oeuvres de paix, s'il avait été constamment troublé par l'anarchie féodale, et si le grand bâtisseur et le grand pédagogue avait dû souvent échanger la truelle ou la férule contre l'épée.
Planter et arracher, tel fut, selon l'énergique expression d'une de nos sources, le programme du pontificat de Notger, et ce programme fut rempli (138). Notger déploya une grande énergie dans la répression des abus et dans la soumission des rebelles.
« II fut, dit Anselme, terrible pour les riches orgueilleux, redoutable pour les hommes factieux et iniques ». (139) - « Par la vigueur de sa justice, dit de son côté l'auteur du Vita Notgeri, il brisa l'obstination de ceux qui avaient troublé les jours d'Eracle, et leur infligea de justes châtiments, jusqu'à ce qu'il eut obtenu leur correction complète. Il avait deux armes dans la main: l'anathème spirituel et la répression par la force; il les mania l'une et l'autre » (140). Enfin, l'auteur du poême anonyme résume en quelques mots sa carrière de justicier « Tous ceux qui troublaient l'ordre étaient d'abord frappés de l'anathème et exclus de la communion; s'ils refusaient de s'amender, ils devaient partir pour l'exil. Les incorrigibles étaient ou pendus, ou mutilés. Il était sans pitié pour les parjures, les voleurs, les brigands; nul d'entre eux ne pouvait paraître devant lui (141). »
On le voit, nos sources sont d'accord sur l'énergie déployée par Notger dans sa lutte contre les perturbateurs, et, si ceux-ci ne sont pas désignés plus expressément, c'est parce que personne, au moment où écrivaient ces auteurs, nul ne pouvait s'y tromper. Il s'agissait de membres de l'aristocratie. Anselme, qui les désigne comme des riches orgueilleux, ne laisse pas de doute à cet égard, et l'auteur du poème anonyme, en parlant de séditieux qui sont d'abord frappés d'anathème et ensuite envoyés en exil, est au fond d'accord avec Anselme. Et lorsque le même auteur fait allusion à la peine de la hart ou de la mutilation réservée aux coupables, il vise apparemment la tourbe des individus de bas étage que les grands avaient à leur service, et qui organisaient les émeutes comme celle qui fit tomber Rathier, ou celle qui menaça du même sort l'autorité d'Eracle. En somme donc, malgré le vague et l'imprécision peut-être intentionnelle de leurs expressions, nos sources principales ne laissent pas de lever discrètement le voile qui couvre la partie la plus orageuse et la plus délicate de la carrière de Notger: ses luttes pour forcer les grands seigneurs à reconnaîttre l'autorité du prince légitime, et à respecter les droits de l'Eglise et ceux de la population désarmée (142).
Un épisode plus fameux dans la légende que dans l'histoire nous fait connaître le nom d'au moins un des châteaux-forts dont l'évêque de Liège parvint à se débarrasser pour la plus grande sécurité des habitants de sa ville : c'est celui de Chèvremont. Situé à sept kilomètres en amont de Liège, dans la pittoresque et profonde vallée de la Vesdre, ce château était bien le plus redoutable voisin de nos princes. On voyait, des portes de la ville, sa sombre silhouette se profiler à l'horizon, et plus d'un évêque de Liège eût pu dire ce qu'au rapport de Suger, Philippe I, roi de France, disait à son fils Louis VI en lui montrant la tour de Montlhéry: « Voilà une tour qui m'a fait vieillir dans les inquiétudes; jamais elle ne m'a permis de goûter une vraie paix (143) ». Du haut de la montagne inaccessible dont les parois descendaient presque verticalement dans la rivière, et abordable seulement par l'isthme étroit qui, du côté du nord, la rattachait au plateau, le château de Chèvremont se dressait comme une menace perpétuelle à l'horizon. Cette vaste et puissante forteresse n'était pas antérieure à l'époque mérovingienne; selon toute apparence, elle avait été bâtie par Pépin de Herstal; au VIIIe et au IXe siècle, elle portait encore le nom de Château-neuf (Novum Castellum). Dans son enceinte était comprise une église Sainte-Marie, desservie par un corps de chanoines réguliers; les rois francs, à partir de Pépin, se plurent à l'enrichir: de leurs libéralités (144). Grifon y fut enfermé en 741 par son frère Carloman (145); l'empereur Lothaire I y résida en 854 et Lothaire II en 862 (146). Dans les premières années du Xe siècle, Chèvremont, (c'est le nom qui dès lors vient remplacer l'appellation de Château-neuf) (147) passa aux mains des ducs de Lotharingie, qui prirent dans nos contrées la place des rois et occupèrent leur domaine. En 922, le château est occupé par le duc Giselbert (148), et, après sa mort tragique en 939, nous y voyons sa veuve réfugiée. Quelque temps après, les derniers tenants de la cause de Giselbert en étaient expulsés par le comte Immon, qui, parait-il, garda la place et qui, révolté à son tour, y tint bon en 960 contre saint Brunon (149). Comme, peu de temps après, il se réconcilia avec l'empereur, et qu'on avait appris à connaitre à la fois et son habituelle fidélité et le danger qu'il y avait à l'aliéner, nous devons croire qu'il aura conservé la paisible possession de ses biens, et que Chèvremont ne lui aura pas été enlevé. Nous savons qu'il vivait encore en 908: c'est donc à tout le moins jusqu'à cette date que le château sera resté entre ses mains (150).
La forteresse passait pour imprenable, et non sans raison, car les flancs abrupts de ses rochers et les parois massives de ses murailles avaient bravé plus d'un annemi. En 882, les moines de Stavelot, fuyant la fureur des Normands, y avaient trouvé un refuge avec les reliques de leur saint (151). En 922, le duc Giselbert y avait tenu tête au roi Charles le Simple (152), en 939, il y avait soutenu l'effort des armées du roi Otton le Grand (153), et depuis lors, comme on vient de le voir, les armes royales l'avaient vainement assiégé à plusieurs reprises: on n'avait pu s'en rendre maitre que par la ruse (154). Telles étaient les annales militaires de la redoutable forteresse (155).
Dès son avènement, nous voyons Notger se préoccuper de ce qu'on pourrait appeler la question de Chèvremont; je crois en trouver la preuve dans le fait suivant. Il était à peine depuis quelques mois sur le siège de saint Lambert qu'un acte impérial, daté de Pavie le 1er août 972, faisait don à l'église Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle de l'abbaye de Chèvremont, c'est-à-dire de l'église annexée au château et comprise dans son enceinte (156). L'intention ici est transparente. L'octroi de l'abbaye de Chévremont à une église étrangère, s'il n'équivalait pas à la sentence de mort du château, en était au moins le prélude. Notger n'avait pas perdu son temps, et ce simple diplôme, où son nom n'est pas même prononcé, témoigne éloquemment, et de son crédit auprès de l'empereur, et de la singulière énergie de sa volonté. Pour le reste, il pouvait attendre, et préparer tranquillement le coup suprême qu'il se proposait de porter à la bastille féodale.
Une autre difficulté, et d'un caractère beaucoup plus urgent, réclama toute la sollicitude de Notger dès les premiers jours de son avènement: c'était la situation critique de l'abbaye de Lobbes. Cette grande maison monastique, qui faisait partie du diocèse de Cambrai, relevait au temporel des évêques de Liège, depuis la donation que l'empereur Arnoul en avait faite, en 888, à l'évêque Francon. Elle avait un domaine immense, qui comprenait en 868-869, lorsque fut dressé son polyptyque, un total de 174 villages, avec le château de Thuin qui lui servait de forteresse et de refuge (157). Ses abbés se glorifiaient d'avoir eu, au VIIIe siècle, le rang et le titre d'évêques (158). Livrée successivement, pendant le IXe siècle, à des abbés laïques de famille princière, elle avait vu sa prospérité religieuse et matérielle déchoir en même temps sous des chefs aussi indignes que Hubert, beau-frère de Lothaire II, Carloman, fils de Charles-le-Chauve, et Hugues, bâtard de Lothaire II (864-885). Les évêques de Liège, devenus les héritiers de ces déprédateurs sans conscience, n'avaient qu'en partie fermé les plaies. Se considérant, de par la donation du roi, comme les abbés du monastère, ils l'avaient gouverné par des prévôts, et pris pour eux la moitié de ses revenus (158). Cette situation dura environ un siècle, et, au témoignage des écrivains du lieu, elle fut désastreuse pour la discipline et pour la prospérité de l'abbaye.
Tout fut à vendre sous des prélats comme Richaire et Farabert, qui, bien qu'ayant été moines eux-mêmes, gouvernèrent dans un sens bien peu monastique (159). Les choses en vinrent à un état de crise aiguë lorsque l'évêque Baldéric I eut envoyé de Gembloux le prévôt Erluin, qui, déjà suspect à cause de son origine étrangère et de son accointance avec le comte Régnier de Hainaut, se rendit bientôt odieux aux moines de Lobbes par sa sévérité outrée. Erluin, vénéré comme un saint à Gembloux, faillit laisser la vie sous les coups de ses religieux exaspérés, qui lui arrachèrent les yeux et lui coupèrent la langue. Ces choses se passaient vers 958 (160). Instruit par de pareilles expériences, et pacifique en toutes choses, Eracle avait rendu à Lobbes ses abbés, et cet acte, en y affermissant l'autorité, y avait ramené le calme (161). L'abbé Alétran avait eu un règne paisible et prospère, et l'abbatiat de son successeur Folcuin avait commencé sous les meilleurs auspices, lorsque le retour au pays d'un ancien moine de la maison, le fameux Rathier, déchaina de nouveaux orages. L'évêque détrôné voulut se refaire un petit royaume dans ce coin de terre qui avait été l'abri de sa jeunesse; il y eut bientôt son parti, il parvint, à ce qu'il parait, à gagner Eracle lui-même, et l'abbé Folcuin n'eut plus qu'à céder le terrain à son remuant rival, qui s'installa aussitôt à Lobbes comme dans son héritage (162).
Les choses en étaient là lorsque Eracle mourut, laissant à Notger une situation aussi embrouillée à Lobbes qu'à Liège. Mais Notger était à la hauteur de toutes les difficultés. La pacification de Lobbes semble être devenue le premier objet de son activité épiscopale. S'adjoignant une commission qui comprenait, outre quelques moines de Lobbes, les abbés Werinfrid de Stavelot et Heribert de Saint-Hubert, il vint lui-même à l'abbaye pour faire une enquête sur l'origine des troubles. Il ne lui fut pas difficile de la constater, mais il ne devait pas être aussi facile de la faire disparaître. Par quel prodige d'adresse et d'énergie parvint-il, non seulement à réconcilier les moines avec leur abbé, mais encore à décider Rathier à lâcher prise? On ne sait, mais il faut considérer comme un vrai triomphe du génie de Notger d'avoir à tel point apprivoisé ce naturel amer, qu'il se réconcilia avec Folcuin et qu'il se retira de bon gré à l'abbaye d'Aulne. L'abbé reprit possession de son autorité; il nous a raconté lui-même, avec un accent de reconnaissance mêlé d'admiration, tout ce qu'il dut à l'évêque animé du véritable esprit de Dieu (163). En effet, à partir de cette heureuse intervention de Notger, l'ordre ne fut plus troublé à Lobbes, et cette belle abbaye eut désormais des jours de prospérité et d'éclat qu'elle n'avait pas encore connus auparavant. En 973, à la demande de Notger, le nouveau souverain, Otton II, de résidence à Aix-la-Chapelle, fixa la situation de l'abbaye et la prit sous sa protection. La charte impériale consacra les mesures réformatrices de Notger et attesta en même temps que son crédit n'était pas moindre auprès du fils d'Otton I qu'il ne l'avait été auprès du père (164). Au reste, le voyage de Lobbes n'avait pas été sans heureux fruits pour l'évêque lui-même, s'il est vrai, comme on l'a supposé, qu'il fit à cette occasion la connaissance de Heriger (165).
Tous ces soins consacrés au bien de son diocèse n'empêchèrent pas Notger de se trouver, le 17 septembre, au concile national d'lngelheim, où presque tous les évêques du royaume d'Allemagne étaient réunis autour d'Otton I revenant d'Italie. Son nom figure au bas des actes de cette assemblée, sur laquelle nous ne sommes d'ailleurs informés que par un document de valeur douteuse (166).
Ainsi, depuis la mi-avril, date de sa consécration, jusque vers la mi-septembre, c'est-à-dire, en l'espace de cinq mois, le prince avait mis la main, avec un remarquable succès, aux affaires les plus épineuses de sa principauté, et l'évêque avait participé aux préoccupations de l'Église d'Allemagne. En ce court espace de temps, il avait, selon les paroles de son biographe, démoli et édifié, arraché et planté. On pouvait attendre beaucoup d'un pareil début.
|
CHAPITRE V
NOTGER AU SERVICE D'OTTON II

Otton II et Theophano
Si nous avons pu, dans les pages qui précèdent, retracer au moins en partie la première année du pontificat de Notger, ce n'est là qu'une heureuse exception: les sources ont oublié, le plus souvent, de dater les principaux faits par lesquels s'est manifestée sa vaste activité, et nous devrons nous contenter, en général, de les classer dans un ordre logique. L'ordre chronologique n'apparaît que dans ceux de ses actes qui ont été consacrés au service des princes, parce que ceux-là nous sont connus par des diplômes et par d'autres documents datés. Cette différence dans le degré de précision des dates de la carrière de notre héros nous oblige à partager en deux parties le tableau de sa vie dans la première, nous exposerons au jour le jour sa participation aux affaires de l'Empire; dans la seconde, nous grouperons sous quelques rubriques générales ses actes de gouvernement et d'administration. Il sera facile au lecteur de constater que cette division n'est las purement formelle: tout au contraire, elle correspond bien exactement à la réalité. Entre le rôle du vassal d'Empire et celui de prince de Liège, il y a une telle ligne de démarcation, qu'on pourrait presque étudier séparément chacun d'eux sans rencontrer l'autre.
Sous les empereurs de la maison de Saxe, un évêque était, pour ainsi dire, un gouverneur de province. Il était commis par le prince à la garde des intérêts royaux dans sa région. Il avait pour tache d'y faire respecter l'autorité de son maitre, de l'informer de tout ce qui s'y passait, d'y combattre par tous les moyens, et au besoin par la force, les ennemis de la couronne. Il continuait d'ailleurs de faire partie de la cour, bien que relégué à un poste éloigné. Il y devait paraître à intervalles périodiques, en qualité de grand vassal fidèle. Il avait aussi l'obligation d'accompagner le prince dans ses expéditions, à moins d'empêchement légitime, et d'y mener les hommes de ses fiefs. Tout cela lui créait des obligations qui n'étaient pas toujours compatibles avec ses devoirs spirituels. Mais, lorsqu'il y avait conflit, c'était ces derniers qui passaient à l'arrière-plan: l'évêque était vassal avant d'être pasteur.
Il faut connaître cette situation si l'on veut se rendre compte du tableau que nous allons dérouler sous les yeux du lecteur dans ce chapitre et dans les trois suivants. Mais il faut en même temps se souvenir qu'il ne fait connaître qu'un des aspects de la carrière de Notger, et n'apprécier celle-ci que lorsqu'on aura envisagé l'autre.
Notger, on l'a vu, occupait depuis une année son siège épiscopal lorsque son bienfaiteur, Otton I, mourut le 7 mai 973. II ne paraît pas qu'il ait reçu à Liège même la visite du jeune Otton II, ce prince, associé au trône du vivant de son père, n'ayant pas eu besoin de faire, comme nouveau souverain, la tournée des diverses provinces de son royaume (167). Mais, du 21 au 26 juillet 973, nous trouvons Otton II à Aix-la-Chapelle, où Notger vint lui faire sa cour, et d'où, à la requête de l'évêque, il émit le diplôme confirmant l'immunité de l'abbaye de Lobbes. Dans ce document, le souverain parle de Notger en termes fort élogieux; il l'appelle le soutien et l'auxiliaire de ses volontés, et l'on voit que ce sont les deux impératrices, Adelaïde et Théophano, qui ont fait au prélat l'honneur d'intervenir en faveur de sa demande (168).
Notger eut bientôt l'occasion de montrer que son jeune maître n'avait pas fait de lui un éloge exagéré. La mort d'Otton I avait rendu courage, un peu partout, aux vassaux rebelles, et notamment, en Belgique, à la remuante famille de Régnier au Long Col. Les deux arrière-petits-fils de ce dernier, Régnier IV et Lambert, étaient rentrés en Lothier dès l'automne de 973, et avaient vaincu et tué, dans une bataille livrée à Pérenne près de Binche, Garnier et Rainald, auxquels Otton I avait donné une partie de leurs biens confisqués (169). Après cela, les deux frères s'étaient solidement établis dans le chateau-fort de Boussoit-sur-Haine (170). Il importait pour le prestige du nouveau règne et pour la sécurité du Lothier que cette entreprise fût enrayée sans retard. Malgré l'hiver - on était en janvier - Otton accourut et mit le siège devant le château de Boussoit. Les deux frères, désespérant de résister, se résignèrent à capituler. Maitre de la place, Otton la livra aux flammes et emmena ses prisonniers en Saxe (171). Le 21 janvier 974, Otton était encore à Boussoit, d'où il délivra, à cette date, un diplôme en faveur de l'abbaye de Saint-Bavon à Gand (172).
Il est fort probable que Notger avait accompagné l'empereur en Hainaut avec les contingents liégeois. Prince d'empire, il n'était pas seulement tenu de participer à une expédition qui avait lieu sur ses frontières, il était encore intéressé à voir la paix régner dans un pays si voisin. II devait, de plus, tenir grandement à la soumission de la famille de Régnier, qui tyrannisait son abbaye de Lobbes. En 934, lorsque les moines, fuyant l'invasion des Hongrois, avaient voulu se réfugier au château de Thuin, Régnier III les avait empêchés de fortifier cette citadelle, quoiqu'elle fût leur propriété (173). Pour toutes ces raisons, nous croyons probable que Notger assista à la reddition du château du Boussoit, avec son confrère Theudon, évêque de Cambrai, dont la présence y est attestée (174).
C'est pendant le siège de Boussoit que semblent s'être nouées, entre Otton II et l'abbaye de Saint-Bavon, des relations très intimes, qu'il y a lieu d'exposer. Gand était un poste stratégique de la plus haute importance; selon que les comtes étaient les amis ou les ennemis de l'empereur, ils défendaient ou ils menaçaient l'extrémité occidentale de l'Empire, et, de cette forteresse qui dominait le cours de l'Escaut, ils pouvaient, en s'alliant avec les rebelles du Lothier, toujours sûrs de l'appui de la France, devenir un sérieux danger (175). Il était donc de bonne politique, pour les empereurs, de se ménager des intelligences du côté de la Flandre. Or, il se trouvait précisément que l'abbaye de Saint-Bavon à Gand avait besoin de son appui. Womar, qui gouvernait Cette maison ainsi que celle de Saint-Pierre au Mont-Blandin, s'était déjà adressé précédemment à l'empereur Otton I, en le priant de restituer à Saint-Bavon des biens que l'abbaye possédait dans l'Empire, aux pagus de Campine, de Brabant, de Hesbaye, de Ryen et ailleurs encore. Otton I avait accueilli cette demande en principe, mais, prévenu par la mort, il n'avait pas eu le temps de faire dresser un acte en règle. Womar profita de la présence d'Otton II dans le pays pour renouveler sa demande, à laquelle l'empereur s'empressa de faire droit par son diplôme daté de Boussoit le 21 janvier 974. L'abbaye témoigna sa reconnaissance à l'empereur en le recevant dans sa communauté de prières, faveur spirituelle très appréciée à cette époque (176). Et elle n'eut qu'à se féliciter, par la suite, de s'être procuré un confrère de cette importance: trois autres diplômes impériaux, datés, les deux premiers de 976, le dernier de 977, lui apportèrent, avec la confirmation de ses privilèges, la restitution de plusieurs domaines qui lui avaient été enlevés, entre autres celui de Wintershoven en Hesbaye, détenu pour lors par un des propres chapelains de l'empereur (177).
II n'est pas douteux que le soin des graves intérêts de son abbaye n'ait amené au camp devant Boussoit l'abbé de Saint-Bavon en personne, et qu'à cette occasion, Notger n'ait fait la connaissance de ce dernier. C'est, en effet, peu de temps après l'expédition d'Otton II en Hainaut que l'évêque de Liège, sollicité par l'abbé, consentit à écrire pour lui l'histoire de saint Landoald, dont les moines de Saint-Bavon venaient de transférer les reliques de Wintershoven à Gand (178).
Le dévouement que Notger avait montré à l'empereur au cours de la campagne de Hainaut ne devait pas tarder à recevoir sa récompense. Dans les derniers jours de juin de la même année, Otton II, se trouvant à Erfurt, émit un diplôme par lequel il confirmait à l'évêque de Liège la possession du marché et de la monnaie de la ville de Fosse (179).
Mais on n'en avait pas fini avec Régnier et Lambert. Réfugiés en France, ils se préparaient à un nouvel assaut contre le Lothier. Le roi Lothaire les appuyait sous main: dans son ardent désir de remettre ce pays sous l'autorité de la France, il croyait devoir encourager toutes les tentatives destinées à y ébranler le pouvoir des rois allemands. Deux grands seigneurs de son royaume, son propre frère Charles et Otton de Vermandois prêtèrent leur concours aux exilés. Ainsi renforcés, Régnier et Lambert avaient couru assiéger dans Mons Arnoul et Godefroi, qui gouvernaient le Hainaut pour le compte d'Otton depuis la mort de Garnier et de Rainald. Les assiégés firent une sortie le 19 avril 976, jour du mercredi saint, et un sanglant combat fut engagé entre eux et les envahisseurs. Godefroi fut blessé dans la rencontre; Arnoul s'enfuit à bride abattue, mais il ne parait pas que la bataille ait eu un résultat décisif (180). La frontière de l'empire restait compromise toutefois, et plus menacée que jamais par les intrigues et les entreprises du parti français.
Dans ces conjonctures, Otton Il se résolut à une mesure qui eût pu paraître téméraire, si elle n'avait été inspirée par une profonde connaissance des hommes et des choses: il confia le duché de Lothier, alors vacant, à ce même Charles de France qui venait de le ravager et qui, frère du roi Lothaire, avait été jusque là l'instrument le plus actif des visées de ce dernier (181). Charles était jeune, entreprenant, ambitieux; il souffrait d'avoir été écarté du pouvoir par son frère (182), qui ne lui avait pas même constitué d'apanage; à tout prix, il cherchait à se faire une situation politique, et il ne pouvait espérer de la trouver en France. Quoi de plus habile, en pareille circonstance, que de l'attacher à la fortune de la maison de Saxe et de le brouiller définitivement avec son frère en lui donnant à défendre les provinces que celui-ci convoitait le plus? L'expédient réussit, et Charles de France devint le fidèle vassal d'Otton. II. Si je raconte ces faits, c'est à cause de la part prépondérante qu'à mon sens y a prise Notger. Ce n'est pas un jeune souverain alors âgé de 23 ans au plus, inexpérimenté et sans connaissance spéciale du pays, qui aurait seul conçu un plan politique à aussi longue portée, et il n'y a pas de témérité à en faire honneur aux conseils de l'homme qui était le mieux en situation et pour l'élaborer et pour le faire adopter (183).
Lothaire ressentit vivement le coup qui venait de lui être porté: ardent et vindicatif, et, sans doute, poussé par les fils de Régnier (184), il rêva de se venger sans retard. Brusquement, sans avoir laissé transpirer rien de son projet, il apparut avec une armée en Lothier vers la fin de juin 978 et courut droit sur Aix-la-Chapelle, où résidait alors Otton II avec sa femme Théophano, qui était enceinte. La nouvelle de l'arrivée du roi de France tomba comme un coup de foudre sur la ville impériale. Otton, d'abord, n'en voulut rien croire, puis, forcé de se rendre à l'évidence, il s'enfuit précipitamment à Cologne, abandonnant ses bagages et ses tables encore dressées. Le roi de France put impunément ravager le pays et se donner la satisfaction de manger le diner préparé pour son adversaire. Il en eut une seconde, plus vive encore, qui consista à retourner du côté de la Germanie l'aigle qui surmontait le palais de Charlemagne. Trois jours après cette démonstration, et sans avoir rien fait pour justifier ce symbole de ses conquêtes futures, il reprenait le chemin de la France (185).
Quel avait été le but de cette singulière expédition? Incontestablement, Lothaire voulait mettre la main sur la personne d'Otton II, qu'il savait alors aux confins de son royaume: ce qui le prouve, c'est que, n'ayant pas réussi à s'emparer de lui, il repartit aussitôt. S'il ne le poursuivit pas jusqu'à Cologne, c'est apparemment parce que, comptant faire un coup de main, il n'avait pas amené assez de troupes pour tenir la campagne. Il ne faut pas ajouter foi aux assertions de Richer, d'après lequel Lothaire s'était fait accompagner d'une armée de 20 000 hommes: un pareil rassemblement de forces ne pouvait avoir lieu, à celle époque surtout, sans de longs préparatifs, dont on n'aurait pas manqué d'avoir vent en Allemagne, et l'extrême désarroi qui régna à Aix-la-Chapelle, lorsqu'on y apprit l'équipée du roi de France, dément implicitement l'hypothèse d'une expédition en règle (186).
Nous ne nous serions pas occupé de cet incident héroï-comique, si Notger n'avait dû s'y trouver impliqué. C'est son pays que traversait l'armée des envahisseurs, et s'il n'a pu prévenir en temps utile son souverain de ce qui se préparait contre lui, c'est une preuve de plus du caractère soudain et imprévu de l'attaque. Comme aucun chroniqueur liégeois n'en a conservé le souvenir, et qu'il ne devait être ni dans le plan ni dans l'intérêt de l'envahisseur de perdre du temps à soumettre des villes, au risque de laisser échapper le prince allemand qu'on voulait surprendre, il est assez vraisemblable que Lothaire aura pris un chemin qui ne passait pas par Liège. Il n'aura eu qu'à suivre la chaussée romaine qui, de Bavay, court à travers les plaines du Hainaut et de la Hesbaye, et se dirige sur Cologne en passant par Tongres et Maestricht. En la quittant à partir de cette dernière ville, on était au bout de quelques heures à Aix-la-Chapelle. C'était le chemin que suivirent, en sens inverse, tous les envahisseurs de la Gaule septentrionale; récemment encore, en 954, il avait conduit les Hongrois au coeur du Lothier (187),
Liège fut donc probablement épargnée par l'incursion française; mais, en revanche, les campagnes de la Hesbaye durent souffrir cruellement de ce passage d'une armée ennemie qui n'avait rien à ménager. II y eut sans doute quelque résistance à certains endroits, car nous savons qu'un homme de l'armée du roi de France périt en 978 « dans la guerre de Hesbaye » (188). On sait comment, dès le mois d'octobre de la même année, Otton rendit à Lothaire l'étrange visite qu'il en avait reçue. Notger fut probablement de l'expédition, mais aucun chroniqueur ne parle de lui à cette occasion. Or, peut croire que la crainte du retour d'une pareille attaque, dans laquelle sa ville épiscopale ne serait plus épargnée, ne doit pas avoir peu contribué au projet de fortifier Liège, que nous le verrons réaliser au cours de son règne.
Désormais aussi, les yeux de l'évêque restèrent fixés sur la frontière française, où était le point le plus vulnérable de la monarchie ottonienne. Cambrai, qui aurait dû en être le boulevard occidental, était le sujet d'éternelles inquiétudes et le théâtre de troubles permanents. Les évêques y étaient à la merci des comtes, véritables tyrans locaux, qui se désintéressaient entièrement de l'Empire. On y avait eu, depuis le règne d'Otton I, une série de pontificats troublés, et Theudon, qui occupait le siège épiscopal depuis 972, avait été à la lettre le souffre-douleur de ses vassaux. Ce pauvre homme faible et naïf ne cessait de regretter sa chère église Saint-Séverin de Cologne, dont il avait été le prévôt, et se considérait comme un exilé en pays barbare: à la fin, n'y tenant plus, il abandonna son diocèse et revint mourir à Cologne. C'était en 979.
Notger avait bien des raisons pour se préoccuper du choix de son successeur. Non seulement il était, avec son collègue de Cambrai, le principal représentant de l'empereur en Lothier, mais il avait un intérêt direct à ce que Theudon fût bien remplacé: si l'on voulait préserver Liège des attaques du roi de France, c'est à Cambrai qu'il fallait la défendre. Ajoutons qu'à peine la mort de Theudon connue, le duc de Lothier était accourru, à la demande des comtes Godefroi et Arnoul, pour protéger la ville contre le roi de France. En réalité, il s'y était comporté en maitre, et il fallait aviser sans retard. Malgré les rigueurs de l'hiver, Notger courut trouver l'empereur à Poehlde en Saxe, où la cour passait les fêtes de Noel, et lui recommanda vivement son ancien élève Rothard (189). Déférant au voeu de son fidèle conseiller, l'empereur donna l'évêché de Cambrai au protégé de l'évêque de Liège (190). Rothard était de famille noble et semble avoir été populaire à Cambrai, où l'on avait demandé sa nomination à l'empereur. On espérait, dit le chroniqueur, que l'aménité du nouvel évêque adoucirait le peuple de cette ville; en d'autres termes, on voulait rattacher plus étroitement à la cause de l'Empire une population dont la fidélité était peut-être branlante (191).
Rothard ne trompa point les espérances de son protecteur: un de ses premiers actes, ce fut la destruction du fort de Vinchy, construit à quatre milles de sa ville épiscopale par Eudes de Vermandois, qui menaçait de devenir le tyran de l'évêché (192). Rothard montrait de la sorte à son ancien maitre Notger comment il fallait se comporter envers ces forteresses féodales. « C'est ainsi, dit un historien moderne, que la nomination de Rothard et l'échec de son neveu Eudes firent perdre à Lothaire toute influence sur ce pays de Cambrésis, qui s'enfonçait comme un coin dans son royaume (193) ». Le fait, dans tous les cas, atteste et le crédit dont Notger jouissait à la cour, et la perspicacité de son coup d'oeil politique. Aussi voyons-nous son séjour auprès du souverain marqué par une nouvelle faveur accordée à son église; par un diplôme daté de Grona le 6 janvier 980, Otton II lui confirmait la possession de tous ses biens et la jouissance de l'immunité (194).
Il ne faudrait cependant pas exagérer, comme l'ont fait quelques-uns, la position que Notger occupait à la cour impériale, et la comparer à celle dont, grâce à d'éminents services, il devait jouir sous le règne suivant. Sans doute, nous le trouvons parmi ceux qui ont la confiance du roi; toutefois, plusieurs personnages le dépassèrent en influence sous ce règne, et nous apprenons par les documents diplomatiques que ce furent Gisilher de Magdebourg, Pierre de Pavie et Thierry de Metz (195).
A partir des premiers jours de 980 jusqu'à la fin du règne d'Otton II (983), le nom de Notger disparaît d'ailleurs des diplômes impériaux. Nous voyons qu'il passa une bonne partie de l'année 980 dans son diocèse. Le 25 mars, il était à Lobbes, où il prenait des mesures pour assurer à cette abbaye la paisible possession de certaines redevances (196). Peu de temps après, il assistait à un concile d'Ingelheim qui, sous les yeux de I'empereur, confirmait l'union des abbayes de Stavelot et de Malmedy, et précisait le privilège de la première en matière d'élections abbatiales (197). Selon toute apparence, il accompagna l'empereur à Margut sur le Chiers, où ce prince eut avec le roi de France une entrevue qui établit des relations pacifiques entre les deux souverains; c'était en mai. De là, il sera revenu avec l'empereur, que nous trouvons le 1er juin à Aix-la-Chapelle. Dans tous les cas, dès le 19 juin, il était de retour dans son diocèse, car c'est à cette date qu'il envoya à son ami, l'abbé Womar de Saint-Bavon, la vie de saint Landoald, dont les reliques venaient d'être transférées à Gand (198).
Nous ne sommes pas si bien renseignés sur l'emploi qu'il fit des années 981 et 982. Il n'accompagna pas le monarque en Italie, dans cette expédition fatale qui devait se terminer par le désastre de Rossano. Nous possédons un document de 980 ou 981, contenant l'énumération des soldats à cuirasse que l'empereur demandait aux divers princes ecclésiastiques et laïques. Les uns de ces grands vassaux devaient partir eux-mêmes avec leurs contingents, d'autres pouvaient se borner à les envoyer, et Notger est au nombre de ces derniers. « L'évêque de Liège, dit la circulaire impériale, enverra soixante hommes avec Herman ou Ammon (199). » Il est donc certain que Notger fut laissé à son diocèse pendant les années 981 et 982. Mais la catastrophe qui frappa les armées allemandes pendant cette dernière année devait déterminer de la part des princes un mouvement de loyalisme extraordinaire: la plupart, répondant à l'appel de leur souverain en détresse, accoururent se ranger autour de lui dans la diète qu'il réunit à Vérone pendant les premiers jours de juin 983 (200). Notger, cette fois, se trouva au rendez-vous.
Ce fut là qu'il reçut de l'empereur la dernière marque de sa faveur: Otton lui conférait par diplôme du 5 juin 983 le droit de marché à Visé, en récompense, dit l'acte, de sa fidélité et de son dévouement éprouvés. Thierry de Metz et la duchesse Béatrice étaient intervenus, et c'est probablement Béatrice qui avait provoqué la donation, car c'est de ses mains que le droit de marché passait dans celles de l'évêque (201).
La diète de Vérone avait eu un double but: d'une part, elle devait rassurer les populations en leur montrant, au lendemain du revers, l'empereur inébranlable dans son attitude; de l'autre, il s'agissait de faire reconnaître Otton III, enfant encore, comme successeur de son père. Ce double but atteint, Otton Il, appuyé surtout sur les milices italiennes, reprit la campagne contre les musulmans, pendant que les archevêques de Mayence et de Ravenne, auxquels, sans doute, se joignit Notger, menaient l'enfant royal eu Allemagne pour le faire couronner à Aix-la-Chapelle. La cérémonie eut lieu le jour de Noël 989. Une fête joyeuse, à laquelle Notger dut assister en qualité d'évêque du diocèse (202), réunissait les princes et les prélats autour de leur jeune souverain, lorsqu'on reçut de Rome la triste nouvelle de la mort d'Otton II. Il disparaissait à l'âge de 28 ans, emporté par les fatigues, par les ardeurs d'un climat méridional et aussi par le chagrin que lui causaient ses revers, laissant le royaume dans la situation la plus critique, sous l'autorité d'un prince âgé de quatre ans.
|
NOTGER PENDANT LA MINORITÉ D'OTTON III

Theophano
La mort prématurée d'Otton II avait créé une situation des plus difficiles à son fils Otton Ill. Souverain de plein droit, en vertu de son sacre, il était censé régner en fait, le droit germanique ne connaissant pas les régences. Seulement, comme le règne d'un enfant n'est en réalité qu'une fiction juridique, il fallait bien que quelqu'un gouvernât pour lui pendant sa minorité, et ce quelqu'un, c'était évidemment celui qui se mettrait en possession de l'enfant royal. Pendant que les plus fidèles serviteurs de la maison ottonienne se ralliaient autour de la reine-mère et ne voulaient pas qu'on lui enlevât son fils, Henri de Bavière, le plus proche parent masculin du jeune roi, essaya de faire valoir ses prétentions.
Henri, que l'histoire connaît sous le nom de Querelleur, était à bon droit suspect aux loyalistes: il s'était soulevé à plusieurs reprises contre son cousin Otton II, qui avait fini par le destituer de son duché de Bavière et par l'envoyer en exil à Utrecht, où il vivait depuis cinq ans sous la garde de l'évêque Folcmar. Les plus perspicaces disaient que cet ambitieux et remuant personnage ne se contenterait pas de gouverner sous le nom de son jeune parent, mais qu'une fois maître de sa personne, il le mettrait à l'ombre et s'emparerait de la couronne royale. D'autres, au contraire, préoccupés exclusivement des dangers d'une tutelle féminine et persuadés qu'il fallait au royaume menacé le concours d'un bras puissant, sensibles d'ailleurs aux arguments tirés de la proche parenté d'Henri, penchaient à le reconnaître comme l'arbitre du royaume.
Henri ne laissa pas aux partis le temps de peser et de discuter ses droits. A peine informé de la mort d'Otton II, il eut le talent de se faire mettre en liberté par l'évêque d'Utrecht, son gardien, puis, sans perdre de temps, il courut à Cologne, où il décida l'archevêque Warin à lui livrer la personne du royal orphelin. Maitre de l'enfant, il pouvait déjà se considérer comme maitre du royaume. Peu de temps après, l'archevêque de Trêves Egbert et son suffragant Thierry, évêque de Metz, se prononcèrent en sa faveur, et il se trouva à la tête d'un parti assez puissant pour lui permettre de tout espérer. Son intention manifeste était dès lors de se faire associer au trône (203), sans doute avec l'arrière-pensée de se substituer plus tard au jeune roi Tous ses partisans ne s'aperçurent pas, peut-être, de ces visées lointaines. Plus d'un put, sans scrupule, se prononcer en faveur de ses prétentions, en considération des maux que devait causer à l'empire le règne d'un enfant et pour éviter les horreurs de la guerre civile (204).
Mais l'épiscopat allemand restait fidèle au malheur, et ce fut son opposition aux projets du Bavarois qui sauva le trône d'Otton III. Il y eut, si l'on peut ainsi parler, deux foyers de résistance. Le centre de l'un, ce fut Willigis de Mayence, qui sut grouper les Saxons et les Francs, les deux tribus sur qui surtout s'appuyait la dynastie ottonienne, et qui força Henri de Bavière à renoncer à ses prétentions. Le rôle de Willigis, un peu éclipsé parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de traces dans la littérature, a été remis en lumière récemment et mérite de rester dans l'histoire (205).
En Lotharingie, les droits du royal orphelin trouvaient des partisans résolus parmi les membres de l'épiscopat. Pendant qu'Egbert de Trèves et Thierry de Metz embrassaient le parti d'Henri, Notger et son ami Rothard de Cambrai, suivis bientôt par Gérard de Toul, se prononcèrent dès les premiers jours pour la cause du souverain légitime et de la reine-mère. Ils trouvèrent un puissant appui dans Adalbéron, archevêque de Reims, et dans son frère Godefroi, dont Otton II avait autrefois récompensé les services en lui faisant don des terres enlevées dans le Hainaut aux fils de Régnier. Mais l'âme de la résistance au Bavarois fut un prêtre français, Gerbert d'Aurillac, écolâtre de Reims, qui avait des obligations à la famille royale d'Allemagne et qui lui gardait un attachement profond. Gerbert était le confident de son archevêque; par lui, le siège français de Reims devint le foyer le plus actif de l'agitation en faveur d'Otton III.
Il ne faut pas s'étonner de voir Gerbert s'engager dans cette cause avec un zèle qui le poussera même, plus tard, à combattre son propre roi, quand celui-ci voudra tirer parti de la situation pour son compte. L'empire, à cette époque, n'avait pas encore perdu aux yeux des hommes ce caractère d'internationalité qui faisait comme partie de son essence; il semblait qu'il intéressât tout le monde, et que l'empereur fût, comme le pape, chez lui dans tous les pays. Ce qui était nouveau au Xe siècle, c'étaient les nationalités, c'était cette espèce de patriotisme qui s'arrête aux frontières d'un royaume et non aux confins de la civilisation. Dès lors, des hommes qui, comme Gerbert et comme Adalbéron lui-même, devaient tant aux empereurs, pouvaient se croire liés à eux par un lien plus sacré que celui qui les rattachait au roi de France (206).
Nous devons à une bonne fortune bien rare de pouvoir assister au lent et patient travail de propagande entrepris par ces hommes, à une époque qui ne semble remplie que de batailles et de violences, pour peser sur l'opinion de leurs contemporains et pour les gagner à la cause qu'ils croyaient la meilleure.
Les lettres de Gerbert, que nous avons conservées, s'en allaient dans toutes les directions, encourageant ou stimulant les uns, gourmandant, s'il le fallait, les autres, déjouant les intrigues françaises et les intrigues bavaroises, organisant et centralisant toutes les démarches: on eût dit qu'il était partout, et qu'il avait fait des intérêts de Théophano et de son fils les siens propres. C'est en toute vérité qu'il pouvait écrire à un ami, en le chargeant de présenter ses hommages à l'impératrice: « Elle est souvent, comme de juste, présente à mon esprit; j'ai suscité à sa cause un grand nombre de défenseurs; tu le sais, et toute la Gaule m'en est témoin (207).»
Ainsi, pendant ces années critiques, la Lotharingie fut le champ clos où se jouèrent les destinées de l'Allemagne et de sa dynastie. L'attitude de Notger avait donc dans ce débat une importance capitale. Elle a été jusqu'ici peu comprise ou pour mieux dire peu connue, et il y a lieu de la mettre en lumière. Notger, nous l'avons déjà dit, n'avait pas hésité un seul jour à embrasser une cause qui était pour lui celle de la justice; tout le monde connaissait ses sentiments, et quand on voit qu'un homme comme Adalbéron de Reims, écrivant à notre évêque, se croit obligé de protester de son dévouement au jeune prince, on devine quelle idée ses contemporains se faisaient de sa fidélité dynastique (208). Toutefois, dans l'origine, cette fidélité n'eut pas le même caractère que celle de Gerbert, et la politique de Notger diffère sur un point capital de celle du prêtre de Reims et de ses alliés. Gerbert se défiait au plus haut degré d'Henri de Bavière et voulait à tout prix éviter la régence de cet ambitieux, dont il avait probablement pénétré les vues secrètes; c'est contre lui qu'il dirigeait tous ses efforts, le considérant comme infiniment plus dangereux pour son jeune maitre que le remuant et versatile roi de France. Il se flattait d'avoir gagné à la cause de Théophano le duc Charles de Lothier, bien plus, il croyait y avoir rallié Lothaire lui-même.
« Dites bien à l'impératrice Théophano, mandait-il à une grande dame de ses correspondantes, que les rois de France sont acquis à son fils, et qu'ils n'ont d'autre ambition que de détruire la domination usurpatrice du duc Henri, qui essaie de se faire roi » (209). Jusqu'à quel point Gerbert était convaincu de la sincérité de Lothaire? On n'oserait le dire, et la seule chose qu'il soit permis d'affirmer, c'est que, dans son ardeur à écarter la candidature de l'homme qui lui semblait le plus redoutable rival d'Otton III, il ne craignit pas d'accepter ou de paraître accepter l'alliance d'un tiers qui, tout aussi ambitieux, lui paraissait pourtant moins à craindre. Pour Notger, le véritable ennemi, ce n'était pas le duc de Bavière, c'était le roi de France. Henri, après tout, était un membre de la famille impériale, et, tant qu'on ne pouvait pas, avec quelque raison, l'accuser de nourrir une ambition criminelle, il était plus adroit de le ménager que de rompre avec lui. Lothaire, par contre, était l'ennemi né du Lothier, tout autant que de la dynastie impériale. Le souvenir de son invasion de 978 était récent encore, et on avait tout lieu de craindre qu'il ne voulût profiter de la minorité d'Otton III pour s'emparer de cette contrée, qui avait toujours été l'objet de ses ardentes convoitises. Pour cela, lui suffisait de feindre un grand zèle pour les intérêts du jeune prince, et de se faire le protecteur de sa cause. Et déjà, déçus par ses protestations, un grand nombre de seigneurs lotharingiens, qui envisageaient sans répugnance l'éventualité d'une tutelle exercée par le roi de France, s'étaient ralliés autour de son nom et lui avaient donné des ôtages (210).
Voilà pourquoi, tant que la candidature de Lothaire fut à horizon, Notger pencha visiblement du côté d'Henri, qu'il considérait comme le moindre mal. Les partisans de celui-ci ne réclamaient d'ailleurs pour lui qu'une espèce de tutelle, et il semblait nécessaire, en effet, que, pendant la minorité, les affaires fussent dirigées par un bras fort. Cela étant, le plus proche parent du roi n'était-il pas le plus indiqué pour remplir cette mission? Notger, à ce qu'il parait, l'a cru avec beaucoup d'autres.
Cette opposition de points de vue entre Liège et Reims éclate dès la première lettre que Gerbert écrivit à Notger, de la part de son maitre l'archevêque Adalbéron. Notger avait convoqué Godefroi, le frère dc l'archevêque, à une réunion qui devait se tenir à Liège, sans doute pour aviser à la situation politique. Adalbéron lui écrivit pour excuser son frère de n'y avoir pas été, à cause d'un mal de pied, et d'être allé, par contre, trouver le roi de France, ce qui n'était nullement convenu avec l'évêque de Liège. Il lui protestait de la communion de sentiments qui le liait à lui, dans un même dévouement à la cause d'Otton III, et lui fixait un rendez-vous pour le 11 juin 984 (211).
Quelle était la réunion à laquelle Notger avait convié Godefroi d'Ardenne? On ne sait au juste, mais on y voit assister Charles de Lothier, alors brouillé avec son frère, et l'évêque Thierry de Metz, ennemi déclaré de l'impératrice Théophano et partisan avéré d'Henri de Bavière, ainsi qu'un certain nombre de personnages de second ordre (212). Dans cette réunion, si nous en croyons le témoignage d'ailleurs suspect de l'évêque de Metz, celui-ci aurait obtenu de Charles de Lothier certains engagements en faveur d'Henri (213). Toutefois, la rencontre de ces personnages chez Notger, sous les yeux duquel ils semblent s'être mis d'accord pour quelque temps, nous permet de deviner les bons sentiments qu'à un moment donné l'évêque de Liège professa pour la cause d'Henri (214).
Celui-ci se chargea lui-même d'ouvrir les yeux des honnêtes gens par une de ces démarches prématurées et maladroites que l'impatience du pouvoir dicte presque toujours aux ambitieux vulgaires. Le 16 mars 984, à Magdebourg, dans une réunion de ses partisans, il se fit saluer du titre de roi (215). Alors tous ceux qui avaient adhéré sincèrement au régent se détournèrent avec indignation de l'usurpateur.
Lorsque, avec ses Bavarois, il fut arrivé dans le pays du Rhin, à Burstädt près de Worms, il y rencontra l'archevêque Willigis de Mayence et le duc Conrad de Franconie avec leurs adhérents: loin de les rallier à sa cause, il fut obligé au contraire de s'engager vis-à-vis d'eux à rendre le jeune Otton III à sa mère (216). Peu décidé à tenir cette promesse, il se porta vers la Saxe, mais, à Eythra, il tomba sur une armée de Saxons et de Thuringiens partisans d'Otton, qui le forcèrent à renouveler sa promesse. Cette fois, il lui fallut s'exécuter, et, le 29 juin, dans l'entrevue de Rohr près de Meiningen, il remit solennellement le jeune prince entre les mains de sa mère (217). Ainsi la fidélité des Lotharingiens d'une part, des Francs et des Saxons de l'autre avait remporté la première victoire.
Si le Bavarois avait cru ramener l'esprit public par cette ostentation de générosité, il avait fait un faux calcul. Il ne parvint pas à regagner la confiance de ses adversaires, ni à garder celle de ses partisans. Privé à la fois et de cet air de fidélité qu'il avait su se donner longtemps, et du gage précieux qu'il avait dans la personne de l'enfant royal, il n'avait plus ni prestige ni force, et sa cause était perdue. Lui-même le sentit si bien que, renonçant à s'appuyer sur la nation, il ne compta plus que sur le secours de l'étranger. Le roi Lothaire, qu'on lui avait jusqu'alors opposé comme un rival, allait devenir son allié. Entre ces deux ambitieux également déçus, également irrités, un rapprochement se fit. Lothaire et Henri convinrent d'une entrevue qui devait avoir lieu à Brisach sur le Rhin, le 1er février 985, pour arrêter un projet commun dont les lignes maîtresses étaient les suivantes: Lothaire aiderait Henri à conquérir la couronne d'Allemagne (218); Henri, devenu roi, céderait la Lotharingie à Lothaire (219).
Gerbert, dont il n'était pas facile de prendre la vigilance en défaut, eut vent du projet. Aussitôt il poussa le cri d'alarme: « Veillez-vous, père de la patrie, écrivit-il à Notger, vous dont la fidélité à la cause de l'empereur était autrefois si fameuse, ou bien êtes-vous aveuglé par la fortune et par l'ignorance des événements? Ne voyez-vous pas les droits divins et humains bouleversés à la fois? Voilà qu'on délaisse ouvertement celui à qui, par reconnaissance pour son père, vous aviez promis votre foi, à qui vous deviez la conserver une fois promise. Les rois de France s'approchent en secret de Brisach allemand sur les bords du Rhin; Henri, déclaré ennemi public, ira à leur rencontre le 1er février. Prenez toutes les mesures de résistance, mon père, pour empêcher la ligue contre votre seigneur et votre Christ. La multitude des rois, c'est l'anarchie des royaumes (220). S'il est difficile de la conjurer complètement, choisissez au moins le parti le meilleur. Pour moi, qui, à cause des bienfaits d'Otton, reste fidèle à la cause de son fils, je n'hésite, pas dans mon choix. Nous connaissons les projets ambitieux d'Henri, nous savons ce qu'est la fougue française, nous n'ignorons pas ce qu'ils nous préparent (221). Gardez-vous de faire associer au trône un homme que vous ne pourrez plus écarter, une fois qu'il y sera monté (222). »
Nous voyons par cette lettre combien, à Reims, on était préoccupé de combattre la prédilection qu'on attribuait à Notger pour le Bavarois. Aussi le groupe des familiers et des partisans de l'archevêque Adalbéron multipliait-il les avances pour entretenir les bonnes dispositions de l'évêque de Liège et pour le détacher de plus en plus d'Henri. Adalbéron lui-même le mettait au courant de ses démarches auprès d'Egbert de Trèves (223). Godefroi le faisait inviter, en novembre 984, à la consécration de son fils, qui venait d'être élu évêque de Verdun, et dont l'inauguration était fixée au 3 janvier 983; pour être sûr de sa présence, il lui mandait qu'il le ferait prendre le 28 décembre (224). Nul doute que cette solennité religieuse ne fût destinée à couvrir, dans la pensée des princes lotharingiens, une réunion politique des plus importantes, où l'on arrêterait en commun une ligne de conduite.
Cependant le danger était moins du côté d'Henri que du côté de Lothaire. Notger n'aura pas manqué de le dire à ses amis, et l'histoire lui a donné raison sur ce point. Le rapprochement des deux ennemis de Théophano, tant redouté de Gerbert, n'eut pas lieu. Henri, on ne sait pour quelle raison, n'apparut pas au rendez-vous de Lothaire à Brisach. Le roi de France revint furieux, se considérant comme joué, et bien décidé, puisqu'il le fallait, à agir seul (225).
Le mois de février n'était pas encore écoulé qu'il s'emparait de Verdun, et, cette ville ayant été reprise par les Lotharingiens peu après son départ, il vint en faire une seconde fois le siège et s'en rendit maître au mois de mars 985. Ainsi le roi de France prenait pied en Lothier, et le désastre pour la maison de Saxe était d'autant plus grand que le vaillant Godefroi de Verdun, son frère Sigefroi de Luxembourg et d'autres personnages de marque étaient tombés dans les mains du vainqueur. Adalbéron de Reims fut si intimidé de cet échec qu'il n'osa plus faire opposition à Lothaire; il se laissa même entraîner à écrire en sa faveur aux archevêques de Mayence, de Trêves et de Cologne (226).
Mais Gerbert restait à la cause du jeune Otton et de sa mère, et, sans exagération, on peut dire que Gerbert suffisait. Cette fois cependant, la tâche était rude, car il avait à combattre son métropolitain, son bienfaiteur, son chef Adalbéron, et ses lettres allaient chez les correspondants de celui-ci détruire l'effet des messages contraints que ce prélat écrivait sous la dictée de Lothaire. Voici celle que reçut Notger: « Votre nom devient éclatant dans un temps où retentit si rarement l'éloge de la probité, mais où l'improbité est si souvent proclamée. Votre ami Godefroi voit maintenant où sont les amis qui l'ont aimé plus que leurs intérêts, qui auraient été fidèles à sa femme et à ses enfants s'il leur avait été enlevé par la mort. La bonne opinion qu'a de vous un homme de cette valeur est à elle seule la preuve du haut degré du mérite qui brille en vous. Il exhorte donc et il engage ceux qui l'aiment, ceux qui lui sont dévoués, à garder leur foi à sa souveraine Théophano et à son fils, à ne pas se laisser accabler par les forces de l'ennemi ni épouvanter par les événements; il viendra un jour d'allégresse qui fera le départ des traîtres et des amis de la patrie, réservant à ceux-là des châtiments, à ceux-ci des récompenses. Ne mandez rien de tout ceci à votre fidèle ami l'archevêque Adalbéron de Reims: il est victime de la contrainte, comme en font foi les lettres qu'il a écrites à vos archevêques. II n'a rien écrit qui vienne de lui; tout lui a été arraché par la violence de la tyrannie (227) ».
Notger, apparemment, n'avait pas besoin des exhortations de Gerbert pour se mettre sur ses gardes contre les entreprises du roi de France, que l'on petit considérer comme son vieil ennemi. Aussi bien eut-il, peu de temps après, là satisfaction de constater que, comme il l'avait prévu, Lothaire restait seul en face du jeune Otton. En effet, l'ambitieux Henri, désespérant de ses vastes projets et voulant au moins sauver son duché de Bavière, venait de se décider à faire une paix décisive avec les deux reines. Cet acte important se passa en 985 à Francfort sur-le-Mein (228). Une conférence, convoquée à Metz pour le mois de juillet de la même année, avait pour objet de sceller cette réconciliation. Là devaient se rencontrer, avec les impératrices Adélaïde et Théophano, la duchesse Béatrice, plusieurs princes parmi lesquels Henri, et plusieurs évêques parmi lesquels Notger (229). On ne sait si cette conférence eut lieu (230); dans tous les cas, les résultats de la paix de Francfort restèrent acquis: Otton III garda son royaume sous la tutelle de sa mère, Henri fut rétabli dans son duché de Bavière.
Notger passa une partie de cette année 985 à la cour du roi. Il était avec lui à Francfort le 28 juin, et il intervint dans l'acte par lequel le roi accorda en propre à Ansfrid tout ce qu'il tenait de lui en bénéfice dans la Frise (231). II l'accompagna ensuite à Ingelheim, où, le 7 juillet, il se fit accorder tous les droits qui restaient au souverain dans le comté de Huy (232).
Seul, le roi de France, mécontent et jaloux, rêvait de demander aux armes une revanche de ses insuccès diplomatiques, et préparait une nouvelle invasion du Lothier. C'est encore par la correspondance de Gerbert qu'on en fut informé en Allemagne; dès la fin de juin 986, il prévenait l'impératrice Théophano: « Un complot s'est formé ou se trame en ce moment contre le fils de César et contre vous; il comprend non seulement des princes, entre autres le duc Charles qui ne s'en cache plus, mais encore tous ceux des chevaliers que l'espérance ou la crainte peuvent enchaîner... On prépare en grand secret une expédition contre vos fidèles, mais je ne sais lesquels (233). »
En même temps, Rothard de Cambrai apprenait que les deux postes menacés, c'étaient sa ville épiscopale et celle de Notger. Liège et Cambrai étaient en effet les boulevards de la puissance ottonienne en Lothier; les conquérir, c'était enlever tout le pays à l'Allemagne. Cette fois, l'évêque de Cambrai ne fut plus à la hauteur de la situation: à la nouvelle des projets de Lothaire, il accourut s'humilier devant lui et obtint la promesse que le roi ne lui demanderait sa soumission qu'après qu'il aurait obtenu celle de Liège et des principaux grands du pays (234). Vaines terreurs! L'heure approchait où le remuant roi de France ne serait plus un danger pour personne. Le 2 mars 986, ce prince, dans lequel revivaient toutes les vastes ambitions des rois carolingiens, expirait à l'âge de 44 ans, et, comme dit un contemporain, « les Belges pouvaient respirer » (234 Richer, III, 108. p. 630: Sed Divinitas res mundanas determinans, et Belgis requim, et huic (regi Lothario) regnandi finen dedit).
Sur cette période de luttes sourdes ou ouvertes déchaînées par les intrigues de deux ambitieux, la correspondance de Gerbert, tout intéressante qu'elle soit, ne nous apporte cependant, pas toutes les indications que nous souhaiterions. Elle allume notre curiosité plus qu'elle ne la satisfait, elle nous laisse deviner des problèmes dont elle ne nous donne pas la solution. Cela est vrai surtout du rôle que notre évêque a joué dans ces complications internationales. Nous avons laissé de côté, dans notre exposé, plus d'un point de ce rôle sur lequel nous n'avons que des allusions vagues; par exemple, nous n'avons pas essayé de préciser quelles sont au juste ses relations avec Godefroi de Verdun, qui semble être de ses fidèles et pour qui on réclame sa protection.
Plusieurs écrivains liégeois ont prétendu que Notger fut le tuteur d'Otton III et le régent du royaume (235). Il n'en est rien. La tutelle a été gérée par l'impératrice elle-même: quant aux études du jeune prince, elles ont été dirigées, d'abord par le comte saxon Hoico et par Jean de Plaisance, puis, après la retraite de ce dernier en 988, par saint Bernward, évêque de Hildesheim. Notger fut encore moins le régent du royaume, puisqu'il n'y eut pas de régence à proprement parler, et que ceux-là étaient les maîtres du pouvoir qui avaient la garde de l'enfant royal, c'est-à-dire, tout d'abord sa mère Théophano et sa grand'mère Adélaïde (236).
|
CHAPITRE VII
NOTGER AU SERVICE D'OTTON III

Otton III
Le zèle que notre évêque avait déployé pour la défense des droits de son souverain légitime devait trouver une récompense. Il devint, sous Otton III, un des hommes les plus influents de l'empire, un des conseillers les plus écoutés de la couronne. Sans égaler la situation d'un Willigis de Mayence et d'un Hildebold de Worms, qui remplissaient respectivement les fonctions d'archichancelier et de chancelier du royaume, il occupait, immédiatement après eux, le premier rang à la cour et dans le royaume, et les diplômes impériaux du règne d'Otton III nous apportent un témoignage officiel de sa haute situation.
C'est lui que l'empereur consultait sur tout ce qui regardait les affaires du Lothier. Sous ce rapport, on peut dire que notre évêque reproduit, bien qu'avec moins d'autorité et de prestige, la figure de saint Brunon de Cologne. C'est lui, on le verra, qui disait le mot décisif dans la nomination des évêques de Cambrai et d'Utrecht; c'est son intervention qui était mentionnée dans les diplômes des libéralités faites par l'empereur aux églises ou aux grands de ce pays. Nous rencontrons son nom dans treize actes impériaux qui s'échelonnent entre les années 985 et 997: sur ces treize documents, il y en a huit qui reviennent au Lothier, quatre à d'autres régions de l'Empire et un à l'Italie. C'est Notger, les actes en font foi, qui a procuré la faveur du souverain à l'église de Cambrai (237), ainsi qu'aux abbayes de Stavelot (238), de Brogue (239), de Nivelles (240) et de Villich (241); c'est grâce à son intervention aussi que le comte Ansfrid a obtenu de l'empereur d'importantes concessions en Frise (242). Ces actes seraient plus nombreux encore si, plus d'une fois, sous le règne d'Otton III, des missions importantes n'avaient tenu Notger éloigné de la cour pendant un temps assez considérable (243), mais ils suffisent pour nous permettre de dire, avec les diplomatistes, que lorsqu'il s'agissait d'affaires lotharingiennes, la cour n'écoutait personne plus volontiers que lui (244).
Nous en avons une preuve bien éclatante dès l'année 986. Notger en passa une grande partie, ainsi que le commencement de la suivante, auprès de son jeune souverain. Il l'accompagna à Duisbourg, où il intervint le 29 novembre dans le diplôme pour l'abbaye de Saint-Remi de Reims (245); il le suivit à Cologne, où, le 7 décembre, il joua le même rôle dans une donation impériale pour l'abbaye de Saint-Gérard de Brogne (246); à Andernach, où il fut intervenant pour l'abbaye de Villich à la date du 18 janvier 987 (247), et à Nimnègue, où son nom figure le 27 février dans une donation à l'abbaye de Stavelot (248).
Pendant ce séjour prolongé auprès de ses souverains, il eut le temps et l'occasion d'entretenir l'impératrice régente des intérêts de son pays de Liège. Une expérience cruelle avait ouvert les yeux de cette princesse sur la nécessité de renforcer dans ce pays de frontière l'autorité de l'Empire, en y fortifiant la situation d'un vassal aussi dévoué que Notger, et c'est sans doute cette considération qui la détermina à lui prêter main forte en 987 pour la démolition de Chèvremont. Des documents contemporains nous la montrent occupée au siège de cette forteresse vers le commencement de l'été de cette année (249).
Un projet hardi germa alors dans l'esprit d'Eudes de Blois et de Herbert de Troyes. Ces deux seigneurs français s'étaient rendus fameux par la capture du comte Godefroi de Verdun. Se souvenant que, quelques années auparavant, le coup de main de Lothaire sur Aix-la-Chapelle avait été bien près de réussir, ils imaginèrent d'aller surprendre et enlever l'impératrice. Adalbéron de Reims, ou pour mieux dire Gerbert, qui avait un service d'informations hors ligne, eut le temps de prévenir cette princesse: c'était quelques jours après le 17 juin (250). Théophano, sans doute, déjoua le complot; malheureusement, nous ne savons rien de plus à ce sujet, et, sans une allusion fortuite conservée dans la correspondance de Gerbert, nous ignorerions et le siège de Chèvremont, et la part qu'y a prise l'impératrice.
Si l'histoire de la destruction de Chèvremont, sur laquelle nous devons revenir plus loin, atteste une fois de plus le crédit dont Notger jouissait à la cour, le fait suivant est une preuve non moins frappante de l'espèce de patronage qui lui était dévolu sur les affaires du Lothier. L'abbé Erluin de Gembloux était mort le 10 août 986 ou 987 (251), et les moines se rendaient à la cour pour obtenir un nouvel abbé. Passant par Liège, ils ne manquèrent pas d'aller demander conseil et peut-être appui à Notger, qui était d'ailleurs leur évêque diocésain. Notger les dissuada vivement de leur démarche. Il allégua que le roi, étant éloigné souvent, ne pourrait pas les protéger efficacement, et que ses courtisans ne manqueraient pas cette occasion de leur extorquer de l'argent; il leur offrit de devenir lui-même leur patron, se faisant fort d'obtenir le consentement de l'empereur à cette combinaison. Les moines se laissèrent convaincre, et ils élurent Herward, à qui Notger imposa les mains. L'évêque voulut récompenser l'abbaye de la confiance qu'elle lui avait montrée: il lui fit diverses donations parmi lesquelles étaient le village de Temploux, qui donnait un revenu annuel de 100 sous, une vigne à Namur et d'autres terres (252). Au surplus, il n'avait pas trop présumé de son crédit à la cour; peu de temps après Otton III confirmait les possessions de l'église de Liège par un diplôme où est expressément mentionné Gembloux (253). L'acte n'est pas daté, mais comme nous trouvons l'empereur à Braine-le-Comte (254) le 20 mai 988, ii y a lieu de croire qu'il aura passé par Liège, et qu'il aura émis le diplôme pendant son séjour dans cette ville (255).
A partir du printemps de 988 jusqu'au 18 juin 990, nous ne rencontrons plus le nom de Notger dans les diplômes d'Otton III. C'est une longue disparition, dont il n'est pas nécessaire de chercher la raison fort loin: les Annales de Lobbes nous apprennent qu'il était parti pour l'Italie. Apparemment il y accompagna (256) l'impératrice Théophano, qui allait affermir l'autorité de son fils dans ce pays, où le pape Jean XV était toujours menacé par Crescentius (257). On a discuté sur la date de ce voyage de l'impératrice, mais nous savons aujourd'hui qu'elle partit dans l'automne de 989 (258), et rien ne permet de croire que Notger l'aurait précédée au-delà des Alpes. On comprend quelle importance la mère du jeune roi devait attacher aux services d'un prélat à la fois habile et énergique, qui avait déjà quelque expérience de l'Italie et qui savait ce que c'est que gouverner.
L'évêque de Liège emmenait avec lui un moine savant et vertueux qui jouissait de toute sa confiance; c'est Hériger, écolâtre de l'abbaye de Lobbes, qui lui fut toujours d'un grand secours pour expédier toutes les affaires, tant politiques que religieuses et littéraires (259).
C'est pendant que Notger était en route pour l'Italie qu'il reçut la lettre suivante, dont l'auteur était l'archevêque Arnoul de Reims, qui venait de succéder à Adalbéron par le choix de Hugues Capet: « La joie que j'avais conçue de faire le voyage de Rome, et que rendait plus vive l'espoir de le faire en votre société et dans l'escorte de l'impératrice Théophano toujours auguste, est troublée par la défense que me fait mon seigneur. Prenez donc ma place en ami; faites que par votre entremise nous obtenions du seigneur pape le pallium, et que nous conservions les bonnes grâces de notre souveraine, après les avoir conquises grâce à vous. Avec la permission de Dieu, nous serons à son service à Pâques, et il n'y aura personne qui puisse nous détacher de la fidélité à sa personne et à celle de son fils (260). »
Théophano se comporta en Italie comme une vraie souveraine; elle prit le titre d'empereur, data d'après les années de son règne, envoya des missi en tournée d'inspection et siégea en justice (261). Elle n'oublia pas les intérêts de Notger, puisqu'elle obtint du pape Jean XV une bulle directement adressée à l'évêque de Liège, et renfermant des privilèges pour l'abbaye de Lobbes (262). Elle resta dans la péninsule jusqu'au printemps de 990. Le 1er avril de cette année, elle était encore à Ravenne; le 18 juin, nous la rencontrons, ainsi que Notger, à Francfort, où ils interviennent chacun dans un acte du roi daté de ce jour, lui pour Worms et elle pour Aquilée (263); il ne semble pas douteux qu'il soit revenu avec elle.
A peine rentré chez lui, Notger y apprenait, avec la mort de l'abbé Folcuin de Lobbes, la nouvelle que les moines de cette abbaye désiraient lui donner pour successeur son fidèle Hériger, qui venait de l'accompagner dans son voyage. Bien qu'il ait du éprouver de la peine à se séparer de cet excellent collaborateur, il déféra toutefois au désir qui lui était exprimé dans un document rempli des termes les plus flatteurs pour son ami (264), et Hériger alla prendre à Lobbes la crosse abbatiale, qu'il porta jusque vers la fin du pontificat de Notger. Il n'est pas téméraire de croire que ce dernier aura assisté à la consécration abbatiale, qui eut lieu à Lobbes le 21 décembre 990, jour de la fête de saint Thomas, par les mains de l'ordinaire diocésain, Rothard de Cambrai.
Dès le 28 juin 991, nous retrouvons Notger près de l'empereur à Nimègue, où il intervient dans un diplôme en faveur de l'église de Cambrai (265). Pour peu que son séjour à la cour se soit prolongé, il y aura été témoin de la mort de sa souveraine, l'impératrice Théophano, qui expira dans cette ville le 15 juin de cette année, à l'âge de 31 ans, après un veuvage de huit ans pendant lequel elle avait défendu avec une énergie virile et un dévouement sans bornes les droits de son fils à la couronne. Cette princesse byzantine, élégante et d'une culture supérieure à celle du milieu où elle fut appelée à vivre, n'y a pas rencontré les sympathies de tout le monde; on lui a reproché ce qu'on appelait son faste byzantin; on a pris ombrage de sa distinction de manières, qui contrastait avec la rudesse des moeurs saxonnes; on s'est offusqué de ses procédés de gouvernement, qui ne s'inspiraient pas de la tradition germanique; on s'est plaint de l'éducation trop peu nationale qu'elle donna à son fils, et la calomnie n'a pas toujours respecté sa réputation de femme. Mais Notger, qu'elle avait honoré de sa confiance et qui partageait son dévouement au royal orphelin, dut être douloureusement frappé par sa disparition, et de toute manière, il faut croire qu'il assista à ses funérailles, qui eurent lieu à Saint-Pantaléon de Cologne (266). Otton III perdait son meilleur appui à un âge où il avait encore grand besoin de guides et de conseils, et sa grand'mère Adélaïde ne pouvait, malgré son dévouement, suppléer les sollicitudes d'une mère. Le rôle de Notger auprès du jeune roi était appelé à grandir dans ces conjonctures; aussi ne faut-il pas s'étonner de le retrouver, pendant une bonne partie du printemps de 992, aux côtés de son royal maitre.
Le 11 mars 992, il est à la cour à Boppard, en qualité d'intervenant dans trois diplômes émis par Otton III en faveur de l'abbaye de Selz, fondation favorite de sa grand'mère l'impératrice Adélaïde (267). De là, la cour se transporta à Aix-la-Chapelle, où elle célébra la fête de Pâques (27 mars). Nous avons une preuve du séjour de Notger dans cette ville le 8 avril: c'est la date d'un diplôme par lequel, à la demande de sa grand'mère et de Notger, Otton III fit don des terres d'Ardenelle à l'abbaye de Nivelles (268).
Pendant ce séjour à Aix-la-Chapelle, Notger fut appelé à intervenir dans une affaire retentissante, qui passionnait alors tous les diocèses de France et d'Allemagne, et dont le héros était son ancien correspondant Gerbert.
Gerbert était monté sur le siège archiépiscopal de Reims dans des conditions très discutées. Son prédécesseur Arnoul, lors des troubles causés par l'avènement de la troisième dynastie, avait trahi la cause de Hugues Capet en livrant sa ville à Charles de Lorraine. Après la défaite du prétendant, on demanda compte au prélat de sa conduite, et un synode réuni à Saint-Basle le déposa et élut à sa place Gerbert (18 juin 991). Arnoul en appela à Rome, et le pape Jean XV fit soumettre l'affaire à un nouvel examen par un de ses légats, qui réunit dans ce but le concile d'Aix-la-Chapelle (269).
« Le légat, écrit un érudit de nos jours, n'osait évidemment venir en France même attaquer une sentence portée avec l'assentiment du roi de France » (270). II est inutile de dire qu'aucun évêque français n'assista à cette réunion qui devait juger la cause d'un évêque français. C'est cette circonstance, sans doute, qui infirma d'avance les délibérations du synode sur une question si délicate: il est permis de croire qu'il se sépara sans avoir pris aucune décision, et ainsi s'explique l'oubli dans lequel il est tombé.
Le concile doit avoir été tenu avant la fin d'avril, car, dans les derniers jours de ce mois, nous voyons l'évêque de Liège accompagner son souverain vers les frontières occidentales de l'Empire. Etait-ce une entrevue projetée avec le roi de France qui appelait Otton III dans les vallées de la Meuse et du Chiers, ces théâtres historiques de tant de rendez-vous royaux? On le croirait, mais l'histoire est muette, et nous ne pouvons faire que des conjectures. Passant par Brogne, où il doit avoir été le 30 avril (271), l'empereur, accompagné de Notger, se trouvait le 19 mai à Laneuville-sur-Meuse (272), et le 25 du même mois à Margut (273). Dès le 29, il était rentré à Trèves (274), d'où il regagna la Saxe.
L'année suivante, Notger eut l'honneur de recevoir Otton III à Liège, comme on le voit par un diplôme impérial daté de cette ville le 26 mars 993 (275). Le 17 avril de la même année, Notger était encore auprès du souverain à Ingelheim, intervenant dans une donation impériale en faveur de Magdebourg (276).
Cependant le légat du pape ne perdait pas de vue l'épineuse affaire de Gerbert, et, sous ses auspices, un second concile, où Notger doit s'être trouvé, se tint à Ingelheim en 994 (277). Les évêques français y firent défaut comme à Aix-la-Chapelle, mais, cette fois, le concile décida de délibérer sans tenir compte de cette espèce de protestation tacite. Il parait bien que, dès le principe, les évêques du royaume d'Allemagne n'envisagèrent pas d'un bon oeil la déposition d'Arnoul, et plusieurs d'entre eux, Willigis de Mayence à leur tête, avaient réclamé auprès de Jean XV (278). Quel était leur mobile? Etaient-ils convaincus que les prélats français avaient en cette matière violé les droits du Saint-Siège, ou voyaient-ils quelque danger grâve à procéder contre un évêque comme on l'avait fait contre Arnoul? N'obéissaient-ils pas peut-être, et en partie à leur insu, à un point de vue national qui les indisposait contre toute mesure prise en faveur de Hugues Capet? On peut croire que, chez plus d'un d'entre eux, les deux raisons auront influé à la fois. Quoi qu'il en soit, le synode d'Ingelheim condamna le concile de Saint-Basle, qui avait déposé Arnoul, et demanda au pape de casser sa sentence. Notger ne se sépara pas de ses confrères dans cette occurrence, et peut-être même fut-il de ceux qui se prononcèrent de la manière la plus catégorique, puisque, peu de temps après, Gerbert se plaignait d'avoir perdu son amitié et entreprenait de la reconquérir (279).
A la suite du synode d'Ingelheim, le pape crut pouvoir s'avancer, et il lança une sentence d'excommunication contre Gerbert. Mais l'énergique lutteur ne céda point, et un concile français, réuni à Chelles sous les auspices du roi Robert, prit résolument parti pour lui contre les rigueurs de l'épiscopat d'Allemagne. Il devenait évident qu'un débat purement canonique se transformait, grâce aux intérêts qui y étaient engagés de part et d'autre, en une querelle nationale. Le pape le comprit renonçant à poursuivre l'exécution de sa sentence, il essaya d'une nouvelle réunion des évêques allemands et français, qui fut préparée, cette fois, avec plus de prudence et de soin que les deux précédentes. Le choix qu'on fit de Mouzon comme siège de cette assemblée était excellent: situé aux confins de la France et de l'Allemagne, Mouzon appartenait politiquement à ce dernier pays, mais dépendait au spirituel de Reims, et ne pouvait inspirer aucune inquiétude à des évêques français. Ceux-ci, au surplus, soit qu'ils eussent été habilement travaillés, soit qu'ils se fussent rendu compte qu'ils ne pouvaient, sans imprudence et sans injustice, se dérober plus longtemps aux volontés du Souverain Pontife, étaient, à ce qu'il semble, disposés à se rendre en grand nombre à Mouzon, où Gerbert lui-même se préparait à comparaître (280). Mais Hugues Capet crut devoir intervenir avec éclat: au dernier moment, devinant le danger que courait son protégé, il fit défense à ses évêques de répondre à l'appel du légat, et Gerbert, bravant l'interdiction du roi, partit seul pour Mouzon (281). L'homme qui avait tant fait pour affermir le trône d'Otton III allait donc comparaître devant un tribunal où siégeaient les évêques de ce jeune prince, dans une question où il y allait de son honneur, de sa dignité, du repos de toute sa vie. Il n'était pas résigné à se laisser écraser; une lettre qu'il avait écrite quelque temps auparavant à Notger nous en fournit la preuve. Dans cette lettre, où il dit connaître la cause du changement d'attitude de son ancien ami, il lui envoie la justification qu'il venait d'écrire à la demande de Wilderod, évêque de Strasbourg, et il déclare qu'il fait tous ses efforts pour obtenir la réunion d'un concile sinon oecuménique, du moins franco-allemand, pour y être jugé, tant il a confiance dans la justice de sa cause et dans son innocence. « Je vous en supplie, écrit-il en finissant, ne vous en rapportez pas, sur mon compte, à mes ennemis plutôt qu'à vous-même. Voyez si je suis resté ce que j'étais, c'est-à-dire dévoué à votre personne, prêt â votre service, en général fidèle à mes amis, ami passionné de la justice et de la vérité, sans dol et sans superbe, et honoré de votre amitié. Ne l'ayant pas perdue par ma faute, je la redemande à votre droiture; je m'affligerais qu'elle me fût refusée, et j'éprouverai une grande joie si elle m'est rendue (282). »
Notger dut être ému de ce langage de l'homme qu'il avait connu si puissant, et qui aujourd'hui, dans sa détresse, était obligé d'invoquer le secours, peut-être la pitié de ses anciens amis. Nous le trouvons le 23 avril de cette année à Aix-la-Chapelle, où il intervient dans une donation impériale en faveur de l'église de Cambrai et de son évêque Rothard. Quelque temps après, il partait pour Mouzon, où le concile devait se réunir le 2 juin. L'évêque de Liège y trouva Suitger de Munster, Leodulf de Trêves, et Aymon de Verdun, avec le légat Léon (283) et le comte Godefroi. Devant cette petite réunion, Gerbert se défendit avec vigueur et habileté; son discours, dont Richer nous a conservé le texte, et dont l'authenticité ne semble pas douteuse, était en réalité un mémoire rédigé d'avance (284). Le concile, trop peu nombreux et considérant d'ailleurs qu'en l'absence de la partie adverse la cause ne pouvait pas être tranchée, décida de se proroger à une réunion qui devait être tenue le 1 juillet à Reims; en attendant, il voulut, pour donner une preuve de déférence au pape représenté par son légat, interdire à l'accusé le ministère sacerdotal et la communion; mais, cette fois encore, la défense de Gerbert fut si énergique et si modérée, qu'on se contenta de la promesse qu'il s'abstiendrait du sacrifice de la messe.
Notger, dans toute cette affaire, ne parait pas avoir joué de rôle prépondérant, soit parce qu'il croyait devoir à sa dignité de s'enfermer strictement dans sa qualité de juge, soit parce que l'évêque de Verdun, qui fut l'orateur principal du concile, était le seul de l'assemblée qui possédât la langue française (285). Au surplus, l'affaire de Gerbert, toujours reprise et toujours ajournée, ne fut jamais terminée, et son départ pour l'Italie, où bientôt après il fut élevé au siège archiépiscopal de Ravenne, mit fin à un des débats les plus embrouillés de ce temps.
On voudrait savoir quelle influence ces événements ont pu exercer sur les relations des deux anciens amis, et l'on est assez tenté de supposer que Notger aura jugé avec sévérité le cas de Gerbert, quand on voit, peu de temps après, un ancien élève et protégé de l'évêque le Liège, Erluin, qui avait obtenu l'évêché de Cambrai grâce à son appui, refuser de se faire consacrer par Gerbert, qu'il considérait comme un intrus (286). Toutefois, Gerbert, devenu pape quelques années après sous le nom de Silvestre II, ne garda pas rancune à Notger, et c'est lui-même qui intervint auprès d'Otton III pour faire accorder une libéralité à l'église Saint-Jean l'Evangéliste, que l'évêque de Liège venait de fonder dans sa ville épiscopale (287).
Pendant cette même année 993, la haute influence dont Notger jouissait à la cour s'affirma à deux reprises, à l'occasion de nominations épiscopales. L'évêque Baudouin d'Utrecht était mort le 10 mai 994, et l'évêque Rothard de Cambrai l'avait suivi dans la tombe le 20 septembre 995. C'est l'évêque de Liège, qui, en sa qualité de conseiller toujours écouté de l'empereur pour les affaires lotharingiennes, va disposer des deux sièges vacants. Celui d'Utrecht fut conféré, en 995, sur sa recommandation, à un pieux laïque, le comte Ansfrid, aussi distingué par ses vertus chrétiennes que par ses qualités d'homme de guerre, et qui avait joui dans sa jeunesse de la confiance d'Otton I (288). Le siège de Cambrai fut plus difficile à pourvoir, et les rivalités qui se produisirent à ce sujet nous permettent de nous rendre compte de la manière dont, à l'époque la plus brillante de la dynastie de Saxe, on parvenait à un siège épiscopal. La succession de Rothard fut disputée par Erluin, archidiacre de Liège, protégé par Notger et par Azelin de Tronchienne, fils naturel du comte Baudouin de Flandre. Erluin était versé dans les affaires séculières et ecclésiastiques; ayant fréquemment visité les antichambres des grands, il possédait beaucoup d'utiles relations. De plus, Notger le recommanda à Mathilde, abbesse de Quedlinbourg et tante d'Otton III, dont elle avait la confiance. Azelin, lui, se procura à prix d'argent l'appui de la princesse Sophie, soeur de l'empereur et abbesse de Gandenheim. Ces deux influences féminines se disputèrent le prince; ce fut celle de Mathilde qui finit par l'emporter, et Otton donna la crosse au protégé de l'évêque de Liège (289).
L'année suivante, Otton partit pour l'Italie, où il allait chercher la couronne impériale. Les princes ecclésiastiques avaient été les plus empressés à lui amener leurs contingents, Willigis de Mayence à leur tête. Notger fut aussi au rendez-vous à Ratisbonne (290) c'était le troisième voyage d'Italie qu'il entreprenait pour le service de ses rois. En février 996, l'armée impériale se mit en route. Par le col du Brenner encore couvert de neige, on pénétra en Italie, et l'on descendit par la vallée de l'Adige sur Vérone; de là on gagna Pavie, où le roi réunit autour de lui les grands du pays et où il passa la fête de Pâques. C'est là qu'il apprit la nouvelle de la mort du pape Jean XV et qu'il lui choisit pour successeur son propre cousin Brunon, qui prit le nom de Grégoire V (291)
Le nouveau pape semble avoir été un ami personnel de Notger: il avait été chapelain de l'empereur, et, comme tel, il avait eu l'occasion de le rencontrer plus d'une fois à la cour. A peine consacré - ce fut entre le 28 avril et le 9 mai (292) - nous le voyons prendre successivement plusieurs mesures dans lesquelles l'influence de notre évêque est visible.
Pendant que Grégoire V gagnait Rome pour s'y faire consacrer, l'empereur s'acheminait à petites journées vers la Ville éternelle. Le 20 avril, il était à Crémone (293), et le 1er mai à Ravenne (294). Notger, qui l'avait accompagné dans cette ville, y assista au plaid général convoqué au palais de l'empereur, hors la porte Saint-Laurent. Ce plaid fut des plus solennels: neuf évêques et un grand nombre de comtes et d'abbés y prirent part, et, chose remarquable, c'est le nom de Notger qui ouvre la longue liste de tous ces dignitaires, comme c'est aussi le sien qui figure en premier lieu parmi ceux des signataires de l'acte (295).
De Ravenne, l'empereur et sa suite gagnèrent Rome, où l'on était dès le 22 mai. Le lendemain, Otton III reçut la couronne impériale des mains de son cousin Grégoire V. Notger avait assisté à cette cérémonie grandiose. Le 24, le pape émettait, au profit de l'abbaye de Villich, fondation de l'impératrice Adelaïde, une bulle de privilèges sollicitée par Hildebold de Worms et par Notger (296). Puis, il consacra lui-même Erluin de Cambrai, élève de ce dernier, qui, nous l'avons dit, avait refusé de demander l'ordination à son métropolitain Gerbert (297). Le 2 juin, le pape accorda à l'abbaye de Stavelot la confirmation de ses biens, et, quoique Notger ne soit pas nommé dans l'acte, il n'y a pas lieu de douter qu'il n'ait appuyé la demande de ce monastère, qui était de son diocèse (298). Enfin, le 3 juin, Notger fut intervenant dans un diplôme impérial pour le couvent de Saint-Boniface et de Saint-Alexis sur l'Aventin (299).
Pendant son séjour à Rome, Notger fit la connaissance d'un homme qui semble avoir occupé une grande place dons son coeur: saint Adalbert de Prague. Fils d'une grande famille, jeune, riche, brillant de santé, appelé, semblait-il, à toutes les joies du monde, Adalbert était de bonne heure entré dans les ordres et avait été appelé sur le siège épiscopal de Prague. Mais aucune grandeur, pas même celle des dignités ecclésiastiques, n'avait d'attrait pour le coeur du jeune ascète. Il avait fui Prague et il était venu s'enfermer comme moine dans le couvent de Saint-Alexis. Rappelé dans son diocèse par les instances de son métropolitain, il s'était réfugié de nouveau à Saint-Alexis, et, une seconde fois, les démarches de Willigis auprès du pape le forcèrent à regagner son siège. Il quitta en pleurant le doux nid de l'Aventin où il avait trouvé le vrai milieu de son âme, et il prit avec accablement le chemin qui devait le ramener au milieu de ses barbares ouailles (300). Ame délicate et sensible, et, de plus, imagination enivrée par l'idée des héroiques renoncements de la vie monastique et des sublimes travaux de l'apostolat, il ne se sentait pas fait pour le gouvernement régulier d'un diocèse. Mais ce qu'il y avait de poétique et d'exalté dans sa nature était fait pour séduire ses contemporains, et le jeune empereur fut un des premiers amis du jeune prélat.
Notger, lui aussi, semble avoir été sous le charme d'une nature à tant d'égards différente de la sienne. Il avait eu l'occasion de fréquenter Adalbert pendant son séjour à Rome, et il l'accompagna à son retour en Allemagne. Les deux amis firent en deux mois le voyage de Rome à Mayence, où l'empereur les rejoignit vers la mi-septernbre (301). Là, ils se séparèrent pour toujours. La cour gagna le nord; le 18 décembre 996, elle était à Nimègue (302), le 8 février 997, à Aix-a-Chapelle, où nous la retrouvons encore le 25 mars, ainsi que le 6 et le 9 avril (303). C'est le 9 que l'empereur confirmait l'église de Saint-Jean de Liège, bâtie par Notger, dans la possession de ses biens de Heerwaarden (304).
On peut croire, puisqu'il n'existe aucun témoignage du contraire, qu'après cela Notger sera resté dans son diocèse, et qu'il aura pu y passer au moins quelques mois, pendant que l'empereur visitait la Saxe et les pays slaves. Il ne jouit cependant pas longtemps du repos. Du 1er au 27 octobre, Otton séjourna à Aix-la-Chapelle, où il préparait une nouvelle expédition en Italie. Dès le 1er du même mois, Notger était auprès de sa personne, intervenant dans un diplôme impérial en faveur de l'église de Mantoue (305). Il accompagna encore son maitre dans ce nouveau voyage d'Italie; c'était la quatrième fois qu'il passait les Alpes. Nous retrouvons l'empereur à Trente le 13 décembre 997; du 31 décembre au 5 janvier 998, ii était à Pavie; le 19 janvier il fut à Crémone, où Notger assista avec lui à une réunion judiciaire dans laquelle l'authenticité d'un diplôme de l'église de Crémone fut reconnue (306). Le séjour de l'empereur en Italie fut long; il y passa les années 998 et 999 en entier, et c'est seulement le 1er janvier 1000 qu'on le retrouve à Vérone, sur le chemin du retour. En avril 999, il avait élevé sur le siège de saint Pierre son ancien maitre Gerbert, qui prit comme pape le nom de Silvestre II.
Pendant tout ce temps, nous perdons presque totalement de vue l'évêque de Liège. Son nom ne reparait plus dans aucun des nombreux diplômes que l'empereur émit depuis le 19 janvier 998 jusqu'à sa mort, arrivée le 23 janvier 1002. Et cela ne laisse pas d'étonner, quand on réfléchit à la place qu'il avait conquise dans la confiance du souverain, et au rang éminent que nous lui voyons occuper dans les derniers actes de la chancellerie impériale qui font mention de lui. Pourquoi Notger, qui, pendant les douze premières années du règne d'Otton III, a été treize fois (307) intervenant dans ses diplômes, c'est-à-dire en moyenne un peu plus d'une fois par année, n'intervient-il plus du tout pendant les cinq dernières du même règne? Il ne figure même pas dans les actes émis au sujet de la Lotharingie, dont il était en quelque sorte le patron à la cour. L'empereur instrumente en faveur d'Utrecht, de Metz, d'Oeren à Trèves, et même d'Aix-la-Chapelle, sans qu'il soit parlé de Notger. Bien plus, les intérêts de son ami Erluin de Cambrai eux-mêmes lui semblent devenus indifférents, puisque l'acte en faveur de ce prélat daté de Ravenne le 21 avril 1001, ne fait pas mention de lui! Ajoutons que ce n'est pas seulement dans les actes impériaux passés en Italie que nous constatons son absence. Pendant le cours de l'an 1000, Otton III, de retour en deçà des Alpes, émit 31 diplômes, et l'évêque de Liège ne figure dans aucun. Et cependant, du 1er au 15 mai, la cour résidait à Aix-la-Chapelle, à quelques lieues de Liège, dans le diocèse même de Notger. Se persuadera-t-on qu'il eût manqué de venir saluer son maitre s'il avait été chez lui? Nous croyons pouvoir conclure que, pendant les années 998 et 999, il ne fut pas auprès de la personne de l'empereur, et qu'en l'an 1000, il n'était pas dans son diocèse.
Où donc était-il? Tout s'expliquera, encore une fois, si l'on admet que, comme en 989-990, l'évêque de Liège, pendant les années 998 à 1002, eut à remplir quelque importante mission politique pour l'empereur dans une des régions de cette Italie, si difficile à pacifier et à gouverner. D'abord, nous possédons au moins une trace positive de la présence de Notger en Italie pendant cette période. A la Noel 1001, il parait être venu faire sa cour à l'empereur, qui résidait alors à Todi près de Spolète. Du moins, le 27 du mois de décembre, il assista au concile qui y fut tenu par les évêques italiens, auxquels s'étaient joints, outre lui-même, deux prélats allemands, Sigefroi d'Augsbourg et Hugues de Zeitz (308). Ensuite, il semble que ce soit ici le lieu de se souvenir du diplôme relatif à ce missus impérial du nom de Norticherus, que l'empereur Otton avait chargé de pacifier le pays de Traetto. On a vu plus haut que ce diplôme, mal daté par son premier éditeur, est en réalité de 999. Est-il téméraire de supposer que Notger, en qualité de commissaire impérial, parcourait alors la Basse-Italie, avec la double mission de justicier et de pacificateur? (309). Cette séduisante hypothèse semblerait confirmée par la circonstance que le texte en question attribue formellement au dit missus la qualité de Lotharingien. Est-il admissible qu'il y ait eu dans notre pays, sous le règne d'Otton III, un autre personnage du nom de Notger qui aurait accompagné l'empereur en Italie, qui y aurait été investi de missions de confiance, et dont l'histoire aurait totalement oublié le nom? Je ne le pense pas, et le fait que notre document, par une erreur qui s'explique, donne au commissaire impérial le titre de clerc et de chapelain de l'empereur, et non celui d'évêque (310), ne me semble pas suffisant pour écarter une identification qui vient
Cela étant, on entrevoit pour quelle raison notre évêque est si souvent appelé à accompagner son roi dans ses voyages d'Italie. Il ne partait pas simplement pour rehausser par sa présence l'éclat de la cour et pour prendre place dans un cortège brillant; il ne se contentait pas d'être l'un des conseillers les plus écoutés du prince, il devenait, au-delà des Alpes, l'un des agents de la politique impériale; il parcourait le pays avec des pouvoirs étendus, à la manière d'un missus dominicus de Charlemagne, travaillant avec énergie à réaliser dans le gouvernement de cette contrée le programme qu'il avait contribué à arrêter (311).
On peut croire qu'investi d'une mission aussi importante, Notger aura été retenu en Italie par ses fonctions pendant que l'empereur, dans les premiers jours de l'an 1000, repassait les Alpes pour aller revoir une dernière fois l'Allemagne, et faire un pèlerinage au tombeau de son ami Adalbert à Gnesen. Et cette longue absence de son diocèse paraitra d'autant plus vraisemblable, qu'elle est suggérée par le texte même du Vita Notgeri. Après avoir raconté la part prise par l'évêque aux actes d'Otton III en Italie et fait un récit sommaire de ce règne, il ajoute: « Notger enfin, après tant de travaux par lesquels il s'était employé heureusement au service de l'empire et à la beauté de la maison de Dieu, rentra à Liège dans un âge déjà avancé, et là, il mit tout son zèle à l'éducation de son clergé et de son peuple (312) ». Ces lignes sont une allusion évidente à quelque longue absence de l'évêque, après laquelle son retour à Liège a eu comme la valeur d'un événement. Elles s'expliqueraient moins bien, s'il fallait les entendre d'un de ses retours ordinaires après un voyage plus court dans le même pays et au service du même prince.
Si notre conjecture est fondée, le séjour de cinq années fait par Notger en Italie, dans un poste aussi important que celui de lieutenant du prince, doit avoir laissé plus de traces diplomatiques qu'une simple mention dans un acte conservé par hasard. Qui sait si l'histoire locale, judicieusement consultée, ne fournirait pas encore de ci de là quelque indication précieuse (313) ?
Ainsi que nous l'avons dit, Notger assista le 27 décembre 1001 au concile de Todi. Cette assemblée devait prononcer entre le puissant Willigis, archevêque de Mayence et archichancelier de l'empire, et l'illustre évêque saint Bernward de Hildesheim, au sujet de leurs prétentions respectives sur l'abbaye de Gandersheim en Saxe. La cause de Willigis apparut si mauvaise que les évêques italiens se montrèrent tout disposés à le condamner. Ce furent sans doute Notger et ses deux collègues allemands qui obtinrent un délai jusqu'à l'arrivée de l'archevêque de Cologne et d'autres évêques de son pays. On prorogea donc le concile jusqu'au 6 janvier 1002, mais, à cette date, personne ne parut et rien ne put être décidé (314). Peu de temps après, Otton III, mourait dans la fleur de sa jeunesse, à Paterno, le 24 janvier 1002 (315).
Il est très peu probable que Notger ait quitté l'Italie dans l'intervalle qui s'écoula entre le concile de Todi et la mort du jeune empereur. Selon toute apparence, il devait siéger au concile du 6 janvier 1002, et il est certain, tout au moins, qu'à cette date il était en Italie, puisqu'il assista aux funérailles de son maitre. Un coup d'oeil sur les événements est indispensable pour permettre de deviner comment se sera passée la fin du long séjour de notre évêque en Italie.
Otton était rentré dans ce pays au mois de juin 1000 et était arrivé dès le mois de novembre à Rome. On eût dit que les troubles n'attendaient que son retour pour éclater. Successivement Capoue, Tibur, puis finalement Rome se soulevèrent. L'empereur dut quitter la Ville Éternelle pour se rendre à Ravenne, d'où nous le voyons, au commencement de l'été, courir à Bénévent pour dompter une rébellion. En revenant de là, il regagna la Haute-Italie, séjourna tour à tour à Pavie et à Ravenne, puis, dans les premiers jours de 1002, il vint camper dans le voisinage de Rome, à Paterno, au pied du mont Soracte, avec l'intention de réduire la Ville Eternelle. On ne peut douter que Notger ait eu son rôle à jouer dans les difficultés que nous venons d'énumérer, et qui ne durent pas être les seules. Il fut probablement employé, pendant ce temps, à dompter ou à tenir en respect l'une des villes soulevées. On peut croire que, voulant disposer de toutes ses forces pour briser la rébellion romaine, l'empereur l'aura rappelé auprès de sa personne dans les derniers jours de sa carrière (316), et que Notger aura pu fermer les yeux du prince. Toutefois, il n'est pas impossible qu'il n'ait rejoint la cour qu'à la nouvelle de la mort de l'empereur, lorsqu'il fallut faire un suprême effort pour protéger la retraite de l'armée allemande (317). On avait, dans l'entourage du prince, commencé par tenir sa mort secrète, et, en attendant, on s'occupait en toute hâte à rassembler l'armée dispersée en divers endroits.
Ainsi se terminait d'une manière mélancolique le long séjour de l'évêque de Liège sur la terre d'Italie. C'était le quatrième qu'il y faisait. Il en revenait vieilli, fatigué, attristé, mais avec la conscience des services qu'il avait rendus à son maitre et à l'Eglise. Ce long contact avec la terre classique des arts et de la religion n'avait pas été inutile au pays de Liège: Notger en rapportait des enseignements précieux et aussi des reliques chères aux Liégeois. C'est notamment au cours d'un de ses voyages en italie qu'il avait acquis les reliques des saints Vincent, Fabien et Sébastien: il les donna à son église favorite de Saint-Jean (318), avec ce précieux évangéliaire qui est encore aujourd'hui le principal souvenir que a ville de Liège ait gardé de lui.
|
CHAPITRE VIII
NOTGER AU SERVICE D'HENRI II

De nouveau la situation de l'empire était critique. La mort du jeune empereur, qui n'avait pas d'héritier direct, laissait l'Allemagne en proie à toutes les complications. L'Italie était hostile; elle se préparait manifestement à secouer le joug impérial, et déjà Ardouin commençait à se remuer. Les Allemands étaient comme prisonniers en Italie; on se levait pour leur fermer le chemin du retour: Burchard de Worms eut grand'peine à se dégager à Lucques (319). Les rebelles ne surent pas même respecter le triste cortège qui reportait dans sa patrie, conformément à son dernier désir, le corps du jeune empereur désabusé de cette terre romaine qu'il avait tant aimée. Il fallut, les armes à la main, frayer au cadavre impérial le chemin du tombeau. Notger était de ceux qui rendirent au défunt ce suprême devoir de fidélité, avec l'archevêque de Cologne, les évêques d'Augsbourg et de Constance, le duc Otton de Lothier et les comtes Henri et Wichmann. Après sept jours de marche et plus d'un combat, on gagna Vérone, d'où l'on rentra en Allemagne par le col du Brenner. A Polling sur l'Ammer vint à la rencontre de l'empereur défunt son cousin Henri de Bavière, fils du remuant personnage qui, une vingtaine d'années auparavant, avait essayé d'enlever au jeune souverain le trône de ses ancêtres. Plus fidèle et plus heureux que son père, Henri voyait s'ouvrir devant lui l'espérance d'un héritage qu'il ne devait qu'à son droit. Il était accompagné d'une grande suite d'évêques et de comtes qui, avec lui, grossit le funèbre cortège. C'est ainsi qu'on arriva à Augsbourg, où, pour entrer dans la ville, Henri voulut porter le cercueil sur ses propres épaules. Après que les entrailles du défunt eurent été déposées à Sainte-Afra, auprès du tombeau de saint Ulric, Henri accompagna le cortège jusqu'à Neuberg sur le Danube. Là, on se sépara, le futur empereur allant défendre ses intérêts déjà menacés, pendant que le cercueil continuait son itinéraire jusqu'à Aix-la-chapelle, où le petit-fils d'Otton-le-Grand alla dormir son dernier sommeil à côté de Charlemagne (320).
Sans doute, Henri, qui était le plus proche parent du défunt, avait profité de l'occasion pour se recommander aux évêques du cortège et pour leur demander leur voix. Rien n'était plus important pour lui que de se réclamer de ceux qui avaient en quelque sorte recueilli le dernier souffle de l'empereur. Mais il ne parait pas qu'alors aucun d'eux se soit catégoriquement prononcé en sa faveur, sauf l'évêque Sigefroi d'Augsbourg (321). Herman de Souabe avait plusieurs partisans; Héribert de Cologne lui-même, le jour des funérailles d'Otton à Aix-la-Chapelle (5 avril 1002), avait chaudement recommandé cette candidature. On ne sait ce que pensa et fit Notger, mais l'attitude qu'il garda par la suite porte à croire qu'il se rallia de bonne heure à la cause d'Henri. Bientôt le parti d'Herman faiblit, et, le 6 juin 1002, Henri II fut couronné roi d'Allemagne à Mayence par Willigis. A partir de ce moment, sa cause ne cessa de gagner du terrain (322). Ii avait précédemment visité la Franconie, la Souabe, la Saxe; il lui restait à se faire reconnaître en Lotharingie. En août 1002, il était à Duisbourg, où il avait convoqué les évêques lotharingiens. Notger y fut des premiers avec son ami Erluin de Cambrai; leurs confrères arrivèrent plus tard, l'un après l'autre. L'archevêque de Cologne lui-même n'osa pas manquer au rendez-vous (323). Suivi des évêques, le roi s'achemina par Nimègue et Utrecht vers Aix-la-Chapelle, où son couronnement solennel eut lieu en grande pompe, le 8 septembre 1002. Dès le lendemain, nous voyons Notger intervenir dans le diplôme par lequel Henri II confirmait la propriété de Kusel à l'abbaye de Saint-Remi de Reims (324).
Rentré à Liège après le couronnement, Notger pouvait enfin se donner à son cher diocèse, qu'il avait quitté depuis cinq ans. Il s'y prépara tout d'abord à recevoir la visite de son auguste maitre. D'Aix-la-Chapelle, où il avait assisté le 24 janvier 1003 à l'anniversaire de son prédécesseur (325), l'empereur était allé vénérer les reliques de saint Servais à Maestricht, puis il vint à Liège faire ses dévotions au tombeau de saint Lambert. C'est là qu'au dire d'un chroniqueur, il obtint, par l'entremise de ce saint, d'être délivré de ses souffrances physiques (326).
Le repos du vieil évêque de Liège ne devait être que relatif. Dès 1004, il assistait à un concile tenu par l'empereur on ne sait au juste où, mais très probablement dans les région occidentales de l'empire (327). Dans cette réunion, le roi s'éleva
avec force contre les mariages entre proches et signala le cas de Conrad, duc de Franconie, qui avait épousé sa parente. Ce fut, au dire d'un contemporain, l'occasion d'une vive querelle, et le concile faillit dégénérer en bagarre. On comprendra mieux l'épisode quand on saura que ce Conrad était le gendre d'Herman de Souabe, qu'il avait porté les armes contre l'empereur et qu'au zèle pour la pureté du mariage se joignait probablement, chez Henri II, le désir de rompre, si possible, le lien qui rattachait le puissant duc de Franconie à un dangereux rival.
En 1005, nous retrouvons Notger à la cour impériale à Aix-la-Chapelle, et c'est là que, le 5 avril, Henri II lui accordait un diplôme de confirmation pour son église de Sainte-Croix (328). Le 7 juillet de la même année, l'évêque de Liège était au concile de Dortmund. Le roi y fit prohiber par le synode plusieurs abus qui se passaient dans l'Eglise. Il s'y fonda aussi une association de prières entre les évêques, les prêtres et les laïques présents. A la mort de chaque évêque, les associés devaient, dans le délai de trente jours, célébrer la messe pour lui, nourrir trois cents pauvres, donner trente deniers d'aumône et allumer trente cierges; d'autres obligations du même genre étaient faites aux prêtres et aux laïques. Le concile détermina aussi les jeûnes qui auraient lieu aux Vigiles et aux Quatre-temps (329).
L'empereur Henri II accordait à l'évêque de Liège une confiance égale à celle dont il avait joui sous le règne du dernier Otton. Ce qui le prouve, c'est qu'il le choisit en 1006 pour remplir une mission des plus difficiles et des plus honorables, en l'envoyant à Paris négocier un traité avec le roi de France Robert (330). Il s'agissait, selon toute apparence, d'une guerre à entreprendre en commun contre Baudouin IV, comte de Frandre, dont l'ambition offusquait également les deux souverains. En renvoyant sa femme Rozala-Suzanne, veuve en premières noces d'Arnoul de Flandre et belle-mère de Baudouin, le roi Robert avait jeté entre lui et son puissant vassal un germe d'inimitié, ou, tout au moins, lui avait fourni un prétexte jour légitimer toutes ses entreprises. D'autre part, le comte venait de s'emparer de Valenciennes sur l'Escaut; il menaçait directement le Cambrésis, où l'évêque Erluin continuait de soutenir courageusement la lutte contre tous les ennemis de l'empire. Henri II ne pouvait rester impassible devant une telle insolence s'il voulait que l'empire fût respecté de ses voisins, il devait à tout prix mettre à la raison l'outrecuidant feudataire. En outre, Notger, qui, dans les derniers temps, avait inspiré toutes les mesures relatives au Cambrésis, qui était auprès des empereurs le patron des intérêts lotharingiens, qui était de plus l'ami particulier d'Erluin, ne sera certainement pas resté étranger aux délibérations d'Henri II; le choix même que l'empereur fait de lui pour négocier Paris semble indiquer qu'avant de préparer la mesure il l'avait conseillée (331).
C'est pendant son séjour à Paris que Notger eut à s'occuper d'un clerc de son église, nommé Hucbald, qui, étant encore adolescent, s'était enfui de Liège dans la grande ville française, où il était entré à l'abbaye de Sainte-Geneviève, et où il s'était fait une brillante réputation comme professeur. A la sollicitation des chanoines de la célèbre abbaye, l'évêque de Liège consentit à reprendre en grâce le clerc fugitif, et même il lui permit de passer trois mois de l'année dans l'abbaye (332).
Ce fait est plein d'intérêt sans doute, mais on regrette de n'être pas mieux renseigné sur les négociations de Notger avec la cour de France. Ce qu'on sait, c'est qu'elles furent couronnées de succès, car, peu après le retour de Notger, en juin ou en juillet, les deux souverains eurent une entrevue sur les bords de la Meuse, aux confins de leurs royaumes respectifs (333). Là fut décidée l'entreprise commune contre le turbulent comte de Flandre. Il faut croire que l'empereur était pleinement satisfait des services que Notger lui avait rendus à cette occasion, car, le 10 juin 1006, par un diplôme daté d'Erstein en Alsace, il lui accordait la confirmation de toutes les propriétés de l'église de Liège. Si cette induction est fondée, nous serons amenés à placer avant le mois de juin le départ de l'évêque pour Paris.
L'expédition des deux rois contre la Flandre eut lieu au mois de septembre de la même année (334); le but immédiat en était, parait-il, d'enlever Valenciennes au comte. Mais, malgré les efforts réunis des forces françaises et allemandes, aidées par celles du duc Richard de Normandie, le siège fut infructueux, et Henri dut regagner son royaume sans avoir pu châtier l'orgueil du fier Baudouin (335). Celui-ci, enflé de son succès, se crut assez fort pour pouvoir menacer l'évêque Erluin de Cambrai, dont on sait la fidélité à l'empire (336) et le dévouement à Notger. L'attaquer, c'était attaquer l'évêque de Liège lui-même, et dans son patriotisme - Erluin gardait l'extrême frontière de l'empire - et dans ses amitiés personnelles. Aussi, quand l'évêque de Cambrai accourut en toute hâte auprès de l'empereur pour l'appeler au secours, il n'est pas douteux qu'il se soit arrêté à Liège auprès de son ami et ancien maitre Notger, et que celui-ci soit énergiquement intervenu à la cour en sa faveur.
Le vigoureux vieillard était alors septuagénaire, mais son ardeur au service de l'Empire restait entière. Le 25 mai 1007, jour de la Pentecôte, il était à Mayence, au plaid impérial dans lequel on expédia une affaire qui touchait singulièrement au coeur de l'empereur. Henri, évêque de Würzbourg, y consentit enfin, moyennant des compensations, à laisser détacher de son évêché la ville de Bamberg, dont l'empereur et l'impératrice avaient richement doté l'église et où ils voulaient fonder un siège épiscopal (337). L'évêque de Liège était encore à la cour le juin, car, à cette date, il fut intervenant dans un diplôme royal en faveur de l'abbaye de Thorn (338). Nous avons le droit de croire qu'il ne laissa pas oublier à Henri II les intérêts d'Erluin et la nécessité de châtier le comte de Flandre, bien que ce souverain énergique n'eût guère besoin qu'on lui rappelât ses amis ni ses ennemis. Le 8 juillet, suivi sans doute de Notger, Henri était à Aixl-a-Chapelle, où se réunissait son armée, et d'où il prit le chemin de la Flandre. Cette fois, la fortune abandonna Baudouin: après avoir attendu vainement son ennemi derrière l'Escaut, dont il lui disputa le passage, il le vit passer le fleuve grâce à un stratagème et se jeter sur Gand, où Henri entra le 19 août 1007, accueilli en souverain par les moines de Saint-Bavon. Alors Baudouin sentit l'impossibilité de continuer la lutte: il restitua Valenciennes à l'empereur, lui donna des otages et lui prêta serment de fidélité. L'empereur, préférant avoir en lui un ami, lui rendit plus tard Valenciennes en fief avec les îles de la Zélande (339).
Notger fut-il des deux expéditions de Henri II contre la Flandre? On est assez porté à croire qu'à moins de raisons graves, comme celles qu'il aurait pu tirer de son grand âge et de ses infirmités, il n'a pas dû manquer à des luttes où la sécurité de son propre pays était si nettement engagée. Nous serions plus affirmatif, au moins en ce qui concerne la seconde expédition, si nous pouvions ajouter foi au récit d'un chroniqueur liégeois du XIIIe siècle, dont l'autorité, à vrai dire, est bien faible pour des événements du XIe. D'après Gilles d'Orval, l'empereur, ayant échoué dans sa première entreprise sur Valenciennes, aurait appelé au secours Notger, et, avec l'aide de ce prince, serait allé prendre Gand, ce qui aurait déterminé la soumission de Baudouin (340). Il est bien inutile de s'attarder à réfuter ce récit, mais peut-être avons-nous le droit de voir dans la tradition conservée par Gifles d'Orval le souvenir de la participation réelle de Notger à la dernière guerre contre la Flandre. Si, comme nous le supposons, Notger est entré à Gand avec l'empereur, il y aura retrouvé, parmi les moines de Saint-Bavon, quelques uns des amis qu'il s'y était faits dans les jours de sa jeunesse, lorsque, une génération auparavant, il était venu visiter cette même ville sous les drapeaux d'un autre empereur. Gand marquait en quelque sorte le commencement et la fin de sa carrière d'homme de guerre.
L'expédition de Flandre fut, dans tous les cas, la dernière à laquelle il prit part, et il ne rentra dans sa ville épiscopale, si l'on peut ainsi parler, que pour mourir (341). Il avait servi tous les princes de la dynastie de Saxe, à part le premier, et la plus grande partie de son existence s'était écoulée à leur service. Il avait contribué à sauver le sceptre du troisième Otton et à procurer l'élévation de son successeur; il avait été quatre fois en Italie, et il s'était écoulé des années entières sans que la sollicitude des affaires publiques lui permit de reprendre le chemin de son pays. Jusqu'à sa dernière heure, l'Empire eut en lui un de ses serviteurs les plus intelligents, les plus énergiques, les plus dévoués. C'est lui qui désigna au choix de l'empereur un évêque d'Utrecht et deux évêques de Cambrai. Plusieurs fois, il avertit son souverain des menées françaises, et on peut croire que, sans sa vigilance, Otton II serait tombé aux mains du roi Lothaire. Il marcha sous les drapeaux de l'empire contre tous les ennemis, et, dans ce Lothier toujours si remuant, il créa, par son exemple et par ses oeuvres, une atmosphère de respect et de prestige autour du trône impérial.
|
CHAPITRE IX
FORMATION DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIEGE
Le lecteur qui s'est rendu compte, par le chapitre qui précède, de la part que Notger a prise aux affaires générales de l'empire, se sera demandé plus d'une fois comment il a pu trouver le temps de s'occuper de son diocèse. Les diocésains du grand évêque eussent pu renverser la question et demander comment le père de la patrie liégeoise, le créateur de la ville et de la principauté a trouvé le loisir nécessaire pour vaquer aux intérêts de l'empire (342). Rien, semble-t-il, ne peint mieux que ce simple rapprochement la féconde activité d'un homme qui a su, en quelque sorte, se dédoubler, et accomplir des choses également grandes à l'intérieur et à l'extérieur.
On est généralement d'accord pour voir en Notger le fondateur de la principauté de Liège. Et cela est vrai en ce sens que non seulement il fut le premier prince de ce pays, mais encore que son initiative personnelle contribua puissamment à l'organisation du pouvoir princier. Mais il s'en faut de beaucoup que l'Etat Liégeois, non plus que les autres principautés ecclésiastiques de l'empire, ait été créé de toutes pièces, et du jour au lendemain. Il est, au contraire, nous l'avons vu, le fruit d'un lent développement, qui a fait passer l'Eglise de Liège par toutes les phases que la grande propriété territoriale a traversées depuis l'empire romain jusqu'au XIe siècle. Notger a mis le sceau à ce développement en joignant le premier, à la qualité de grand seigneur immuniste possédée par ses prédécesseurs, celle de comte et de prince d'empire qui lui fut conférée par ses souverains.
Jusque là, l'évêque était loin d'équivaloir au comte comme autorité publique. Sans doute, il était, dans le domaine de son immunité, entièrement indépendant de celui-ci, et il exerçait un pouvoir analogue à celui du comte dans son comté. L'évêque de Liège, avant Notger, jouissait de haute et basse justice dans les terres de son église et sur la population qui en dépendait. Mais ces terres étaient disséminées, tandis que l'autorité du comte s'exerçait sur une province entière, sur de vastes territoires contigus et sur tous les habitants de ceux-ci.
Ce fut la politique des rois de la maison de Saxe qui fit franchir au pouvoir des évêques les deux derniers degrés qui le séparaient de celui du comte. D'abord, ils leur donnèrent les droits comtaux sur certains territoires; plus tard, leur accordèrent des comtés entiers, avec tous les droits qu'ils impliquaient.
Du coup, les prélats se trouvèrent à la tête de principautés véritables. D'une part, au lieu de terres dispersées et sans autre lien entre elles que la personne des possesseurs, ils eurent sous leurs ordres des domaines territoriaux compacts et d'un seul tenant, qui formaient le noyau de leur temporel. De l'autre, au lieu de n'avoir dans leurs domaines que juridiction sur leurs hommes, ils furent désormais les juges de toute la population, tant libre que servile, et ils remplacèrent les comtes. Enfin, le comté étant donné à leur église et non seulement à leur personne, les états nouvellement constitués eurent la perpétuité et l'indivisibilité qui étaient les caractères spéciaux du patrimoine ecclésiastique. On peut dire que c'est la concession de comtés entiers, faite pour la première fois, d'une manière systématique, aux évêques par les princes de la maison de Saxe, qui doit être considérée comme l'acte constitutif des principautés ecclésiastiques (343).
Il en fut ainsi à Liège. Parmi les nombreuses libéralités que les empereurs firent à Notger, nous relevons la donation le deux comtés: celui de Huy en 983 et celui de Brugeron vers la même date. Rendons-nous bien compte de la portée le cette double libéralité. Nous savons déjà que l'église de Liège, possédait, dans le comté de Huy et dans la ville même, les biens jouissant de l'immunité, et qu'elle y exerçait aussi, en vertu d'une concession impériale, le droit de tonlieu et de monnaie. L'évêque partageait donc en quelque sorte la qualité de comte de Huy avec le titulaire (344). Il la posséda seul à partir du jour où le comte Ansfrid lui céda ce qui lui restait du comté, tant dans le bourg de Huy qu'en dehors (infra eundem vicum vel extra). Cette concession fut ratifiée par l'empereur, qui, de son côté, abandonna à Notger ses droits de tonlieu et de marché dans la part d'Ansfrid, de même que les autres revenus de la couronne (345). C'est ainsi qu'ajoutant aux biens de son immunité et à la part héréditaire d'Ansfrid les droits régaliens qu'il exerçait déjà, et ceux que l'empereur venait de lui concéder, Notger se trouva devenu comte de Huy par accumulation.
Le comté de Huy s'étendait sur les deux rives de la Meuse, dans le Condroz et la Famenne d'une part, dans la Hesbaye et le Brabant actuel de l'autre. Parmi les localités qui en faisaient partie, nous voyons citer: Jeneffe-en-Hesbaye, Seraing-le-Château, Braives, Tourrinnes-la-Chaussée, Grand-Rosière, au nord de la Meuse; et au sud de ce fleuve Honay, Wiesme, Leignon, Barvaux-en-Condroz, Buzin (Verlée), Fraiture-en-Condroz et Somal (Maffe) (346).
C'était la première fois qu'un comté tout entier, avec tout son territoire et avec toutes les attributions comtales, tombait aux mains de l'évêque de Liège. Cette superbe acquisition le faisait, d'emblée, passer du rang d'immuniste à celui de prince. Elle devenait le noyau qui allait assurer l'unité territoriale de la principauté, en rattachant entre elles une bonne partie de ses possessions.
L'acquisition du comté de Brugeron suivit de près celle du comté de Huy, si elle ne la précéda. C'est vers 988 que, dans un diplôme où il est question de plusieurs autres donations, Otton III confirma à l'église de Liège la possession de ce nouveau domaine (347), et tout porte à croire que Notger en sera devenu le maitre en vertu de négociations semblables à celles qui firent passer dans ses mains le comté de Huy.
Le comté de Brugeron (Brunengeruz) s'étendait de Tirlemont à Louvain; il était borné à l'ouest par la Dyle, au nord par une ligne courant de Corbeek-Dyle par Lovenjoul à Binckom, à Meensel-Kieseghem et à Pippinsvoort; à l'est, la frontière allait de Glabbeek à Pippinsvoort, à Grimde et à Ardevoor; au sud, elle passait entre les deux Heylissem, entre Zétrud et Genville, et de là par Mélin, Roux-Miroir, Longueville et Chaumont, elle revenait aboutir à la Dyle, le long de laquelle elle se dirigeait vers Corbeek-Dyle, déjà nommé (348).
Cette acquisition, qui étendait singulièrement le domaine de nos évêques, n'allait pas sans inconvénients. Les puissants comtes de Louvain voyaient arriver jusqu'aux portes de leur capitale un voisin dont ils jalousaient la richesse et la puissance: quoi d'étonnant si les évêques de Liège eurent plus d'une fois maille à partir avec eux, et si le premier successeur de Notger, Baldéric II, se vit entraîné dans une guerre calamiteuse contre le comte Lambert? Vaincu, il s'estima heureux d'acheter la paix au prix de l'engagère du comté à son redoutable adversaire. Plus tard, en 1096, l'évêque Otbert parvint à dégager le Brugeron et le donna en fief au comte Albert de Namur, mais, après la mort de ce dernier, qui disparaît de l'histoire vers 1105, le domaine disputé retourna au duc Godefroi, gendre du comte de Namur (349). L'église de Liège en garda quelques parcelles: ce sont Hougaerde, Bauvechain, Tourinne et Chaumont, auxquels on peut ajouter le château de Tirlemont (350). Tout le reste fut perdu définitivement pour la principauté. Entre deux centres d'attraction de force à peu près égale, le Brugeron était allé se perdre dans la masse dont l'influence s'exerçait de plus près.
Là ne se bornèrent pas les acquisitions que l'église de Liège fit sous l'épiscopat de Notger. Dès 974, Otton Ill lui avait donné le marché de Fosse, comprenant le droit de tonlieu et de monnaie avec celui de fabriquer la drêche des brasseurs. Maitre déjà de l'abbaye, qu'il tenait de la princesse Gisèle, l'évêque de Liège pouvait dès lors se considérer comme le vrai prince de la localité (351). En 983, le même souverain ajoutait à cette libéralité le marché de Visé (352). En 988, l'évêque devint encore le maitre de l'importante abbaye de Gembloux dans des conditions que nous avons fait connaître (353). En 997, il reçut d'Otton III la terre de Heerwaarden avec ses dépendances pour son église Saint-Jean, nouvellement fondée (354). Ajoutons encore que Notger parvint à sauver les biens que son prédécesseur Eracle avait légués à la collégiale Saint-Martin. A la mort de cet évêque, le fisc royal les avait revendiqués, comme étant de simple précaires dont Eracle n'avait eu la jouissance que sa vie durant. Notger sut amener l'empereur à se désister, et Saint-Martin resta en possession de son domaine (355).
Pour compléter ce tableau des acquisitions territoriales de Notger, nous empruntons à une source étrangère l'histoire de celle qu'il fit, en Hesbaye, de certains domaines appartenant à l'abbaye de Saint-Riquier, en Picardie. C'étaient cinq manses situés à Heers, cinq autres à Fumal, un à Bois-et-Borsu et un à Gelinden. L'abbaye, se trouvant gênée de ces possessions lointaines, les offrît à Notger, qui les prit en gage pour vingt ans, au prix de trente-trois livres de deniers versées dans les mains de l'abbé Ingelard. C'était en 1002 (356). Nous possédons l'acte, daté du 28 octobre, par lequel notre évêque fait connaître cette condition; il est revêtu de sa signature, de celles du prévôt Godescalc et de plusieurs chanoines et chevaliers de l'église Saint-Lambert, ainsi que de l'abbé Ingelard, de deux moines et de trois chevaliers de l'abbaye de Saint-Riquier (357). A peine le pacte conclu et signé, l'abbé, de retour chez lui, craignit que les droits de sa maison ne fussent pas suffisamment garantis, attendu qu'il n'avait pas fait insérer dans le contrat une clause portant qu'on rendrait les terres dans le même état qu'on les avait reçues. Il écrivit donc à Notger une lettre que la chronique de Saint-Riquier nous a conservée, le priant d'entretenir lesdits domaines, comme on dirait aujourd'hui, en bon père de famille, c'est-à-dire de mettre en friche les terres incultes, de rebâtir les constructions qui tomberaient en ruines, enfin, de prendre des dispositions prohibitives à l'endroit de ceux de ses succeseurs qui s'aviseraient d'abuser du gage. Un petit morceau en vers adoniques, contenant des souhaits à l'adresse de l'évêque de Liège, terminait cette épître. Notger répondit à l'inquiet religieux qu'il était entendu qu'aucun de ses successeurs ne pourrait entamer le gage, mais que celui-ci serait restitué à l'abbaye n'importe à quel moment elle rendrait la somme de trente-trois livres; il concluait par une menace d'anathème à l'adresse de quiconque porterait atteinte à cette convention (358).
Lorsque les vingt années furent écoulées, l'abbé Angelram, successeur d'Ingelard, proposa à l'évêque Durand, troisième successeur de Notger, de renouveler le contrat, ce que Durand lui accorda par une charte du 18 septembre 1022, reproduite par le chroniqueur (359).
Ces épisodes se rattachent d'une manière trop intime à l'histoire de la formation territoriale de la principauté de Liège pour qu'on puisse omettre de les raconter ici. Maintenant nous revenons à l'histoire du temporel de Liège, pour lequel Notger se fit accorder quatre confirmations générales par les empereurs. Ces confirmations générales mettent sous la protection du droit public de l'empire toutes les acquisitions de l'église de Liège, tant celles de notre évêque lui-même que celles de ses prédécesseurs. La première est d'Otton II et porte la date du 6 janvier 980; les deux suivantes, datées du 7 juillet 981 et de 987 ou 988, émanent d'Otton III; la dernière enfin fut accordée par Henri II, le 10 juin 1006 (360). Que ces quatre diplômes ont bien le caractère de confirmations générales que nous leur attribuons, c'est ce qui résulte des termes formels dans lesquels ils sont conçus (361). Qu'ils ne contiennent pas l'énumération complète des biens de l'église de Liège, mais seulement la mention des principaux, c'est encore ce qu'ils disent eux-mêmes, et il suffit d'y renvoyer une fois pour toutes (362).
Sous le bénéfice de cette double observation, nous allons exposer ci-dessous, en un tableau, l'ensemble des domaines dont se composait à la fin du pontificat de Notger le patrimoine de l'église de Liège. Les dates placées à côté des noms des localités sont celles de leurs plus anciennes mentions.
LISTE ALPHABÉTIQUE DES LOCALITÉS CITÉES NOMMÉMENT
DANS LES DIPLÔMES COMME AYANT APPARTENU A L'ÉGLISE DE LIEGE
AVANT OU PENDANT LE PONTIFICAT DE NOTGER
| Aldeneyck, monastère |
952 |
| Arches |
894 |
| Brogne, monastère |
1006 |
| Brugeron (Brunengeruz), comté |
987 |
| Celle, monastère |
1006 |
| Clney |
1006 |
| Dlnant |
985 |
| Fosse, monastère |
vers 900, 974, 980 |
| Gembloux, monastère |
987 |
| Hastière, monastère |
908-915 |
| Huy, ville |
980 |
| Huy, comté |
985 |
| Lobbes, monastère |
888, 973, 980 |
| Lustin |
888 |
| Maestrlcht |
908, 985 |
| Malines |
915, 980 |
| Malonne, monastère |
1006 |
| Namur |
985 |
| Saint-Hubert, monastère |
1006 |
| Theux |
988 |
| Theux, foret |
915 |
| Tongres |
980 |
| Ville-en-Hesbaye |
831 |
| Visé |
983 |
Cette liste appelle un commentaire sans lequel elle risquerait fort de rester inintelligible pour plus d'un lecteur. Telle qu'elle se présente à nous, elle se compose de deux groupes très distincts: l'un, formé par les importants domaines énumérés dans les actes de confirmation générale, l'autre, portant le nom de quelques acquisitions d'importance secondaire faites au cours des temps par l'église de Liège, et dont nous devons au seul hasard d'avoir conservé le souvenir. Or, chacun des noms de la première catégorie, sans parler des comtés, n'est que l'expression géographique désignant la réunion, dans les mêmes mains, d'un grand nombre de localités éparpillées ou groupées, et formant elle-même un domaine considérable. Voici quelques exemples. La seule abbaye de Lobbes, aux termes d'un pouillé qui en fut fait en 888, ne possédait pas moins de 153 villages, y compris le fort de Thuin, qui lui servait de citadelle (363). L'abbaye de Saint-Hubert possédait dès l'époque de Walcaud (817), rien que dans le diocèse de Liège, vingt-deux villages, et ce nombre avait été peut-être doublé par des libéralités nouvelles au IXe et au Xe siècle. La forêt (forestum) de Theux comprenait, avec le districtus du même nom, à peu près tout l'ancien marquisat de Franchimont (364).
Toutes les autres maisons religieuses, dont malheureusement nous ne sommes pas en état de dresser le terrier, avaient une situation analogue; l'entrée de l'une d'elles dans le domaine de l'église de Liège constituait pour celle-ci un accroissement considérable, et c'est ainsi que se multipliaient, sur la vaste étendue du diocèse, les flots régis par la crosse. Au fur et à mesure que croissait leur nombre, ils se rapprochaient, ils devenaient contigus; l'îlot se transformait en île et la principauté grandissante semblait aspirer à s'identifler avec le diocèse. Ce ne fut jamais le cas, même au temps de la plus grande splendeur des princes-évêques, mais on peut dire que la principauté se développa dans le cadre du diocèse et que son idéal semble être de le couvrir. D'ailleurs, elle n'est pas tellement enfermée dans ses frontières ecclésiastiques que dès lors elle ne les franchisse. Lobbes, en effet, appartenait au diocèse de Cambrai. Et, par contre, certains domaines situés dans le diocèse de Liège appartenaient à des principautés ecclésiastiques voisines. Ainsi, le seul évêque de Metz possédait les abbayes de Saint-Trond, de Waulsort et d'Hastière.
Après ce qui vient d'être dit, le lecteur ne sera pas surpris de ne pas rencontrer le nom de Liège sur la liste des acquisitions primitives de l'église de Tongres. L'omission s'explique d'une manière bien simple. Si l'on consulte le tableau ci-dessus, on remarquera que les confirmations impériales ne mentionnent, à deux ou trois exceptions près, que des comtés, des abbayes et des villes, c'est-à-dire des domaines considérables, les uns par leur étendue territoriale, les autres par l'importance de leur population. Or, Liège, avant les Carolingiens, ne pouvait rivaliser, ni avec les riches abbayes, ni avec des localités comme Dinant, Huy, Maestricht, Namur et Tongres. On conçoit donc que les diplômes d'immunité de l'époque mérovingienne ne l'aient pas mentionnée, et qu'elle n'ait pas figuré davantage dans les diplômes carolingiens, qui ne sont que la répétition des précédents (365). Il est vrai que, dans l'intervalle, Liège était devenue une ville importante, et rien ne s'opposait à ce qu'on intercalât désormais son nom dans l'énumération officielle des biens de l'église. Mais, à partir du jour où saint Hubert eut transféré la résidence épiscopale de Maestricht à Liège, nul n'éprouva plus le besoin d'affirmer, dans un acte public, les droits de l'église sur cette ville: ils allaient de soi, ils étaient sous-entendus en toute rencontre (366).
Au surplus, tout nous autorise à croire que Liège faisait partie des domaines de l'église de Tongres dès l'époque mérovingienne. La prédilection de saint Lambert pour ce village, où il avait une habitation et où il crut devoir transporter les reliques de son prédécesseur saint Théodard, nous en est un indice significatif, et la translation de la résidence épiscopale dans cette localité par saint Hubert en est un autre plus éloquent encore (367). A Liège, les évêques étaient chez eux; à Maestricht, ils étaient chez le comte.
A ces deux indices, nous ajouterons une preuve. Nous savons, par un témoignage très digne de foi, que saint Lambert avait à Liège son agent (judex), qui, comme c'était l'usage dans les domaines privés et spécialement dans les immunités, rendait la justice au nom du seigneur. Ce personnage, à qui notre source donne le nom d'Amalgisile, ouvre la série des officiers du prince (avoués, puis grands maïeurs), qui, à partir du VIIe siècle jusqu'à la fin de la patrie liégeoise, ont présidé le tribunal des échevins de Liège. Et nous n'avons pas besoin d'un autre témoignage que la seule mention de son office pour en pouvoir conclure que saint Lambert était bien le maitre du territoire sur lequel il avait un juge (368).
Il y a lieu aussi de mentionner un acte de 884, par lequel l'empereur Charles-le-Gros cède à l'église de Liège tous les serfs fiscaux demeurant dans cette ville et dans celle de Tongres, quel que fût au surplus leur lieu d'origine. II s'agit ici de serfs provenant de divers domaines royaux où ils étaient attachés, les uns à l'exploitation directe du prince, les autres aux terres données par lui en bénéfice (369). Leur établissement à Tongres et à Liège, c'est-à-dire dans les deux principales villes du diocèse, est un curieux indice de l'affluence des populations agricoles dans les cités épiscopales, où la vie était plus douce sous la crosse. Et si ces fiscalins - c'est le nom qui les désigne souvent - sont donnés à l'église de Liège, n'est-ce pas parce que celle-ci possède déjà les terres sur lesquelles ils vivent? Nous le savons de science certaine en ce qui concerne Tongres, que les diplômes nous montrent dans le patrimoine de Saint-Lambert depuis au moins 980: le moyen de se dérober à la conclusion qu'il en était de même, à plus forte raison, pour la ville de Liège?
L'autorité accordée à Notger dans les deux comtés de Huy et de Brugeron n'était pas la même que celle dont il jouissait en qualité d'immuniste, dans les terres de son domaine. Dans les comtés, il était investi du pouvoir public; dans le domaine, il n'avait que la situation de grand propriétaire. Dans les comtés, son pouvoir s'étendait sur toute la population indistinctement, tant libre que servile. Dans le domaine, il ne commandait qu'aux gens de condition dépendante qui l'habitaient et le cultivaient. Toutefois, cette dualité de pouvoir ne se prolongea pas. Tout porte à croire qu'en même temps qu'il fut investi des droits comtaux dans
les comtés de Huy et de Brugeron, Notger les reçut égalment dans le reste de son domaine, s'il ne les possédait pas déjà auparavant. Ses diplômes, il est vrai, ne nous le dise pas, mais il ne faut pas nous en étonner: les diplômes sont peu explicites et ne parlent pas de tout; nous avons déjà fait remarquer que, sous les vieilles formules d'immunité renouvelées au Xe siècle, se cache d'ordinaire l'éclosion d'une situation juridique toute nouvelle. Si donc aucun dipliôme liégeois ne nous dit que les empereurs confèrent à nos évêques le ban, c'est-à-dire le pouvoir de commander en donnant à leurs ordres une sanction pénale, il ne faut nullement s'en prévaloir pour en conclure que les évêques ne l'ont pas possédé du temps de Notger (370). Certains faits indiquent nettement le contraire. Ainsi, quand le panégyriste à peu près contemporain nous parle de la sévérité avec laqulle notre évêque châtiait les perturbateurs de l'ordre public, faisant pendre les uns et mutiler les autres, tandis qu'il en envoyait d'autres en exil, c'est bien l'exercice de la haute justice que nous voyons ici dans ses mains. Or, il n'est pas douteux que ce ban judiciaire, il ait eu l'occasion de l'apliquer principalement dans les premières années qui suivirent la mort de son prédécesseur Eracle (371). Pareillement, quand le document de 980, qui énumère les contingents à fournir par les divers diocèses, taxe celui de Liège à 60 guerriers pesamment armés, c'est, encore une fois, le ban militaire que nous voyons exercer par notre évêque (372). Il est donc établi qu'il a les attributions du comte, non seulement dans ses deux comtés, mais encore dans toutes les terres de son domaine. Au surplus, ne les eût-il pas possédées dès lors, les confirmations générales d'immunité qu'il obtint à partir de 980 (373) les lui auraient données par voie d'extension.
Ainsi se forma la principauté ecclésiastique de Liège. L'acquisition de deux comtés d'une part, et, de l'autre, celle du ban ou autorité comtale dans ses propres domaines, tels furent les deux actes qui firent passer l'évêque de Liège de la catégorie des grands propriétaires immunistes dans celle des princes. Et c'est parce que cette double acquisition a été faite par Notger qu'on peut considérer ce prélat comme le premier prince-évêque de Liège.
|
CHAPITRE X
NOTGER SECOND FONDATEUR DE LIÈGE
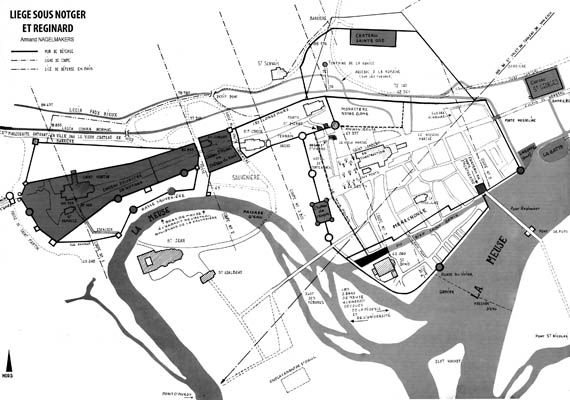
Notger n'est pas seulement le fondateur de sa principauté. II mérite encore d'être appelé le second fondateur de sa ville épiscopale, saint Hubert en ayant été le premier. Ses titres à la reconnaissance des Liégeois ont été formulés, dès son siècle, en ce vers devenu classique, par lequel le poète, s'adressant à la ville de Liège, lui dit Tu dois Notger au Christ, et le reste à Notger (374 Notgerum Christo, Notgero cetera debes. Vita Notgeri, c. 5).
Les travaux exécutés à Liège par ce grand homme sont assez importants pour justifier cet éloge à première vue hyperbolique. Monuments religieux, monuments civils, travaux de défense et travaux d'utilité publique; églises, monastères, hospices, fortifications, canaux, Notger a créé tout cela. Il a fait plus. A sa voix, les arts sont accourus au secours des métiers pour embellir la jeune cité, et il a laissé à ses successeurs une résidence épiscopale digne de ses hautes destinées.
Sous ce rapport, il est bien de la race des grands évêques du Xe siècle qui entourèrent les princes de la maison d'Otton. Parmi eux, il en est un dont le nom revient souvent à l'esprit quand on pense à Notger: celui de l'illustre évêque de Hildesheim, saint Bernward. Celui-ci est également le fondateur de sa ville épiscopale, qu'il a, comme Notger, tirée en quelque sorte du néant. L'oeuvre de l'évêque saxon est encore debout en grande partie, telle qu'elle est sortie de ses mains, et le voyageur peut admirer, avec la massive enceinte tracée par lui autour des cloîtres de sa cathédrale, ces édifices religieux d'un style si simple et si pur, ces constructions où les pierres blanches et rouges alternent d'une manière si agréable au regard, ces portes de bronze qui font vivre le cycle des récits bibliques, cette colonne, imitée de la colonne Trajane mais ornée de symboles chrétiens, et que l'évêque, revenu de Rome, avait dressée dans le choeur de son église Saint-Michel. Tout cet ensemble artistique, c'est l'efflorescence d'une vie religieuse pleine de fraîcheur et d'avenir, et il semble que la jeune civilisation saxonne, toute parfumée de christianisme, ait trouvé son symbole le plus gracieux dans ce rosier de mille ans qui, du fond de la crypte de la cathédrale, étend ses rameaux fleuris autour de l'abside extérieure, qu'il étreint d'une couronne de fleurs.
L'oeuvre de Notger n'a pas eu le même bonheur que celle de son illustre ami. A Liège, sauf quelques parties d'un édifice, toutes les constructions du Xe siècle ont disparu ou, du moins, en se renouvelant, ont perdu leur aspect premier. Toutefois, c'est sur la base des constructions notgériennes qu'elles reposent toujours, et, sous ce rapport, si l'on excepte la cathédrale abattue à la fin du XVIIIe siècle, on peut dire que les monuments bâtis par Notger sont restés debout.
En essayant de présenter ici le tableau d'une activité qui a été gigantesque, il importe de rappeler qu'elle fut la réalisation d'un programme qui peut se résumer en ces trois mots: agrandir, embellir et fortifier la ville épiscopale. Mais l'embarras est grand pour l'historien, lorsqu'il s'agit de retracer les diverses phases par lesquelles a passé l'exécution de ce programme. Nous ne connaissons pas l'ordre chronologique dans lequel se sont succédé les constructions notgériennes, et nous ne disposons pas même de moyens d'information suffisants pour le rétablir par voie de conjecture. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'en 990, c'est-à-dire au milieu de la durée de son pontificat, Notger avait déjà réalisé une bonne partie de son programme de bâtisseur, puisque l'abbé Folcuin de Lobbes, mort en cette année, déclare qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait enrichi l'église de Liège d'un si grand nombre d'édifices (375). Au surplus, chaque fois qu'on essaie de préciser la date de l'une ou de l'autre des constructions notgériennes de Liège, on s'aperçoit qu'elle est intimement liée à celle de toutes les autres. Et la conclusion qui s'impose à l'esprit d'une manière irrésistible, c'est que tous ces monuments ont été conçus à la fois dans la tête créatrice du grand civilisateur, c'est qu'ils font partie d'un même plan. Les considérations que voici viennent à l'appui de cette hypothèse.
L'oeuvre architectonique de Notger comprend trois vastes entreprises: ce sont la construction de l'enceinte, le creusement du canal de la Meuse et l'édification d'une série de monuments. Or, nous constatons que le bras de la Meuse était compris dans le système défensif de la ville, et qu'il servait essentiellement à en compléter les ouvrages d'art militaire. D'autre part, comme on le verra, plusieurs des édifices notgériens: Saint-Denis. Sainte-Croix et Saint-Martin ont fait partie de l'enceinte fortifiée, et ont dû, par conséquent, surgir en même temps qu'elle. La savante combinaison en vertu de laquelle les murs, les édifices et le canal se complètent mutuellement ne s'explique d'une manière satisfaisante que dans l'hypothèse d'un plan d'ensemble, laborieusement mûri avant que l'on mît la main à l'oeuvre. Il fallait de toute nécessité que l'enceinte fût d'abord tracée, au moins dans les croquis de l'architecte, pour qu'on pût assigner leur place aux églises appelées à en faire partie, et pour que le cours du canal passant par la ville pût être déterminé d'une manière certaine. C'est donc le système défensif élaboré par Notger qui devra être exposé d'abord.
Le Xe siècle est par excellence le siècle de l'architecture militaire. Sous les rois mérovingiens et sous les premiers carolingiens, les peuples avaient, somme toute, connu les bienfaits d'un régime relativement pacifique. Les rois vivaient à la campagne, dans des palais qui étaient des fermes, gardés par la fidélité de leurs hommes et par la vigilance de quelques chiens. Quant aux villes, dont les descendants de Clovis réparaient encore de temps à autre les enceintes (376), elles avaient cessé, à partir de la fin du VIIIe siècle, de craindre les barbares; elles laissaient tomber en ruines leurs vieilles murailles qui dataient de l'époque romaine, et l'on vit même des princes et des évêques les abattre pour en faire servir les matériaux à la construction d'édifices religieux (377). Mais cette belle sécurité ne dura guère: dès le milieu du IXe siècle, les invasions normandes firent flamber toutes les villes l'une après l'autre, et il fallut bien songer à les fortifier contre les ennemis du dehors. D'autre part, le morcellement féodal, qui transforma chaque seigneur en une espèce de chef d'Etat entouré d'autant d'ennemis que de voisins, suggéra la même précaution. Les enceintes destinées à protéger les habitants des villes eurent donc la même origine que les bastilles où se tremperaient les féodaux (378). Dans les villes d'origine romaine, on releva les murailles qui dataient de l'époque impériale; dans les autres, on bâtit de toutes pièces des enceintes neuves. Le Xe siècle reprenait l'oeuvre du IIIe et se remettait à embastiller les cités que les siècles de Trajan et de Charlemagne avaient laissées ouvertes (379). Mayence dès 882 (380) et Cologne l'année
suivante (381) donnèrent le mouvement sur le Rhin; Foulques de Reims (883-900) rebâtit les murailles de sa ville épiscopale récemment abattues par son prédécesseur Ebbon (382); Dodiion de Cambrai fortifia sa ville entre 887 et 901, (383); Geilon de Langres fit de même en 887 (384). A Ratisbonne, c'est le duc Arnoul qui, comme Foulques à Reims, rebâtit l'enceinte démolie par Louis le Germanique (385). A Augsbourg (386) et à Saint-Gall (387), c'est l'imminence du danger hongrois qui produisit le même résultat vers 954. Dans la seconde moitié du Xe siècle, nous voyons surgir les murs de Constance (386), de Verdun (387), de Brême (388) et de Hildesheim (389), tandis que Worms (390) fut fermé au commencement du XIe siècle. En un mot, la génération de Notger est celle qui a travaillé le plus activement à fortifier les villes épiscopales.
Liège, devenue chef-lieu d'un diocèse et d'une principauté, ne pouvait donc pas rester la bourgade ouverte à tout venant qu'elle avait été jusqu'alors (391). L'heure était venue pour elle de revêtir l'armure de fer et de pierre qui devait rester, jusqu'à l'aube du XIXe siècle, le vêtement de toutes les villes européennes. C'était une transformation qui allait décider de toute sa destinée ultérieure: il convient d'en examiner la portée.
Le village de Liège sort des ténèbres de l'histoire avec saint Lambert, qui, vers 670, y transporta les restes mortels de son prédécesseur saint Théodard (392). Il était éparpillé sur les deux rives du ruisseau de la Légia, à l'endroit où ce ruisseau, débouchant de son vallon assez encaissé, entrait dans la vallée de la Meuse pour s'unir, un kilomètre plus loin, à ce fleuve, dont les bras multiples se promenaient nonchalamment dans la large plaine marécageuse. C'était une agglomération agricole conquise sur les épais fourrés de la forêt « leudique », qui couvrait primitivement de ses ombrages le domaine entier de Liège. Un certain nombre de bateliers, établis dans le bas de l'agglomération, poussaient leurs barques de commerce et de pêche à travers les méandres de la rivière. Sur la pointe de la colline où vient expirer la ligne de faite séparant la Légia de la Meuse, le cimetière de Liège alignait ses sépultures orientées, que venaient frapper les rayons du soleil levant (393).
Ce village, comme son nom l'indique (394), était un domaine royal, et nous avons vu qu'il doit être passé de bonne heure dans le patrimoine de l'église de Tongres (394). La translation des reliques de saint Théodard dans l'église du lieu par saint Lambert fut pour Liège le point de départ de nouvelles destinées. Lambert y séjournait volontiers auprès du tombeau de son prédécesseur, en compagnie de son clergé, et il habitait, à proximité de la chapelle, une maison de campagne dans laquelle il succomba sous les coups des assassins (395). Si l'on considère que le domaine de Liège était contigu à ceux de Jupille et d'Herstal, qui appartenaient aux rois, on sera fondé à croire que c'est un de ceux-ci qui l'aura détaché pour l'abandonner aux évêques de Tongres.
Ce fut la mort sanglante de saint Lambert, massacré par le domesticus Dodon dans sa maison de Liège, qui tira ce village de l'obscurité pour en faire le centre d'une affluence extraordinaire. Le tombeau du saint fut, à la lettre, le berceau de la ville. J'ai déjà rappelé plus haut l'extraordinaire résolution de saint Hubert, premier successeur du martyr, qui, abandonnant Tongres et Maestricht, transporta d'une manière définitive la résidence des évêques à Liège, où il apporta les cendres de son prédécesseur (396). Ce fut comme la consécration du plébiscite spontané par lequel les fidèles enlevaient le siège épiscopal aux deux premières résidences des évêques, pour le fixer auprès du tombeau de l'homme qui l'avait le plus illustré. La chapelle primitive de Liège se transforma en une superbe basilique, dédiée à la Vierge et à saint Lambert (397), et, comme pour indiquer le rapide accroissement de la bourgade, une seconde basilique, dédiée à saint Pierre, surgit à l'extrémité du promontoire qui dominait le confluent de la Meuse et de la Légia (398). Les habitations se multiplièrent de tous les côtés, et; sous les rois carolingiens, le bourg de Liège (vicus Leudicus) fut à plus d'une reprise le séjour de ces monarques: Charlemagne y fut en 770 (399), et les fils de Louis le Débonnaire s'y réunirent en 854 (400). Un somptueux palais épiscopal, qui a trouvé un poète pour le chanter, servait d'habitation à ces princes (401).
Les invasions des Normands portèrent un coup terrible à cette prospérité naissante: la ville, qui était ouverte, fut pillée et presque détruite, et ses monuments réduits en cendres. Les évêques de la première moitié du Xe siècle eurent fort à faire pour relever les ruines: ce fut surtout Richaire qui s'y employa. Il restaura Saint-Lambert et Saint-Pierre (402), et il bâtit dans le vallon de la Légia un troisième sanctuaire qu'il dédia à saint-Servais (403). Otton-le-Grand parait s'être intéressé à ces travaux de réédification, et c'est à lui qu'une chronique, d'époque postérieure il est vrai, en fait honneur (404). A partir de son règne, la ville de liège recommença de se développer rapidement: deux nouvelles églises, celles de Saint-Martin et de Saint-Paul, bâties par Eracle aux deux extrémités opposées de sa ville épiscopale, en sont la preuve, et il est certain que Notger n'aurait pas étendu si considérablement, comme nous le verrons, le pourpris de Liège, si les quartiers qu'il y engloba avaient été totalement inoccupés. Liège s'étendait alors dans le vallon de la Légia depuis l'église Saint-Servais, où était sa limite occidentale, jusqu'au confluent de la Meuse, qui la bornait du' côté de l'est. Vers le nord, elle se terminait à peu près à l'entrée des rues parallèles Hors-Château et Féronstrée. Au sud enfin, elle englobait encore le terrain connu sous le nom de Sauvenière: celui-ci avait lui-même pour limite méridionale un bras de la Meuse, qui décrivait une île assez vaste au milieu de laquelle surgissaient alors les constructions de l'église Saint-Paul. Tel était le Liège de 972, la cité de Liège, comme on disait depuis que l'endroit était devenu le séjour des évêques diocésains (405).
Partout les forêts délimitaient et ombrageaient la banlieue de Liège. Sur les hauteurs, au-delà de l'église Saint-Martin, elles cernaient l'emplacement sur lequel l'évêque Evacle venait de jeter les fondements de l'abbaye de Saint-Laurent; cette maison religieuse elle-même remplaçait l'ancien gibet (406). Plus loin s'étendait la belle forêt de Glain, qui ne fut défrichée qu'au commencement du XIIIe siècle (407). Dans la vallée, au sud de la ville, à l'endroit où s'éleva depuis le monastère de Saint-Jacques et où l'on voit encore aujourd'hui l'église du même vocable, ce n'étaient qu'épais fourrés et repaires de bêtes fauves (408).
La capitale naissante de l'État liégeois gardait encore, dans sa prospérité de fraiche date, quelque chose de ses origines rustiques. Elle leur devait, dans tous les cas, une bonne fortune des plus enviables: celle de n'avoir ni comtes ni châtelains. Dans les villes qui avaient été, sous les Mérovingiens, la résidence d'un comte, celui-ci, malgré l'immunité, malgré les privilèges qui, des évêques, faisaient des princes, ne laissait pas de revendiquer pour lui l'autorité autrefois inhérente à sa charge, et c'était l'occasion d'interminables querelles avec les prélats. Ceux-ci n'étaient guère plus heureux lorsque, débarrassés du comte, ils installaient à sa place un châtelain qui tenait d'eux son office en fief, et qui, au lieu de protéger l'église, la tyrannisait de toute manière. L'évêque qui avait l'un ou l'autre de ces personnages dans l'enceinte de sa ville épiscopale n'était plus le maitre chez lui; il devait soutenir contre eux des luttes acharnées, heureux quand, à ce prix, il parvenait à sauvegarder son indépendance vis-à-vis du comte, son autorité vis-à-vis du châtelain.
A Cambrai, dont l'histoire offre au Xe siècle comme le pendant de celle de Liège, on avait fait successivement l'expérience du comte et du châtelain, et l'on avait pu constater que le second ne valait pas mieux que le premier. Il ne servit de rien, en effet, à l'évêque, de voir en 948 un diplôme impérial lui donner l'autorité comtale sur la ville entière, qu'il soustrayait de la sorte au comte. Un quart de siècle plus tard, nous le retrouvons aux prises avec son châtelain, qui se bâtit une maison forte dans l'enceinte de la ville. Membre d'une des grandes familles du Cambrésis, le châtelain, nommé Jean, s'était probablement imposé au choix de l'évêque; celui-ci ne s'en débarrassa que pour en accepter un autre qui ne le tourmenta pas moins, dépouilla l'évêché, rendit sa charge héréditaire et troubla (409) le pontificat de trois évêques. Ses successeurs en firent autant, et, jusqu'à la fin du XIIe siècle, le châtelain de Cambrai resta le grand perturbateur de la principauté ecclésiastique.
Déjà, te péril était devenu imminent à Liège. Cette ville ouverte, dont l'importance et la richesse allaient tous les jours croissant, était faite pour tenter tous les ambitieux: s'y bâtir, au sommet de la colline qui la dominait, un château-fort du haut duquel on la tiendrait sous la main, quel rêve pour un féodal doué de quelque hardiesse! Notger dut trembler le jour où « un puissant » - le chroniqueur ne le désigne pas d'une manière plus précise - lui demanda la permission de construire une maison fortifiée à l'emplacement aujourd'hui occupé par l'église Sainte-Croix, prétextant que de là-haut il défendrait la ville et la principauté. L'endroit qu'il entendait se faire abandonner par l'évêque était précisément le poste stratégique par excellence, celui d'où l'on dominait à la fois tes deux vallées de la ville, celle de la Meuse et celle de la Légia (410).
Que devait faire Notger? Céder, c'était installer au bon endroit le tyran qui mettrait fin à l'autorité paternelle de l'évêque: cela n'était pas douteux, et il est intéressant de constater jusqu'à quel point le narrateur du XIe siècle a conscience de ce danger. Résister, c'était courir au devant d'un conflit avec un homme redoutable, derrière lequel se rangeaient peut-être des forces imposantes. Notger recourut à la ruse: il demanda un délai, et en profita pour faire jeter en toute hâte par Robert, le prévôt de sa cathédrale (411), les fondements de l'église Sainte-Croix. Lorsque le solliciteur revint et se plaignit d'avoir été joué, Notger manda le prévôt et affecta de le gronder: « Si vous aviez élevé toute autre construction, lui dit-il en présence du puissant vassal irrité, je vous l'aurais fait abattre pour céder le sol à mon ami; mais puisque c'est à la croix du Sauveur que vous avez consacré cet édifice, je croirais lui faire injure à lui-même si je mettais la ville sous un autre protectorat que le sien. » Et l'église continua de s'élever (412). Cet incident est hautement caractéristique; il nous apprend la gravité du danger conjuré par le stratagème de Notger, il nous fait toucher du doigt la situation précaire du pouvoir épiscopal naissant. On y voit sur quel ton les vassaux de l'église de Liège pouvaient se permettre de parler à leur prince, et avec quel mélange de timidité et d'adresse cet homme énergique et puissant défendait, contre les empiètements des féodaux, la sécurité de sa ville épiscopale avec les droits les plus élémentaires de son autorité.
Comme il est facile de le comprendre, une expérience de ce genre dut faire mûrir dans l'esprit de Notger le plan de doter sa cité d'une enceinte fortifiée, si toutefois ce plan n'avait pas été conçu par lui dès les premières années de son pontificat.
Dans la construction de l'enceinte, il fallut tenir compte et de la configuration du terrain et des besoins de l'avenir. Notger voulut donc englober non seulement la cité proprement dite, telle qu'elle avait existé avant lui, mais encore tous les terrains contigus qui, sur la colline de Publémont et dans la vallée de la Meuse, formaient déjà, selon toute apparence, de populeux faubourgs. C'est ce qu'Anselme exprime avec autant de concision que de netteté quand il dit que Notger, par l'enceinte qu'il traça, augmenta l'étendue de sa ville (413).
On peut déterminer avec une précision relative le pourtour de la première enceinte de Liège. Partant du haut du Publémont, où les massives constructions de l'église Saint-Martin étaient encastrées dans son tracé, elle dévalait vers l'ouest dans le vallon de la Légia, qu'elle coupait transversalement, passait le ruisseau sur une voûte, remontait la côte opposée derrière la place Saint-Séverin, suivait la rue de Bruxelles du côté du fond Saint-Servais, encastrait l'église de ce nom, courait sur les flancs de la colline, parallèlement à la rue Hors-Château, jusque près de la caserne des Pompiers, où elle obliquait par la rue des Airs et par l'impasse Babylone vers la rue Féronstrée. Là s'ouvrait une porte à laquelle les vieux chroniqueurs donnent le nom de porte Hasseline. L'enceinte, passant entre les rues de la Clef et Sur-le-Mont, gagnait ensuite la Meuse au quai de la Goffe, la remontait jusqu'au delà de Cheravoie, puis, faisant un angle droit à la hauteur du bâtiment de la poste actuelle, elle allait encastrer l'église Saint-Denis, revenait par la rue de la Régence en longeant le bras de la Meuse, et remontait ensuite la rue Haute-Sauvenière jusqu'au Mont Saint-Martin, qui la ramenait à son point de départ près de l'église du même nom (414).
Tel est le tracé que, en combinant les témoignages de nos sources et en les interprétant par les découvertes de l'archéologie locale, on peut assigner avec quelque vraisemblance à l'enceinte notgerienne. Une partie en subsistait encore du temps de Jean d'Outremeuse, notamment celle qui passait derrière le Palais, où elle supportait les maisons de la pente abrupte qu'on appelle aujourd'hui Pierreuse, et qui portait alors le nom de Pissevache (415). Des actes du XIVe siècle nous en signalent d'autres fragments du côté de la Meuse, aux abords du Pont des Arches, dans le voisinage de la Halle, et enfin en Sauvenière (416). Quelques restes s'en retrouvent encore aujourd'hui vers le Mont Saint-Martin et au Thier de la Montagne.
Un écrivain du XIe siècle, qui a vu tous ces travaux de défense debout et tels qu'ils étaient sortis de la main des ingénieurs de Notger, nous en donne une idée sommaire. C'étaient des murs garnis de tours nombreuses; devant Saint-Martin, il y avait un triple retranchement et de hautes tours avec des saillies ou barbacanes pour les défenseurs. (417).
Mais ce n'est pas tout. Au pied de la partie méridionale de cette enceinte, c'est-à-dire en Sauvenière, coulait, nous l'avons vu, un bras de la Meuse qui s'y divisait en ramifications nombreuses et qui décrivait une île de configuration irrégulière. Cette île, d'une superficie à peu près égale à celle de la ville emmuraillée, était encore inculte et boisée à son extrémité méridionale, mais elle commençait à se peupler du côté où elle touchait à la ville, et l'évêque Eracle y avait jeté les fondements de sa collégiale Saint-Paul. Notger, qui ne pouvait penser à englober tout ce vaste terrain dans le pourpris de son enceinte, voulut tout au moins lui donner une protection quelconque en même temps que la faire contribuer à son système général de défense. Dans ce but, il approfondit le bras de la Meuse, dont le volume d'eau n'était pas considérable, et en fit un fossé profond qui mettait l'île à l'abri d'un coup de main, tout en renforçant la défense de la Cité du côté sud. C'est ainsi que l'lle fut rattachée à la Cité pour ne plus former avec elle qu'une seule ville (418 Mosam fluvium, qui extra civitatem fluebat, civitati introduxit et eum circa claustrum sancti Pauli sanctique Johannis ad radices montis, in quo ecclesia sancti Martini et sanctae Crucis et sancti Petri situ est, inter claustrum sancti Johannis sanctique Lamberti, ut fluminis impetus letificet civitatem Dei, per medium civitatis in communes usus fluere fecit. Vita Notgeri, c. S. Sur la foi de ce témoignage unique, on a répété depuis lors que le bras de la Meuse coulant sur les boulevards d'Avroy et de la Sauvenière, qui fut desséché de 1838 et 1845 (v. Notice sur l'origine de Liège et ses agrandissements, Liège 1881, pp. 19 et 20), n'était qu'un canal creusé par Notger. Il m'est difficile de le croire. Dès 997, le quartier qu'il circonscrit porte le nom d'Ile, ce qui suppose une certaine ancienneté de l'usage; les plus anciennes mentions de l'Ile sont, après 997, celles du Vita Balderici, c. 18, p. 731, vers 1050, et celle de 1079 dans le Cartulaire de Saint-Lambert, t. 1, p. 43. De plus, le biographe du XIe siècle a bien pu ignorer que le bras de la Meuse avait existé avant Notger et ne se souvenir que du travail de ce dernier. Le lit du prétendu canal semble bien être l'ancien lit de la Meuse. C'est la thèse de de Crassier, Mémoire historique sur le lit, le cours et les branches de la rivière de Meuse dans l'intérieur de la ville de Liège, Liège 1838, qu'il défend encore dans Cri d'un franc Liégeois contre le projet de dérivation de la Meuse, Liège 1850. Cette thèse, dont la partie proprement historique est d'ailleurs très faible et criblée d'erreurs, a rallié l'adhésion de Duvivier de Streel dans BIAL, t. III (1857), p. 193, de M. St. Bormans, Recherches sur les rues de l'ancienne paroisse Saint-André à Liège, Liège 1867, pp. 18, 22 et 23 et de M. Th. Gobert, Les Rues de Liège, t. II, p. 86. Duvivier de Street invoque des arguments géologiques. « En creusant pour faire une cave su nouveau presbytère de Saint_Jean, on a trouvé plusieurs lits de gravier et de limon superposés, et, dans la dernière couche, un débris de poterie romaine et une défense de sanglier ». Par contre, tout le chemin du quai d'Avroy est formé de terres rapportées, à te point que « quand on creuse une tranchée en cet endroit, nous ne voyons jamais paraître le limon ni le gravier. »
Ce qui vient à l'appui de cette opinion, c'est la configuration même du canal de Notger aux abords du Pont d'Ile. Là, comme on peut le voir encore sur les anciens plans de la ville, il s'élargissait à l'excès, se bifurquait en plusieurs bras et formait quantité d'îles. Pourquoi? Ce n'est certainement pas la main de l'homme qui les a formées, car cet élargissement, qui diminue la profondeur de l'eau, est des plus nuisibles à la défense et au commerce. Dira-t-on que ce phénomène s'est produit à la longue? Mais nous voyons que l'une de ces îles, celle qui portait le nom de Torrent, existait déjà du temps de Notger lui-même. Voici ce qu'on lit dans l'obituaire de Saint-Denis, aux archives de l'État, à Liège: Aprilis, IIII nonas, cornmemoratio Nogeri episcopi qui dedit nobis duo molendina in Torrente, etc. D'autre part, le petit Torrent est mentionné déjà dans un diplôme du XIIe siècle.)
Je ne crois pas que le besoin de la défense ait été la principale raison qui décida Notger à canaliser le bras de la Meuse. Ce fossé rempli d'eau, qui alors enveloppait de toutes parts le quartier de l'Ile, n'était pas une défense suffisante pour valoir les peines qu'il coûtait, et on ne comprendrait pas le plan de Notger, s'il ne s'était agi avant tout, dans sa pensée, d'amener jusqu'au coeur de sa ville la circulation marchande qui avait lieu sur la Meuse. En d'autres termes, l'approfondissement du fleuve avait un but commercial autant que stratégique, et l'écrivain du XIe siècle à qui nous devons la connaissance de ce travail semble bien l'avoir compris dans ce sens, puisqu'il nous dit, avec une réminiscence biblique, que Notger voulut que l'élan du fleuve réjouît la cité de Dieu (419).
Ainsi une double ville: la Cité ou Château (420), avec on enceinte fortifiée, et, au-devant d'elle, l'Ile défendue par le cours de son fleuve, tel était le Liège notgérien.
Les deux villes, s'il est permis d'employer cette expression, étaient reliées entre elles par un pont situé dans l'axe de la rue qui porte encore aujourd'hui le nom de Pont d'Ile (420). Du côté du sud, l'Ile elle-même communiquait avec la campagne par un autre pont dit le Pont d'Avroy, parce qu'il menait au village de ce nom. Le Pont d'Avroy existait déjà en 1056, année où, à l'occasion d'une translation de reliques, l'affluence y fut tellement intense qu'il faillit crouler sous le poids des passants (421).
La dualité de la Cité et de l'Ile correspond, à Liège, à la dualité de la Cité et du Bourg, telle qu'on la remarque dans plus d'une ville épiscopale de la France (422). La Cité, c'est chaque fois la vieille ville où se trouvent la cathédrale et la résidence de l'évêque; le Bourg, comme l'Ile à Liège, c'est le quartier qui est venu s'adjoindre à la ville et qui en représente le premier accroissement à partir de l'ère moderne. Seulement, tandis qu'ailleurs l'opposition des deux termes persiste encore aujourd'hui dans la toponymie, à Liège, on en a perdu le souvenir depuis longtemps, et la trace la plus récente que j'en rencontre se trouve dans un auteur du XVe siècle disant que le Pont d'Ile menait à la Cité (423).
Par ce qui vient d'être dit, on peut se convaincre que ce n'était pas un mince travail de clore la ville de Liège. Épandue dans deux vallons, avec une partie qui gravissait les hauteurs, et une autre qui s'entourait d'un bras du fleuve, elle était difficile à fortifier, et l'on peut dire qu'elle fut toujours de faible défense. La vraie forteresse du pays, c'était Huy, dont le site presque inexpugnable lui valait d'être le refuge ordinaire des princes. Mais du moins, à partir des travaux de Notger, l'ennemi ne viendra plus impunément assaillir la capitale de l'État: il la trouvera prête à le repousser. Des vigies l'observent du haut des nombreuses tours de l'enceinte, des portes garnies de solides verrous lui barrent le passage; derrière les murs, toutes les maisons, même celles des clercs, se transforment en arsenaux, et les bourgeois en armes sont prêts, à toute heure, à défendre la liberté de la patrie (424). Aussi la ville de Liège ne recevra-t-elle la visite de l'ennemi que lorsque, au XIIe siècle, elle aura laissé tomber en ruines l'enceinte notgérienne avant de l'avoir remplacée en temps utile par une enceinte nouvelle (425).
Pénétrons maintenant dans la ville pour considérer l'imposant ensemble de constructions dont nous venons de décrire la ceinture.
La première chose qui doit attirer notre attention, ce sont les trois basiliques faisant partie de l'enceinte muraillée, à savoir Saint-Martin, Sainte-Croix et Saint-Denis. Tout permet de les regarder comme les plus anciens des édifices religieux dont nous avons à raconter l'histoire. La chose est certaine pour Saint-Martin, qui est une fondation d'Eracle; elle ne l'est guère moins pour Sainte-Croix et pour Saint-Denis, puisque l'érection de la première fut commencée avant l'existence des fortifications, et que toutes les deux ont dû, faisant partie de celles-ci, être achevées en même temps qu'elles (426).
Saint-Martin et Sainte-Croix, rebâties à une époque postérieure, ont subi trop de remaniements pour qu'on puisse encore se faire une idée de leur aspect primitif et de leur agencement dans l'oeuvre de la défense. Mais Saint-Denis est toujours debout, dans la fruste antiquité de sa haute tour carrée, percée d'étroites meurtrières et couvrant de sa masse opaque, comme d'un solide bouclier, tout le reste de l'édifice sacré aligné derrière elle. L'aspect austère de ces murs nus et sombres évoque bien l'idée d'une architecture qui fut militaire et religieuse à la fois; il devait être le même que celui des deux autres sanctuaires encastrés. Et l'observateur qui, placé en Ile, aurait contemplé de ce côté la muraille de Liège, aurait été frappé de la voir courant dans la plaine au-delà du fleuve, escaladant la colline, accentuée de tours et articulée en quelque sorte par les trois vastes basiliques qui s'incorporaient avec elle.
Nous possédons quelques renseignements sur chacune de ces trois forteresses sacrées. Saint-Martin, on l'a vu, devait son origine à Eracle; il l'avait largement doté, il y avait mis trente chanoines (427), il rêvait même, s'il en faut croire un érudit liégeois, d'en faire sa cathédrale (428). De fait, il avait son palais sur la colline, sans doute dans le voisinage du sanctuaire. Selon toute apparence, l'église était achevée à l'avènement de Notger, et celui-ci n'eut pas à y mettre la main. Elle lui dut cependant un autre service et des plus précieux. Le biens dont Eracle avait gratifié sa fondation furent, après sa mort, revendiqués par Otton III comme des fiefs royaux. Il fallut tout le crédit dont Notger jouissait à la cour pour décider l'empereur à renoncer à ses prétentions; grâce à lui, la donation d'Eracle resta acquise à son sanctuaire favori (429).
Pour Sainte-Croix, on sait déjà la curieuse histoire de cet édifice sacré, qui venait prendre sur la colline de Publémont la place d'un château-fort projeté. L'évêque intervint dans les frais de la construction, et il n'eut pas de repos jusqu'à ce qu'il le vît achevé avec son cloître, qui contenait une population de quinze chanoines (430). Après cela, il obtint la confirmation de la fondation par un diplôme impérial qui lui fut accordé par Henri II, de résidence à Aix-la-Chapelle, le 5 avril 1005 (431). Toutefois, si grande que fût la part de Notger dans l'édification de Sainte-Croix, cette église n'oublia pas l'homme auquel elle devait le plus après lui, et elle garda pieusement le tombeau du prévôt Robert, qui vint reposer dans la nef sous le crucifix, devant l'autel de sainte Hélène (432).
Saint-Denis également fut élevé sur les terres du chapitre de la cathédrale et avec le concours d'un de ses dignitaires (433) Elle eut pour fondateur Nithard, chanoine-coste de Saint-Lambert, auquel s'associèrent, nous dit un chroniqueur, ses frères Jean et Godescalc, qui l'enrichirent de leurs donations (434). C'était une église romane à une seule nef, avec un narthex à l'occident et une crypte sous le choeur. La crypte a disparu (435); quant au narthex et à la nef, ils offrent le pur caractère de l'art roman du Xe siècle (436). Bâtie en petit appareil, en pierres de grès rongées par le temps, flanqué de bas-côtés d'époques diverses et terminés par un choeur gothique du XIVe siècle qui surgit fort au-dessus du reste de l'édifice, l'église Saint-Denis, avec son cloître méridional aujourd'hui remanié, présente à l'historien et à l'archéologue une des pages les plus attachantes de l'histoire architecturale de Liège (437).
Nous savons par Anselme qu'un personnel de vingt chanoines fut attaché, dès l'origine, à cette église. Mais par la suite, - c'est-à-dire, si je comprends bien, encore du vivant de Notger - ce chiffre fut porté à trente (438). II est peu probable que l'augmentation ait eu lieu après le règne de ce prince, c'est du moins là l'interprétation la plus obvie du texte d'Anselme, et on ne comprendrait pas pourquoi, s'il en était autrement, cet écrivain ne nous en aurait rien dit et aurait à dessein employé des expressions dont le vague est fait pour induire en erreur. Les historiens liégeois ont donc tort une fois de plus qui redisent, sur la foi de Jean d'Outremeuse, que Nithard avait fondé vingt canonicats et que deux ans après Notger en ajouta dix (439). II est manifeste que, fidèle à son habitude, le chroniqueur du XIVe siècle veut se donner l'air d'en savoir plus que les sources et invente purement et simplement.
Comme à Sainte-Croix, le fondateur de l'église Saint-Denis trouva l'hospitalité du tombeau dans le sanctuaire qu'il avait bâti. On voyait encore, du temps de Gilles d'Orval, la sépulture de Nithard au milieu du choeur, tandis que ses deux frères, Jean et Godescalc, reposaient, le premier devant le crucifix, l'autre derrière l'autel de Sainte-Gertrude (440), érigé autrefois sous la tour (441). Aujourd'hui, des pierres commémoratives placées, l'une dans la muraille du jubé, l'autre dans la chapelle Saint-Pierre, rappellent le souvenir de Nithard et de Godescalc (442).
Voilà comment la Cité se trouvait dotée au point de vue religieux. Avec la cathédrale, dont il sera question plus loin, et l'église Saint-Pierre, fondation de saint Hubert, à laquelle il ne parait pas que Notger ait touché, on y comptait cinq grands sanctuaires, les deux anciens au centre et les trois nouveaux aux extrémités. Il s'agissait maintenant de pourvoir aussi aux intérêts de l'Ile. Là s'élevaient les assises.de Saint-Paul, sanctuaire commencé par Eracle et qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Au moment de sa mort, comme nous l'apprend indirectement le Vita Notgeri, la construction n'arrivait encore qu'à la hauteur des fenêtres (443). Nous voyons cependant que cette collégiale avait déjà été dotée par l'évêque défunt, car en 1111, l'évêque Otbert atteste qu'elle tenait de sa libéralité le village de Lixhe (444). Notger eut donc à achever l'édifice; de plus, il porta à trente le nombre des chanoines, qui était primitivement de vingt (445), et, probablement aussi, il augmenta le patrimoine de l'église. Voilà tout ce que nous apprennent les sources dignes de foi; quant aux autres, elles ont tissé autour des origines de Saint-Paul tout un réseau de légendes gracieuses autant que fragiles (446).
Pour compléter la liste imposante des églises collégiales que le règne de Notger vit achever ou édifier, il nous reste à parler du sanctuaire qui fut son oeuvre favorite, c'est-à-dire de l'église Saint-Jean l'Evangéliste en Ile. Notger la bâtit sur un monticule au bord de la Meuse, en face des tours de la cathédrale dédiée à Notre-Dame et à saint Lambert, afin, nous dit son biographe, que le disciple dont le Christ, du haut de la croix, avait fait le fils de la Vierge, eût toujours la vue de sa mère, et que le gardien de la Vierge fût par elle gardé (447). Notger destinait ce sanctuaire à lui servir de lieu de retraite de son vivant, et de sépulture après sa mort. II l'édifia sur le type de la basilique Notre_Dame d'Aix-la-Chapelle (448): un octogone surmonté d'un dôme (449). Aujourd'hui encore, malgré la modernité de l'édifice qui a remplacé celui de Notger, l'oeil de l'observateur est frappé à première vue de la parenté de ces deux sanctuaires.
Il ne reste plus rien de la construction notgérienne. La vieille et vénérable tour carrée qui surgit, toute bardée de fer, avec son appareil irrégulier, au milieu du cloître silencieux de Saint-Jean, est elle-même de date postérieure; selon toute apparence, elle ne fut bâtie que dans la seconde moitié du XIe siècle (450).
Notger fit lui-même les frais de cette construction (451). Il fonda un collège de trente chanoines, qu'il dota avec la plus grande libéralité « Les revenus actuels des prébendes, dit un historien du XVIIIe siècle, sont une preuve certaine qu'il n'épargna rien pour faire de cette fondation un monument éternel de sa générosité (452) ». Il enrichit l'église de reliques insignes, notamment de celles de saint Vincent lévite, et des saints Fabien et Sébastien (453), sans doute portées de Rome au retour d'un voyage dans la Ville éternelle. Il lui donna de riches ornements: des parements d'autel, des tapis, des draperies, des vases sacrés, des candélabres et d'autres ustensiles nécessaires au culte (454). Il lui constitua un domaine important dont malheureusement la rareté de nos sources ne permet pas de reconstituer l'ensemble. Sa générosité envers son sanctuaire ne s'arrêta pas après l'acte de fondation. Nous retrouvons dans les biens de Saint-Jean en Ile les terres de Heers et de Fumal, dont il ne fit l'acquisition qu'en 1002, nous y retrouvons aussi le plus précieux livre possédé par la bibliothèque de Liège, c'est-à-dire l'évangéliaire dont il se servait et qu'il aura légué, par testament, à son église de prédilection (455).
Ce n'est pas tout. Il sut encore associer l'empereur lui-même aux libéralités dont ils se plaisait à combler le sanctuaire du disciple bien-aimé. Le 9 avril 997, étant à Aix-la-Chapelle, Otton III lui fit don, « pour les frères du monastère nouvellement construit dans l'Ile devant la Cité », des biens de Maren, de Kessel et de Hedikhuyzen. Plus tard, à la demande du pape Sylvestre II, il y ajouta la terre d'Heerwaarden avec ses dépendances (456).
Mais cette couronne de collégiales ne suffisait pas à Notger, et il voulut que la ville qu'il venait de créer eût une cathédrale digne d'elle. Tel n'était pas le modeste sanctuaire élevé par saint Hubert. Il ne correspondait ni par ses proportions, ni par sa beauté, à ce qu'était devenue la capitale de la principauté de Liège. II convenait que le temple auguste où battait le coeur de la cité, et qui conservait le palladium de la nation, c'est-à-dire la châsse de saint Lambert, ne fût pas éclipsé par les églises qui se rangeaient autour de lui comme des vassales. Selon l'auteur du Vita Notgeri, il faudrait admettre un autre motif: la basilique du VIIIe siècle, dit-il, n'était plus capable de résister au poids des années (457). Il est permis de douter de cette affirmation, qui semble bien n'être qu'une formule, ou tout au moins une conjecture. Après le passage des Normands, nous retrouvons Saint-Lambert debout (458), non qu'en effet ce sanctuaire ait échappé aux coups des barbares, mais parce qu'il a été restauré de bonne heure. Le fait que les évêques Francon et Étienne y avaient trouvé leur tombeau montre bien que dès les premières années du Xe siècle, tout au moins, la cathédrale de Liège avait réparé les dégâts dont elle pouvait avoir pâti pendant la génération précédente. (459). II est donc plus conforme à la vraisemblance d'admettre que Notger n'a pas eu besoin de démolir la cathédrale de saint Hubert par besoin de sécurité. En la reconstruisant sur un plan plus vaste, il se sera inspiré « de la magnificence de son grand coeur », comme s'exprime son biographe (460). II bâtit en même temps l'église paroissiale de Notre-Dame, adjacente à la cathédrale, les cloîtres du chapitre, qui touchaient au sanctuaire du côté de l'est et du nord, et, enfin, le palais épiscopal: c'était un vaste ensemble de constructions opulentes, constituant comme une cité ecclésiastique renfermée dans l'autre cité (461). Le biographe nous parte avec enthousiasme de cette oeuvre ample et superbe, qui était l'ornement de la ville et comme le symbole de la patrie naissante.
S'il était vrai, comme le croient les historiens modernes sur la foi de textes qui semblent l'insinuer, que la cathédrale soit la première en date de toutes les constructions de Notger (462), alors il y aurait travaillé pendant toute la durée de son règne. La chose n'aurait rien d'impossible en, soi: il fallut sept ans à Gérard de Cambrai pour bâtir sa cathédrale (463), et Willigis de Mayence en mit trente à achever son église métropolitaine (464). Mais si la construction de Saint Lambert avait requis un temps aussi considérable, on nous l'aurait probablement dit, et il est hautement probable que l'enceinte, avec ses trois collégiales, et l'Ile, qui en avait deux, dont une inachevée, ont sollicité plus tôt l'attention du prélat. Au surplus, nos sources n'exagèrent pas quand elles nous parlent de l'immensité de l'entreprise, du grand nombre des ouvriers qu'on y employa et de l'énormité de la dépense (465).
En effet, c'est sur les fondements du monument notgérien que surgit, après l'incendie de 1185, la troisième et dernière des cathédrales consacrées à saint Lambert; elle avait par conséquent, au ras du sol, les proportions du gigantesque sanctuaire du Xe siècle (466). Celui-ci mesurait donc, comme celui du XIIe, 90 mètres en longueur et 31 mètres en largeur, proportions que la cathédrale actuelle de Liège est loin d'atteindre, car elle n'a que 70 mètres de longueur sur 32 de largeur.
Cela étant, il n'y a pas lieu de s'étonner que Notger ait eu à peine le temps de mettre la main à ce majestueux édifice, et qu'il n'ait pas eu la satisfaction de le consacrer. Cette joie était réservée à son successeur Baldéric II, qui procéda à la dédicace le 28 octobre 1045 (467).
La cathédrale notgérienne était un édifice roman orienté et muni, comme un grand nombre d'églises allemandes et surtout rhénanes, de deux absides hémisphériques, sous chacune desquelles s'ouvrait une crypte. Dans l'abside occidentale ou supérieure se trouvait l'autel des saints Cosme et Damien et celui de la Trinité; la crypte de cette abside renfermait les restes de saint Lambert. L'abside orientale ou inférieure était dédiée à la sainte Vierge, qui partageait avec saint Lambert le patronage du sanctuaire beaucoup d'évêques du diocèse reposaient dans sa crypte.
Deux portes latérales, l'une au nord-ouest et l'autre au sud-ouest, mettaient en communication l'édifice sacré avec les divers quartiers de la ville. Celle du nord-ouest s'ouvrait sur une place qui fut, jusqu'à la fin du XIe siècle, le marché de la ville de Liège, et qui a été connue depuis cette date sous le nom du Vieux Marché. Au sujet de cette porte, le biographe de Notger nous a conservé un détail plein d'intérêt, qui atteste, de la part de ce grand prélat, un sens respectueux du passé et comme une préoccupation d'archéologue: Notger y avait fait aligner des deux côtés les colonnes de l'ancienne cathédrale, avec leurs piédestaux et leurs chapiteaux, et l'oeil du visiteur pouvait ainsi comparer les proportions de l'ancien édifice avec celles du nouveau (468).
Notger replaça dans la nouvelle église les sarcophages ou les châsses de ses prédécesseurs qu'il avait trouvés dans l'ancienne. Nous savons par nos sources que saint Floribert, le plus ancien habitant de la cathédrale souterraine, fut déposé sous l'autel de la crypte orientale dans son sarcophage de marbre blanc (469). D'autres évêques, parmi lesquels Francon et Étienne, qui reposaient également dans la cathédrale primitive, reprirent probablement leur place dans la nouvelle. L'évêque tenait à ce que le sanctuaire ne perdit rien de son prestige ancien, tout en conquérant un éclat nouveau. Il l'enrichit de nombreux ornements et il y fit régner toute la majesté des cérémonies liturgiques. Dans ce but, il porta à soixante le nombre des chanoines (470) voués à l'office divin dans ce grandiose monument à la fois religieux et national, diadème splendide que le prélat civilisateur avait placé au front de sa capitale (471).
Les cloîtres de la cathédrale, où les chanoines de Saint-Lambert, conformément à la règle édictée en 817 par le concile d'Aix-la-Chapelle, menaient la vie commune, s'élevèrent l'ouest et au nord du temple: disposition peu ordinaire et qu'explique peut-être la difficulté qu'on éprouvait dès lors à procurer un autre emplacement au sein de la ville déjà florissante. Ces cloîtres étaient entourés d'un haut mur qui leur donnait l'aspect austère d'une forteresse ou d'une prison; les portes en étaient fermées après complies et la clef remise l'évêque (472).
La charité eut son palais dans la même enceinte. Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 817, avait exigé que chaque évêque eût près du cloître de sa cathédrale un hospice pour les pauvres et pour les étrangers. Cette maison devait être dotée des ressources nécessaires; chaque clerc était tenu de lui abandonner le dixième de son revenu; un chanoine respectable en avait la direction; pendant le carême, les clercs y lavaient les pieds des pauvres (473). Ces dispositions, violées ou négligées vers la fin de la dynastie carolingienne, reprirent toute leur vigueur sous les princes de la maison de Saxe, et l'organisation des institutions charitables atteignit en quelque sorte son apogée (474). On ne peut pas douter, écrit un historien de la charité, qu'à cette époque chaque ville épiscopale ait possédé les hospices prescrits par la législation carolingienne (475). La vie des grands évêques qui furent les contemporains et les amis de Notger est remplie de traits qui attestent leur sollicitude pour leurs pauvres, et pour les maisons dans lesquelles ils pourvoyaient aux besoins des indigents et des voyageurs.
Notger n'est pas resté en arrière d'eux sous ce rapport. Il fut doux aux pauvres; il aimait à leur distribuer ses aumônes et à visiter les malades, et sa large hospitalité est glorifiée en ces termes par un poète qui écrivait peu de temps après sa mort: « Nulle part l'étranger n'est l'objet de soins si prévenants. L'exilé qui venait à Liège croyait se retrouver chez lui: jamais la nourriture n'y fit défaut aux pauvres, ni le vêtement à ceux qui étaient nus. » (476).
Il n'est nullement nécessaire de supposer que c'est Notger qui a créé l'hospice de la cathédrale de Liège, et c'est même le contraire qui est vraisemblable. Depuis Étienne, les évêques s'étaient employés à restaurer dans leur ville épiscopale les oeuvres de religion et de charité: ils n'avaient pu oublier l'hospice. Notger aura rebâti celui-ci, comme il a rebâti la cathédrale elle-même, pour l'agrandir et la développer. Nos sources, à la vérité, ne nous le disent pas, parce qu'elles sont d'un laconisme extrême, mais elles l'insinuent en nous montrant l'hospice en pleine activité quelques années après la mort de Notger. Placé sous la direction d'un dignitaire du chapitre de Saint_Lambert (477), il touchait la none et la dîme de tous les biens de l'évêché (478). Baldéric II, premier successeur de Notger, lui fit de grandes libéralités (479), et l'illustre Wazon, à qui la direction en fut confiée vers 1032, l'administra si bien qu'il le fit arriver à un haut degré de prospérité (480), Plus tard, au commencement du XIIe siècle, l'abbé Hellin l'agrandit et le dota richement (481), et enfin, dans les premières années du XIIIe, Gautier de Chauvency, doyen du chapitre de Saint-Lambert, le rebâtit de fond en comble sur un emplacement nouveau (482).
L'hospice notgérien, placé sous l'invocation de saint Mathieu, était connu, dès 1117, sous le nom d'hospice à la chaîne (483 ... Ces chaînes pendaient donc juste au-dessus de la porte du cloître qui s'ouvrait près de l'hospice, et ainsi s'explique le nom d'hospice à la chaise porte par celui-ci. Chose curieuse, il garda ce nom même après qu'en 4204, Gautier de Chauvency l'eut transféré place du Théâtre, en Gérardrie, comme disent nos textes. ...). Il occupait, depuis Notger, l'angle nord-ouest les cloîtres de Saint-Lambert, à l'entrée du Marché, qui était contigu alors au côté septentrional de la cathédrale, et il resta, jusqu'à la fin du moyen-Age, le principal sanctuaire le la charité liégeoise.
A côté de la cathédrale et des cloîtres fut édifié en même temps le palais épiscopal (484). Dans toutes les villes diocésaines, la résidence de l'évêque s'est trouvée près de sa cathédrale, et le nom de domus ecclesiae, qu'elle a porté à l'origine, indique assez bien cette relation de dépendance. Nous avons le droit de croire que Liège ne fit pas exception à la règle, et que, depuis saint Hubert, nos évêques ont demeuré dans le voisinage de Saint-Lambert. C'est là que Sedulius aura vu le palais de Hartgar qu'il décrit dam ses vers (485). Mais, lors de la destruction de Liège par les Normands, le palais épiscopal subit probablement le sort de la cathédrale, et les évêques, à ce qu'il parait, se réfugièrent dans une maison située sur la colline de Publémont. Du moins, c'est là que, au témoignage d'un contemporain, l'évêque Eracle avait sa résidence (486). Près d'un siècle s'était écoulé depuis le désastre, lorsque Notger imagina de rendre à lui-même et à ses successeurs une demeure digne d'eux, en rebâtissant sur un plan agrandi le palais qui avait abrité Hartgar. Nos sources ne nous disent pas, il est vrai, qu'il le construisit à proximité de la cathédrale, apparemment parce qu'elles n'avaient pas besoin d'apprendre ce détail à des lecteurs qui avaient ce monument sous les yeux; il nous suffit d'ailleurs de constater qu'à partir de Notger nous ne cessons pas de rencontrer le palais épiscopal à la même place. On comprend donc à peine l'aveuglement de certains érudits liégeois qui, sur la foi des indices les plus fallacieux, se sont amusés à chercher ce palais dans des sites invraisemblables, plutôt que de s'en rapporter à ce que suggère le témoignage du bon sens confirmé par tous les textes historiques (487).
Tout indique que les proportions du palais de Notger étaient considérables, et en rapport avec celles de sa cathérale. Il était flanqué d'un jardin ou préau (488) dans lequel, aux grandes occasions, se donnaient des festins solennels; C'est là qu'en 1071, l'empereur Henri IV banqueta avec son entourage, et jusqu'à la fin de l'ancien régime, les princes-évêques de Liège restèrent fidèles à l'usage d'y diner en public à ciel ouvert, aux fêtes de leur joyeuse entrée et en d'autres circonstances encore (489). Ce palais épiscopal fut consumé en 1185 par l'incendie qui dévora la cathédrale, mais déjà Raoul de Zähringen le rebâtissait dans toute sa splendeur primitive (490).
Il ne faut pas se figurer le palais de Notger comme un de ces édifices somptueux et élégants qui, à partir de la Renaisance, se multiplièrent dans les grandes villes. II ne ressemblait en rien à celui qu'Erard de la Mark, au XVIe siècle, éleva sur les fondements de l'ancien, et que certains étrangers admiraient comme le plus beau de la chrétienté (491). Le palais de Notger avait plus de solidité que d'élégance, et s'il frappa les esprits des contemporains, ce fut par la masse imposante de ses pierres, contrastant avec la simplitcité des constructions en bois de l'époque. En un temps où nul, prince ou simple chevalier, n'était en sûreté qu'à l'abri une bonne forteresse, il n'est pas probable que le palais ait été autre chose qu'une maison fortifiée. Bien plus, sa proximité des murs de l'enceinte, à laquelle il touchait au nord, a donné lieu dans les derniers temps à une conjecture séduisante, d'après laquelle le palais de Liège, comme plus tard le Louvre à Paris, aurait fait partie de l'enceinte muraillée de la ville. Le côté septentrional de ce vaste édifice, garni d'ouvrages défensifs tels que meurtrières, mâchicoulis, créneaux, aurait formé le point de jonction des deux sections du rempart, dont l'une venait du côté de Saint-Martin et l'autre de la rue Hors-Château. Mais ce tracé aurait laissé en dehors de l'enceinte une grande partie de la vieille ville avec l'église de Saint-Servais, et il est par conséquent très peu probable.
Au sud de la cathédrale, et en quelque sorte à l'ombre de celle-ci, dont elle n'était séparée que par une sorte de couloir servant de cimetière, Notger rebâtit l'église paroissiale de Liège. Fondée probablement par saint Hubert, lorsqu'il transporta la résidence épiscopale auprès du tombeau de son prédécesseur, cette église, dédiée à Notre-Dame comme celles de Tongres et de Maestricht, était à proprement parler le baptistère de la cité. Elle avait péri avec les autres monuments liégeois sous les coups des Normands, mais elle fut parmi les premières que l'on rebâtit après le départ de ces féroces déprédateurs (492). Notre-Dame, voisine de la cathédrale, en partagea d'ordinaire les destinées. Surgissant l'un à côté de l'autre comme deux frères jumeaux, les deux sanctuaires marquaient, par la différence de leurs proportions, celle de leurs destinations particulières, celui-ci servant au diocèse, celui-là à la paroisse (493 C'est ici le lieu de rappeler l'opinion émise par M. J. Demarteau, Les premières églises de Liège (BSAHL), t. VI, 1892), d'après laquelle l'église Notre-Dame ne serait autre chose que l'ancien oratoire existant a Liège dès le temps de saint Lambert et mentionné dans la vie de ce saint. M. Demarteau a failli me convertir à son opinion, tant il la défend avec érudition et ingéniosité; si je m'y suis finalement dérobé, c'est 1° parce que la tradition liégeoise relative à une chapelle des saints Cosme et Damien à Liège remonte au moins jusqu'au XIe siècle (y. le Vita Servatii manuscrit do Jocundus; le Vita Lamberti attribué à Godescalc dans Chapeaville, o. c. t. I, p. 336 et le Vita Lamberti du chanoine Nicolas dans Chapeavilie, o. c., p. 405); 2° qu'elle explique seule, dune manière satisfaisante, le culte des dits saints dans le choeur occidental de Saint-Lambert; 3° que ce culte est immémorial dans le pays de Liège; à Huy, il existait dès le VIIe siècle. (V. Hériger, c. 31. p. 179, cf. idem, c. 30, p. 177, 40.))
Comme l'indique son nom de Notre-Dame aux Fonts, ce sanctuaire était l'église baptismale de toute la ville de Liège. Mais, après qu'il eut ajouté à la Cité tout le vaste quartier de l'Ile, Notger voulut donner à ce dernier les prérogatives de la Cité, et c'est pourquoi l'lle reçut une église paroissiale à elle. Il l'éleva dans le voisinage de Saint-Jean et la plaça sous l'invocation de son ami Adalbert de Prague, qui venait de cueillir les palmes du martyre en Prusse (997) et qui, dès le 29 juin 999, avait eu à Rome les honneurs de la canonisation. Tout l'occident était rempli du nom du nouveau saint, qui faisait descendre sur l'Eglise du Xe siècle la gloire dont s'étaient empourprées ses premières années. On peut bien se figurer avec quelle émotion ceux qui avaient été ses amis ici-bas s'associèrent aux honneurs qui lui étaient rendus, et on est touché de voir que Notger a été le premier à le glorifier. Saint-Adalbert devint l'église paroissiale de l'lle, comme Notre-Dame était celle de la Cité. Tous les habitants de ce vaste quartier, à part les clercs, devaient y recevoir les sacrements de baptême, d'eucharistie et d'extrême-onction, et les femmes devaient y faire leurs relevailles. Le lien hiérarchique qui rattachait à Notre-Dame tous les sanctuaires du territoire de Liège ne fut toutefois pas rompu: le curé de Saint-Adalbert dut reconnaître à celui de Notre-Dame l'autorité archidiaconale, et aller assister trois fois l'an aux synodes tenus dans cette église (494).
Y eut-il à Liège, en dehors de Saint-Adalbert, d'autres paroisses fondées par Notger? Il ne le semble pas (495). À Liège, comme partout ailleurs, c'est seulement au XIIe siècle que les paroisses commencent à se multiplier. Cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas existé d'autres oratoires que ceux qui viennent d'être énumérés; on a vu que Saint-Servais date du commencement du Xe siècle (496), et nous savons que les oratoires étaient déjà nombreux dans les villes du Xle siècle. Mais, à Liège comme ailleurs, ce n'étaient que des chapelles et nullement des églises paroissiales (497).
Tant de sanctuaires et d'écoles ecclésiastiques supposent un personnel de prêtres et de clercs extraordinairement nombreux. Rien que dans la cathédrale et dans les six collégiales, il y avait deux cent vingt-cinq chanoines (498), et le nombre des autres prêtres et clercs de toute catégorie devait être plus considérable encore. Il n'y a donc aucune exagération à admettre pour le Liège du XIe siècle une population d'au moins six cents prêtres, sans compter les étudiants qui peuplaient les diverses écoles et dont les uns formaient la pépinière du sacerdoce, tandis que les autres étaient pris dans l'élite du monde séculier.
| A la cathédrale |
60 chanoines |
| A Saint-Pierre |
30 |
| A Sainte-Croix |
15 |
| A Saint-Martin |
30 |
| A Saint-Paul |
30 |
| A Saint-Denis |
30 |
| A Saint-Jean |
30 |
| Total |
225 |
A la suite des grands travaux dont nous avons essayé de présenter l'aperçu, Notger possédait une capitale qu'il devait presque tout entière à son activité créatrice. Essayons de nous la figurer telle qu'il l'avait faite. Pour cela, descendons le long de la Légia (499) des hauteurs boisées d'Ans, où elle sourd à l'ombre de la forêt de Glain, et entrons avec elle dans la ville, où elle pénètre sous une voûte du mur d'enceinte. Nous traversons le frais vallon où le village de Liège est né quelques siècles auparavant, et dont les hauteurs gardent encore, malgré leurs transformations, quelque chose de leur origine agreste. A main droite, nous avons la riante colline de Publémont avec ses trois sanctuaires de Saint-Martin, de Sainte-Croix et de Saint-Pierre; à gauche, ce sont les hauteurs abruptes et pittoresques de Pierreuse, au pied desquelles s'appuie le modeste oratoire de Saint-Servais. La Légia, après avoir reflété ces beaux lieux, sort de son vallon natal pour entrer dans la large vallée de la Meuse; elle laisse à main droite, d'abord le palais épiscopal, ensuite le choeur oriental de la cathédrale, dont elle lèche la base, puis, coulant toujours à ciel ouvert sous une série de ponceaux jetés devant les maisons bâties sur ses bords, elle traverse le quartier populeux où sont logés les pauvres secourus par la matricule de la cathédrale. C'est toujours dessous le moustier, comme on disait au moyen âge, que cette humble clientèle de la charité catholique est venue s'abriter, groupant ses pauvres maisons de clayonnage autour du noble édifice, comme des poussins sous les ailes de leur mère. La matricule a donné son nom à ce quartier indigent (500), que les Liégeois appelaient dans leur langue la Mierchoule, et elle finit même par le donner aussi au ruisseau (501). Celui-ci va d'ailleurs atteindre l'extrémité de son itinéraire: voici le Vivier ou port de Liège, près duquel il se jette dans la Meuse.
Aucun pont ne relie encore les deux rives du fleuve: c'est une vingtaine d'années plus tard que Réginard, quatrième successeur de Notger, bâtira, le premier, le Souverain Pont, qui sera plus connu sous le nom de Pont des Arches (502). Toutefois, sur la rive droite, il surgit déjà des habitations qui forment le noyau du populeux quartier d'Outre-Meuse. Au sud de la ville, passé l'Ile, de belles auvrayes ont laissé leur nom au village d'Avroy (503 Avroy s'appelle au IXe siècle Arbrido; ce nom vient d'Arboretum, qui signifie un lieu planté d'arbres, V. BCRH, Ve série, t. III (1833), p. 415), qui était déjà habité du temps de saint Lambert et le quartier de Saint-Christophe commence à se peupler aussi. Une grande partie de la vallée est encore envahie par la végétation sauvage; l'Ile elle-même appartient encore à la forêt et aux bêtes sauvages (504). Mais partout la vie urbaine germe; Notger aura fermé à peine les yeux que surgira le monastère de Saint-Jacques au sud et au nord, la collégiale de Saint-Barthélemy hors Château. On sent que l'enceinte tracée par le grand prélat ne sera pas longtemps trop vaste, et qu'il n'a pas trop présumé de l'avenir. Le XIe siècle ne touchera pas à sa fin sans avoir fait du vicus Leodicus une grande ville. Ni Bruges, ni Gand, ni Anvers, ni Louvain ne pouvaient rivaliser, à cette époque, avec la cité de saint Lambert. Aussi longtemps que le commerce ne les eut pas enrichies et n'eut pas fait affluer dans leurs murs les multitudes humaines, elles firent pauvre mine, ces villes ouvertes et sans monuments, au regard de la belle capitale épiscopale, où, par dessus une ceinture de murailles et de canaux, on voyait surgir les tours des églises et des palais. Cette capitale était avant tout une ville ecclésiastique savante; elle devait son éclat à ses églises, comme Rome, ses écoles, comme Oxford, à son nombreux clergé, à la présence du prince et de sa cour. Il devait venir, dans l'histoire du moyen âge, une heure où, grâce au progrès gigantesque du commerce et de l'industrie, les localités nommées tout à l'heure dépasseraient de beaucoup Liège en grandeur et en richesse, mais, en attendant, Liège devait rester, jusu'au XIIe siècle, la ville la plus peuplée et la plus vivante es Pays-Bas (505).
|
|



