|
Par un clair matin de mai 1758, un cavalier traversait le bras de la Meuse à la porte d'Avroy et prenait le chemin de halage vers Huy. Il portait l'uniforme des dragons belges au service de l'Autriche: habit blanc à parements bleus et galons d'or, bottes à retroussis, chapeau à passementerie d'or.
Jacques de Berloz - c'était le nom du cavalier - avait quelque peu dépassé la quarantaine, mais sa sveltesse et son allure martiale le faisaient paraître plus jeune. Depuis vingt ans il servait dans le régiment de dragons dont le prince de Ligne était propriétaire et il avait conquis le grade de lieutenant colonel. Il s'était distingué en maintes actions, à Fontenoy notamment, où il avait dépensé d'héroïques efforts pour arrêter l'avance française, puis dans la guerre contre la Prusse éclatée l'année précédente. Son audacieuse bravoure avait largement contribué à la victoire de Kollin, remportée sur Frédéric II par le maréchal Daun, le 18 juin 1757. Dans le combat livré ce jour-là autour du village de Kreczor, les dragons de Ligne, Jacques de Berloz en tête, au moment où tout semblait compromis, débouchèrent d'un bouquet de bois, se lancèrent impétueusement sur les Prussiens et les mirent en déroute, Ce brillant exploit valut au régiment un nouvel étendard où Marie-Thérèse avait brodé de ses mains impériales une rose entourée d'épines avec cette devise « Qui s'y frotte s'y pique ». Malheureusement, au cours de la charge, Jacques de Berloz reçut à la tête un coup de mousquet qui l'abattit de son cheval. La blessure était dangereuse. Il s'en remit, mais en garda un ébranlement nerveux. Son colonel, le comte de Thiennes, lui conseilla de prendre un congé. Et c'est ainsi qu'au printemps de 1758, Jacques de Berloz quittait la Bohême, où campait son régiment, pour aller passer quelque temps à Bruxelles, chez un de ses anciens compagnons d'armes.
Un soir de mai, il arrivait à Liège. Il ne comptait s'y arrêter que pour passer la nuit. Ce pays évoquait pour lui de trop pénibles souvenirs. Il y était né et y avait grandi, cependant. orphelin de bonne heure, il avait été confié par son tuteur au curé de Chokier, le révérend Hubert Firket, doyen du concile de Hozémont. Ce prêtre, bon latiniste, s'était occupé avec zèle de son instruction et l'avait aimé comme un fils. Et c'est dans ce gracieux village de Chokier que s'était écoulée son heureuse jeunesse, jusqu'au jour où un désespoir d'amour vint lui briser le coeur et orienter sa vie dans une voie nouvelle.
En une maison voisine du presbytère, vivait avec ses parents une jeune fille à peu prés de son age, belle, spirituelle et gaie, Rosine de Clermont. Il s'était épris d'une vive ardeur pour elle. Ses sentiments furent partagés et les solennelles promesses des amoureux s'échangèrent un soir au bord du fleuve, sous les tilleuls en fleurs.
Le curé Firket aurait préféré voir son élève suivre la carrière ecclésiastique. Mais il ne s'opposa pas à ce penchant, car les parents de Rosine, appauvris il est vrai par les guerres anciennes, étaient de bonne noblesse et très considérés.
L'avenir souriait donc à Jacques, quand un jour il apprit que le seigneur de Chokier recherchait Rosine et se proposait de la demander en mariage. Il ne put d'abord croire à cette fatale nouvelle. Force lui fut toutefois de se rendre à l'évidence. Rosine n'avait plus envers lui qu'une attitude contrainte et embarrassée. Et bientôt le curé Firket lui annonça, avec maints ménagements, qu'il était chargé de publier les bans de la jeune fille avec le seigneur de Chokier.
Jacques connut alors des heures affreuses. Vivre en ce pays lui était désormais impossible. Et sans attendre le jour où le mariage de Rosine consommerait son malheur, il résolut de s'expatrier en s'engageant dans le régiment des dragons de Ligne, où servait un de ses cousins. En vain le bon curé Firket s'efforça-t'il de le retenir. Quoiqu'il aimât le vieux prêtre et qu'il lui en coûtât de le quitter, sa décision fut inébranlable. Il partit à pied, au petit jour, pour gagner Liège. Quand il parvint au coude de la Meuse, il se retourna, et regardant une dernière fois le château de Chokier, farouchement perché, comme un vautour, sur son rocher à pic, il maudit l'homme funeste qui lui avait enlevé sa fiancée et se promit de ne jamais reparaître en ce cruel pays.
Jacques s'était tenu parole. Plus de 20 ans s'étaient écoulés. Et si, malgré sa ferme volonté, il n'avait pu oublier la perfide Rosine, si son amour repoussait toujours au travers de ses ressentiments, il avait évité de revenir au pays de Liège. Même il s'obstinait à ne demander à personne des nouvelles de Rosine. La seule chose qu'il apprit un jour par hasard, c'est qu'elle était devenue veuve après quelques années. Son mari, ivrogne et brutal, l'avait rendue fort malheureuse. Mais c'est à peine si Jacques l'avait plainte. Par sa perfidie, n'avait-elle pas mérité son sort ?
Comment se fit-il donc qu'en ce matin de mai, au lieu de gagner Bruxelles, il se trouvait courant au trot de son cheval, sur le chemin de Chokier ? C'est qu'une impulsion soudaine avait maîtrisé sa volonté. Un irrépressible désir lui était venu de revoir les lieux où s'était passée son enfance, ceux où il avait aimé et souffert, et d'aller prier sur la tombe du cher curé Firket dont il avait appris la mort arrivée peu après son départ. Quant à Rosine, il ne songeait nullement à la rencontrer, car sa rancune ne s'était pas apaisée. Vivait-elle encore d'ailleurs ? Il n'en savait rien; il ne voulait pas le savoir.
La journée s'annonçait superbe. La Meuse d'argent frissonnait sous les caresses de la brise et les jeunes baisers du soleil. Coquettement, le pays se faisait beau et gai, semblait-il, pour accueillir celui qui l'avait quitté depuis si longtemps, l'âme toute noircie de haine. Jacques sentait entrer insensiblement en lui l'apaisement suggéré par l'aimable horizon des collines mosanes. Les villages se succédaient, paisibles et souriants, dans leurs cadres de verdure. Voici Jemeppe, où se dresse, cernée de hauts arbres, la haute tour du manoir d'Antoine. Sur l'autre rive s'étale la large façade neuve du château de Seraing, récemment complétée par l'évêque Jean-Théodore de Bavière. Plus loin l'abbaye du Val-St-Lambert masse ses vastes cloîtres au débouché du vallon de Villencour.
Jacques arrive au tournant de la Meuse où se révèle le château de Chokier. Et à cette vue un flot de haine lui monte au coeur. Repaire maudit qui a ruiné son bonheur et endeuillé à jamais sa vie ! Jadis les seigneurs en descendaient pour rançonner et tourmenter voyageurs et marchands. Maintenant c'était pour voler aux amoureux leurs fiancées. Ils étaient bien restés les mêmes. Toujours aussi injustes, aussi cruels !
Voici les premières maisons de Chokier. Un tintement de marteau sur l'enclume apprend à Jacques que la forge du maréchal-ferrant Gihoul est toujours là. Il descend de cheval et y jette un coup d'oeil. Pierre Gihoul est mort sans doute, car il était âgé déjà il y a 20 ans. De fait, Jacques ne l'aperçoit pas, mais deux hommes travaillent à la forge. Dans leurs visages noircis par la poussière se retrouvent les traits de leur père. Toutefois Jacques ne tient pas à se faire reconnaître. Obsédé maintenant par la préoccupation de Rosine, à la fois brûlant et craignant de savoir, il ne veut pas les interroger. Il se borne à leur confier son cheval et poursuit sa route à pied.
Chokier n'a guère changé. Jacques revoit les visages familiers des maisons. Voici celle où habitait Rosine avant son mariage. La même glycine, tout en fleurs pour le moment tapisse encore de ses branches tortueuses et de ses grappes bleues la haute façade.
Une fenêtre est ouverte. Jacques y plonge un regard. C'est la chambre où il a passé avec Rosine tant de douces soirées. Mais les meubles ne sont plus les mêmes, car sans doute d'autres maîtres sont venus. Dans ce coin était le clavecin de Rosine. Et soudain un de ses airs favoris se réveille dans la mémoire de Jacques, celui d'Alceste au 3e acte de la tragédie de Quinault mise en musique par Lulli:
« Ah ! pourquoi nous séparez-vous ?
Eh ! du moins attendez que la mort nous sépare.
Cruels ! quelle pitié barbare
Vous presse d'arracher Alceste à son époux !
Ah ! pourquoi nous séparez-vous ? »
De quelle voix ardente et convaincue Rosine chantait ces vers de la fidèle et tendre Alceste ! Elle qui devait se prouver si fausse, si déloyale !
Quelques pas plus loin se dresse le presbytère, flanqué de son jardinet. Et l'âme de Jacques s'amollit en songeant aux jours ensoleillés de son enfance. Du lointain passé surgit la bonne figure souriante du curé Firket, encadrée de longs cheveux blanchis par l'âge. Jacques le revoit avec sa soutane râpée où manquait toujours quelque bouton, dépliant son grand mouchoir rouge à carreaux, ou tirant de sa poche sa boîte à priser et, d'un pouce énergique, se barbouillant le nez de tabac.
Parfois ils jardinaient ensemble. Et tout en repiquant les choux ou en sarclant les carottes, le bon curé, mêlant l'agréable à l'utile selon le précepte d'Horace, lui faisait réciter des vers tirés des « Géorgiques » et en rapport avec ces rustiques travaux:
« Prima Ceres ferro mortales vertere terram Instituit... »
Ou bien ils s'occupaient des ruches. Et c'était l'occasion de se remémorer les conseils de Virgile, en ces mêmes « Géorgiques », et la gracieuse légende du berger Aristée qui, désespéré de la mort de ses abeilles, implorait la pitié de sa mère, la nymphe Cyrène.
Deux pas plus loin, Jacques se trouvait devant l'église que le curé Firket avait bâtie de ses deniers. La porte était ouverte. Il y entre. Des odeurs d'encens flottaient sous la haute voûte. Au fond du coeur se dressait le beau maître-autel en marbre blanc et noir, don aussi du généreux pasteur. Et, à son fronton, Jacques reconnaît avec émotion les armes de Hubert Firket, les trois chênes et le chevreuil.
Sans doute il est enterré là, au pied de l'autel, comme il en exprimait le désir dans le testament que Jacques se souvenait lui avoir vu rédiger. En effet, dans le choeur, une inscription sur une pierre tombale rappelle que le curé Firket, mort en septembre 1739, repose en cet endroit. Jacques tomba à genoux sur la dalle et y pria longuement.
Quand il se releva et sortit de l'église, le soleil était déjà haut à l'horizon. Il comptait aller reprendre son cheval et regagner Liège. Mais voici qu'une force mystérieuse l'oblige encore à changer sa route. Au lieu de redescendre la vallée de la Meuse, il suit le chemin abrupt qui mène au manoir de Chokier. Que va-t'il faire là-haut ? Revoir la perfide Rosine, lui qui n'avait pas même voulu s'informer de son existence ? Il ne cherche pas à démêler l'écheveau de ses pensées. Mais il monte machinalement, il monte comme poussé par le destin et ne s'arrête que devant le château dont la cour, entourée de trois côtés par des bâtiments, est séparée du chemin par une grille.
La porte du vestibule est ouverte. Et soudain une voix claire et vibrante s'élève. Une femme chante en s'accompagnant sur un clavecin. Une violente émotion saisit Jacques. Il croit reconnaître la voix. Il entend l'air de Lulli dont les paroles le hantaient tantôt:
«. Ah ! pourquoi nous séparez-vous ?
Eh ! du moins attendez que la mort nous sépare. »
Une servante traverse la cour. Elle est courbée et son visage se plisse de rides; cependant Jacques n'a pas de peine à reconnaître Garite, la fidèle nourrice de son ancienne fiancée.
La vieille disparaît sous le linteau d'une porte, mais revient bientôt, et, d'une voix forte encore, elle crie « Rosine ! » Jacques tremble de la tête au pieds. Son coeur bat à se rompre. La voix qui chantait se tait. On entend un bruit de clavecin qu'on ferme.
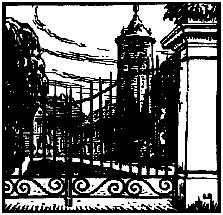
Qui va-t'il voir surgir dans l'embrasure de la porte ? Sa Rosine sans doute, vieillie elle aussi, défigurée peut-être par les épreuves et les chagrins.
Un femme apparaît sur le seuil. Mais quel est ce prodige ? Jacques aurait-il une hallucination ? Oui, c'est Rosine, mais Rosine telle exactement qu'il se la rappelle, dans toute la fraîcheur de son aurore, dans tout l'éclat de ses vingt ans.
Belle de la beauté de Vénus immortelle.
Jacques pousse un grand cri. Il chancelle, tente en vain de s'accrocher aux lances de la grille et tombe comme une masse sur le sol.
Jacques se retrouvait couché dans une salle du château. De son lit, par la fenêtre, il apercevait la Meuse. Il reconnaissait, sur l'autre rive, la tour ronde du manoir de Ramet et le grand bois dont se couronne la colline ou s'adosse ce village. Combien de temps était-il resté en état d'inconscience ? Plusieurs jours sans doute. Il se souvenait seulement comme d'un long rêve où deux personnes repassaient sans cesse, la vieille Garite et Rosine, la belle et jeune Rosine de l'apparition.
Bientôt d'ailleurs tout le mystère s'expliqua. L'ancienne fiancée de Jacques était morte depuis un an, laissant une fille unique, son vivant portrait. Et de la bouche de la vieille Garite, Jacques apprit peu à peu toute la triste histoire de la mère. Poussée par des parents avides d'un riche mariage, elle avait eu la faiblesse d'accepter le seigneur de Chokier. Mais elle n'avait guère tardé à se repentir amèrement de sa faute. Souvent elle avait répété à sa fidèle Garite: « Ah, si j'était certaine que Jacques ne m'aime plus, qu'il m'a tout-à-fait oubliée, qu'il a rencontré auprès d'une autre plus digne de lui le bonheur que méritait si bien son coeur loyal, alors je me consolerais. Mais non, un instinct me le dit. Peut-être se sera-t'il efforcé de me haïr. Mais, jamais, malgré tout, jamais il n'aura cessé de m'aimer. »
Garite ajoutait: « Que de fois elle contempla de cette fenêtre le chemin que vous aviez pris en vous éloignant à jamais d'elle. Que de fois aussi ses yeux se baignèrent de larmes à la torturante pensée que vous étiez peut être étendu sur un champ de bataille, blessé, mourant, sans personne pour vous secourir et appelant vainement Rosine. » Et elle avait fait promettre à sa fille, si un jour elle rencontrait Jacques et s'il était en son pouvoir de faire quelque chose pour lui, de ne pas y manquer.
Les semaines s'écoulaient et Jacques s'attardait au château, retenu comme par un charme dont il ne pouvait briser le cercle magique. Il sentait avec effroi l'amour s'insinuer dans son coeur. Comment d'ailleurs s'en défendre devant cette jeune fille, frappante image de cette autre qu'il avait si intensément aimée ? Et Rosine s'occupait dé lui avec une bienveillance si tendre. Elle ne se lassait pas de lui faire raconter ses campagnes, et ses yeux presque extasiés disaient assez l'intérêt qu'elle prenait à ses récits. Mais comment lui, officier sans fortune et quadragénaire, s'enhardirait-il à déclarer son amour à cette jeune fille, riche et toute rayonnante de beauté ? Mieux valait se taire, et s'épargner l'humiliation d'un refus. Mieux valait partir avec une nouvelle blessure au coeur, et aller se faire tuer au service de l'Autriche, dans les sables du Brandebourg ou dans les marais du Danube. Jacques prit la résolution de s'en aller, et il l'annonça à Rosine.
La veille du départ, ils étaient assis sur un banc à la terrasse du château. Leurs propos embarrassés s'entrecoupaient de longs silences. Et Rosine dit: « En vous en allant, Monsieur Jacques, vous me laissez un cuisant regret, celui de ne pas avoir payé la dette sacrée de ma mère, de n'avoir pu en rien contribuer à votre bonheur ». Et Jacques de répondre: « Cette dette, vous me l'avez amplement payée, Rosine. Vous m'avez rendu la santé du corps et la paix de l'âme. Et j'ai appris que votre mère ne m'a jamais oublié, qu'elle est morte, mon nom sur les lèvres. Cette certitude suffira pour embaumer le reste de ma vie, pour me faire un jour accepter avec joie la mort qui nous réunira. »
Mais alors Rosine eut un cri dont la force le surprit: « Monsieur Jacques, dit-elle, ne partez pas encore. » Il la regarde. Dans ses grands yeux émus, il croit lire une invite. Il n'ose toutefois. Lui qui fonçait avec tant d'audace sur les terribles grenadiers de Frédéric II, il se sent faible et tremblant devant cette jeune fille. Il n'ose, le lieutenant-colonel aux dragons de Ligne. Mais sans doute, dans ses regards, Rosine a compris la passion réprimée, les désirs refoulés.
L'heure était solennelle et douce. Du côté de Ramet, les derniers rayons du soleil enflammaient les vitres des maisons. La brise apportait les senteurs mêlées des foins coupés, des chèvrefeuilles en fleurs, des roses épanouies. Dans le bosquet voisin, une fauvette prolongeait son chant d'ivresse. C'était un de ces rares moments où la nature semble se rapprocher de l'homme, l'inviter maternellement à ouvrir son coeur à la confiance infinie et aux espoirs dorés. On se sent frôlé par l'aile du bonheur qui passe; oui, qui passe, et peut-être, si on ne se hâte de l'arrêter, va s'envoler pour ne revenir jamais.
Entre ses longs doigts graciles, Rosine saisit la rude main guerrière de Jacques, et, les yeux baissés, mais à peine rougissante, et d'une voix claire et décidée: « Voulez-vous de moi pour femme, Monsieur Jacques ? » dit-elle.
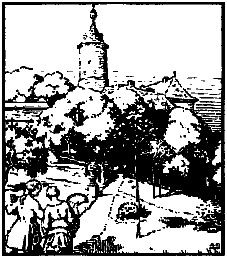
Deux mois plus tard le village de Chokier était en liesse. Sous un chaud soleil d'août un cortège nuptial descendait du manoir. Les cloches de l'église sonnaient la joie. Et devant l'autel au pied duquel dormait le bon curé Firket, dont l'âme, dans le ciel, devait tressaillir d'allégresse, Rosine, la belle châtelaine de Chokier, était unie à Jacques de Berloz, lieutenant-colonel aux dragons de Ligne.
Albert DESSART
|



