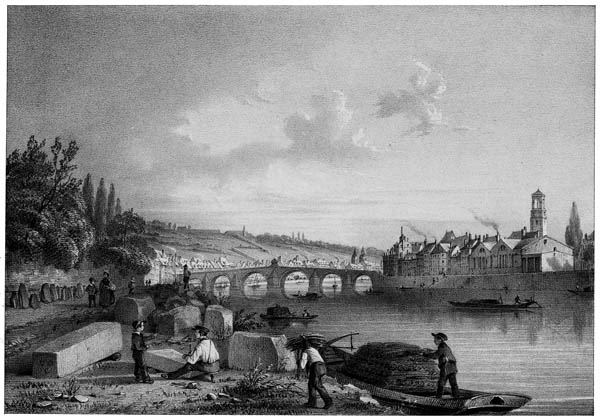
Le pont des arches à Liège
Le gouvernement a repris l'administration de la Meuse le 1er janvier 1840,
Il a voulu que cette reprise fût précédée d'un rapport général sur la situation de cette rivière.
C'est ce rapport que nous publions ci-après.
Au 1 janvier 1840, il y a eu précisément vingt ans que l'État avait cessé d'administrer la Meuse.
La loi fondamentale de 1815, avait consacré un chapitre spécial à la direction des eaux, ponts et chaussées; elle portait
Art. 218: « Si parmi les ouvrages... , il s'en trouve dont la direction peut être confiée aux États des provinces, soit à cause d'un intérêt moins général, soit pour raison d'utilité ou de convenance tirée de la chose même, elle leur est attribuée, soit exclusivement, soit concurremment avec la direction générale.
Art 219. Le roi, après avoir entendu les États des provinces, et sur l'avis du conseil d'État, détermine quels travaux sont remis sous la direction des États et fixe en même temps le mode de pourvoir aux frais de leur entretien.»
C'est en vertu de ces dispositions qu'un arrêté royal du 17 décembre 1819 avait confié l'administration de la Meuse aux trois provinces que cette rivière traverse.
Cet acte n'emportait pas cession; le gouvernement s'était réservé la faculté de reprendre l'administration de cette rivière, s'il le jugeait convenable (§ 3 de l'art. 1er). Le principe du code civil qui déclare les rivières navigables dépendances du domaine public (art. 538), était donc resté intact.
En proposant, en novembre 1838, des allocations pour des travaux à faire, dans le cours de 1839 à l'Escaut, la Lys et la Meuse, le gouvernement crut devoir y mettre pour condition la reprise de ces rivières, à partir du 1er janvier 1840, l'année 1839 étant nécessaire à la transition administrative.
Les Chambres se sont associées à cette pensée: les rivières navigables ont ainsi repris un caractère national. (Loi du 31 décembre 1838.)
Il y a plus:
L'Escaut et la Meuse ne sont pas seulement du domaine public, quant à la Belgique; ce sont des rivières du domaine européen, en quelque sorte. Comme le Rhin, l'Escaut et la Meuse font l'objet des traités de 1815. (Annexe XVI de. l'acte général du Congrès de Vienne.) L'art. 5 des dispositions spécialement relatives à la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, porte: « Les États riverains des rivières spécifiées (ci-dessus) se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la manière que cela a été arrêté à l'art. 7 pour le Rhin. » La disposition qu'on rappelle est conçue en ces termes: « Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle â la navigation. » L'État belge doit donc aux nations étrangères la garantie d'une bonne administration de l'Escaut et de la Meuse. Cette garantie existait-elle sous le régime de l'arrêté de 1819, et jusqu'à quel point le gouvernement précédent avait-il pu charger les provinces des obligations que le droit des gens impose à chaque État riverain?
Le rapport que nous publions n'est, en quelque sorte, que l'introduction à l'étude d'art, qui reste à faire.
Bruxelles, le 5 février 1840.
ARRÊTE MINISTÉRIEL DU 11 AOUT 1839.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
Vu la loi du 31 décembre 1838, d'après laquelle l'État doit reprendre, à partir du 1er janvier 1840, l'administration de la Meuse;
Considérant qu'il importe que cette reprise soit précédée d'un rapport général sur la situation de cette rivière,
ARRETE:
Le sieur Guillery, ingénieur de 2e classe au corps des ponts et chaussées, est chargé d'une étude générale de la Meuse; le rapport qu'il nous adressera, comprendra deux parties principales:
La 1re consacrée à la description de la rivière (sa situation, tant en Belgique qu'en France et en Hollande, les améliorations projetées ou effectuées, etc.);
La 2ème partie consacrée à l'administration et à la navigation (règlements, tarifs, mouvement de la navigation, objets transportés, etc.).
Il annexera à ce rapport, pour la rédaction duquel il se mettra en relation, tant avec MM. les gouverneurs qu'avec MM. les ingénieurs en chef des trois provinces, les textes des règlements, tableaux et autres pièces.
Les services provinciaux continueront à subsister, ainsi que les services spéciaux à Liège.
Expédition du présent arrêté sera adressée à MM. les gouverneurs des provinces de Limbourg, de Liège et de Namur, à M. l'inspecteur-général des ponts et chaussées, à M. l'inspecteur Vifquain et à M. l'ingénieur Guillery.
Bruxelles, le 11 août 1839.
NOTHOMB.
|
TEXTE DU RAPPORT DU 23 DÉCEMBRE 1839.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Conformément à la loi du 31 décembre 1838, l'État doit, à partir du 1er janvier 1840, reprendre l'administration de la Meuse, et vous avez jugé qu'il fallait que cette reprise fût précédée d'un rapport général sur la situation du fleuve. Chargé de ce travail par votre arrêté du 11 août dernier, je me suis appliqué à répondre à vos vues en relevant minutieusement les faits, quant au fleuve en lui-même, aux travaux exécutés ou conçus, aux péages imposés à différentes époques, en un mot eu égard à tout ce qui semble devoir donner une idée exacte des facilités ou des entraves qu'a successivement rencontrées la navigation. Je vais tâcher, Monsieur le Ministre, de resserrer en peu de pages ceux de ces faits qui constituent par leur ensemble l'état actuel d'une voie de communication du plus grand intérêt pour trois provinces et pour le pays tout entier.
DESCRIPTION DE LA MEUSE.
La Meuse prend sa source dans le département de la Haute-Marne, à sept lieues de Langres et à une lieue de Montigny; son élévation au-dessus du niveau de la mer est de 456 mètres. Formée de deux ruisseaux qui, coulant à travers les vallées de Récourt et d'Avrécourt, joignent leurs eaux à Fort-Fillières, elle ne prend son nom qu'auprès du village de Meuse, et ne commence à être navigable qu'à Verdun, après avoir reçu divers affluents, le Mouzon à Neufchàteau (1), le Vair au-dessus de Vaucouleurs, le Deuil au-dessous, et le Méholle à Void. Jusque-là, dans un espace de 175,000 mètres, le manque d'eau s'oppose à une navigation régulière: de nombreuses usines en détournent abondamment pour leur usage; aux environs de Neufchâteau, à Bazoilles, elle se perd et disparait durant près de six mois de l'année, par les infiltrations du sol, pour ne se remontrer qu'à Noncourt, à une lieue et demie plus loin; et de Domremy à Verdun, elle s'éparpille, pour ainsi dire, par la multiplicité-des bras et des sinuosités de son cours. Les gués et Ies pertuis naturels offrent des chutes où souvent les bateaux se brisent à la descente, et qui rendent la remonte impossible. La largeur du fleuve est, dans cet espace, de 25 à 50 mètres, selon les lieux. Sa pente générale, qui est de 0,00151674 m, sort des limites dans lesquelles un cours d'eau est navigable.
Une partie si défectueuse, si impropre à la navigation, devait donner lieu à plus d'un projet.
Le plus ancien parait être celui du Maréchal de Vauban, qui regardait comme facile de réunir la Meuse à la Moselle, par un canal de Pagny à Toul (2).
En 1720, De Bavilliers, ingénieur, proposa sa jonction à la Saône par le Vair; mais cette proposition ne fut point accueillie.
En 1738, un sieur Bresson demanda la même jonction, en partant d'un point encore plus élevé, de Neufchâteau par le Mouzon, et ne fut pas plus heureux.
En 1751, le roi Stanislas, malgré le crédit dont il jouissait à la cour de Louis XV, échoua dans ce même projet, par les intrigues d'une corporation puissante qui en fit suspendre l'exécution.
En 1783, dans un ensemble de propositions très vastes, relatives à la Meuse, se trouvait comprise sa canalisation depuis Verdun jusqu'au confluent du Vair.
Enfin, aujourd'hui encore, l'administration des ponts et chaussées prépare des études dans le but de joindre le bassin de la Meuse à celui du Rhone, au moyen d'une canalisation depuis Verdun jusqu'au village de Pagny et au delà.
A Verdun, où le volume d'eau est d'environ 16 mètres cubes, la Meuse porte déjà des bateaux de 45 mètres de long sur 5m,50 de large, ayant un tirant d'eau de 1m,20. En amont de cette ville, on ne rencontre que de petits bateaux connus sous le nom de bateaux de Verdun. De plus grands descendent parfois quand les eaux sont hautes, mais ils ne remontent jamais. Un pont, des murs d'eau, un port, quelques ouvrages d'entretien, quelques revêtements sur les rives, indiquent déjà l'importance que prend le fleuve et l'attention protectrice que, dés ce point, mérite le batelage.
Ce n'est toutefois qu'à Sedan qu'une véritable navigation s'établit; le eaux de la Meuse, grossies par celles du Chiers, ont un volume d'environ 0 mètres cubes (3), et les conditions de leur cours sont dès-lors à peu près les mêmes qu'en Belgique. Depuis Verdun, dans un parcours de 68,000 mètres, aucun genre d'amélioration n'a été réalisé ni même projeté; mais à Sedan, il existe un canal passant par les fossés de la place et qui a pour effet de couper un coude long et dangereux. Projeté en 1788, commencé en 1789, bientôt interrompu par les événements politiques, ce canal, qui a 577 mètres de long, a été repris en 1806 et achevé en 1810. Une écluse, placée à son extrémité d'aval rachète une chute de 1m41; à l'extrémité d'amont est une porte de garde (4).
A partir de cette ville, la Meuse devient d'une importance extrême pour nos relations commerciales.
En la quittant, elle passe successivement à Donchery, au-dessous duquel elle reçoit le Bar et le canal des Ardennes, qui la réunit à l'Aisne, et par l'Aisne à l'Oise et à la Seine (5); à Mézières, au confluent du Vence, un peu au-dessus de celui du Sermonne; à Charleville; à Monthermé, au confluent de la Semoy; à Revin; à Fumay, un peu avant de recevoir le Viroin; à Han et à Givet, où la Blanche, en amont de la ville, l'Heuille, dans la ville même, viennent y jeter leurs eaux. A près de 3,000 mètres au-dessous de Givet, le ruisseau de Jaspe forme la séparation de la France et de la Belgique.
De Sedan au pont de Jaspe, le développement de la Meuse est de 141,000 m.; sa largeur est de 60 à 100 mètres, et sa pente générale de 0m,00039.
Les difficultés de son cours dans cette longue étendue devaient provoquer des projets d'amélioration, et quoiqu'il y en ait eu, on peut s'étonner qu'il y en ait eu si peu.
En 1783, il en parut un qui indiquait les perfectionnements réclamés par la navigation depuis Verdun jusqu'à Givet; mais il n'eut aucune suite.
II en fut de même d'un mémoire publié en 1794, par M. Lecreulx, officier du génie, et ce n'est que dans ces dernières années qu'on a songé sérieusement à mettre la main à l'oeuvre; mais aussi les études profondes qui ont été faites viennent d'être couronnées d'un plein succès par l'adoption du projet des ingénieurs des ponts et chaussées. Au moyen des travaux actuellement même en voie d'exécution, une navigation permanente est désormais assurée jusqu'à notre frontière, tandis que précédemment, périlleuse en toute saison, elle était à peu près interrompue dans les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre.
Une loi de 1837 affecte 7,500,000 Fr. à ces travaux, dont le but est d'abréger le temps et les frais de la navigation, de la rendre praticable à l'époque des plus basses eaux, et de faire disparaitre les dangers auxquels elle était exposée en tout temps. On y est parvenu par des dérivations, par des barrages, par des chenaux avec digues submersibles, et en enlevant du fond de la rivière les roches qui gênaient toujours la marche des bateaux et quelquefois les brisaient.
Ainsi, une dérivation à Villette, en aval de Sedan, par une longueur de 1,700 mètres, remplace un détour de 8,000 mètres; celle de Mézières, confiée au génie militaire de la place, supprime par 600 mètres un détour de 6,000 mètres; celle de Revin, de 560 mètres, dont 213 mètres en canal souterrain creusé dans le roc, rachète 5,000 mètres de détour; d'autres dérivations, celles de Mont-Cy, de Dame-de-Meuse et de St-Joseph, ont surtout pour effet de suppléer à un mauvais fond, et celle de Han, en amont de Givet, la plus considérable de toutes, a 2,000 mètres, avec souterrain de 500 mètres dans le roc.
Les quatre dérivations de Villette, de Mézières, de Revin et de Han, suppriment à elles seules 30,000 mètres de détours.
Les chenaux, en rétrécissant le cours du fleuve, maintiennent les eaux à une plus grande hauteur. Tels sont ceux de Dom-le-Mesnil, de Monthermé et de St-Louis, en aval de Monthermé. Ils sont tous calculés pour qu'il y ait constamment et partout 1 mètre d'eau à l'étiage, avec une vitesse de 1 mètre par seconde.
Les frais sont également atténués par la diminution du développement de la ligne navigable. Les deux coupures de Donchery et de Mézières suppriment 3 fr. de péage par bateau.
Par suite des améliorations effectuées dans ce parcours d'environ 29 lieues de 5,000 mètres, le chemin de halage est tenu partout à 3 mètres ou 3m,50 au-dessus des basses eaux, et sa largeur, de 4 mètres en déblai, est de 5 mètres en remblai. Sa conservation est garantie par de forts pérés, d'une construction solide et à l'épreuve des eaux. Tels sont ceux de Monthermé, d'Haibes, en aval de Fumay, et autres déjà faits ou dont l'exécution est décidée sur tout le cours du fleuve.
Jusqu'à ces derniers temps, les ouvrages sur la Haute-Meuse se bornaient aux ponts, aux quais, aux ports de Mézières, de Charleville et de Givet, et à quelques pérés pour soutenir le chemin de halage. Il y a deux ans à peine qu'un pont suspendu, en fer, a été construit à Monthermé, aux frais de la commune, et c'est seulement depuis les grands travaux entrepris par l'État, que d'autres communes montrent le désir de remplacer leurs bacs par des passerelles.
Entrée en Belgique au pont de Jaspe, commune d'Agimont, la Meuse reçoit l'Hermeton auprès d'Hastières-Lavaux; la Lesse, au pont St-Jean à Anseremme, en amont de Dinant, qu'elle laisse sur sa rive droite; le Molignée, à Warnant; le Burnot, à Rivière; le Bocq, à Yvoir, et la Sambre à Namur, qu'elle laisse sur sa rive gauche. Dans cette longueur de 49,000 mètres, la largeur varie de 80 à 120 mètres, la vitesse moyenne est de 0m,75, et la pente générale de 0m,00031.
A partir du pont de Jaspe, on ne trouve plus aucune trace de travaux d'amélioration, et, à compter de cette limite, le fleuve est encore ce que naguère il était en France, d'un parcours très difficile pour les bateaux de grande dimension. Un pont (6), des murs de quai, deux ports à Dinant; un port en amont de cette ville, à Froidvau; le pont (7), les quais, le port, à Namur; le port à Jambe, en aval de cette dernière ville; des pérés et des réparations partielles au chemin de halage: tels sont les ouvrages dus au zèle de la province et des communes. Leurs ressources ne leur ont pas permis de faire plus; aussi la navigation éprouve-t-elle de graves contrariétés dans cette partie de la Meuse. A la vérité, elle n'y est jamais entièrement interrompue, mais pendant quatre mois, très souvent pendant cinq, en juin, juillet, août, septembre et octobre, elle a de nombreux obstacles à surmonter et de longs retards à subir, de Givet à Dinant et de Dinant à Namur, où le manque d'eau met à nu les barrages naturels de gravier ou de roc, et multiplie les gués et les courants. Il y a presque nécessité, à cette époque de l'année, de renoncer à l'usage des grands bateaux, qui ne naviguent plus alors que très péniblement, même avec de faibles charges, et de recourir à l'emploi de petits bateaux plats, d'une construction légère, insuffisants pour les besoins du commerce. C'est malheureusement au nôtre que cet état de choses est le plus préjudiciable, c'est à nos diverses exploitations, à notre batelage, qu'il se fait le plus rigoureusement sentir, et les entraves sont pour nous d'autant plus défavorables, que les quatre cinquièmes des transports entre Givet et Namur, se font en remonte.
La Meuse, en Belgique comme en France, à cause de sa pente inégalement répartie, se compose de biefs ou bassins dans lesquels l'eau, souvent très profonde, présente à la navigation une grande facilité, et de barres en gravier ou en roc, à peine recouvertes d'un courant rapide. Ainsi, en face des premières maisons d'Agimont, au-dessous du pont de Jaspe, le chenal navigable est d'une assez bonne profondeur; mais il n'a guère que la largeur de deux bateaux, et, à la première île, il devient périlleux par les pierres dont il est encombré, après s'être élargi jusqu'à l'île d'Hermeton, il se resserre entre deux bancs de gravier, où il augmente de vitesse, puis s'ouvre davantage jusqu'à la seconde île, en aval de laquelle le gravier vient de nouveau le rétrécir. Au-dessous du confluent de l'Hermeton, est encore un courant assez fort, où les bateliers, dans des temps déjà anciens, ont construit un barrage isolé qui ne maintient l'eau que très imparfaitement, il est vrai, mais à l'aide duquel il y a néanmoins 0m,80 et 0m,85 de hauteur d'eau dans le chenal navigable. De même, en amont d'Hastières-Lavaux, un faux bras a été barré par un bateau rempli de pierres que les bateliers ont submergé en cet endroit.
A la suite d'un long et beau bief, on arrive au courant de Ranle, en amont de Waulsort; là, le chenal est étroit, mais l'eau est profonde, et c'est surtout aux roches sur lesquelles elle coule qu'est dû le courant. On en rencontre bientôt un autre, vis-à-vis du château de Waulsort; un peu au-dessous, le chenal navigable, creusé sous le gouvernement français à 1 mètre de profondeur, sur une longueur d'environ 500 mètres, s'est conservé jusqu'à cette heure en bon état.
De Waulsort au château de Freyr s'étend un magnifique bassin où l'eau a 4 et 5 mètres, et qui se termine à la pointe de l'île Moniat en un courant rapide causé par les roches dont le fond de la rivière est garni; la hauteur d'eau y est de 1 mètre, 1m,50, 1m,70: il suffirait d'ôter les roches pour avoir 2 mètres et plus.
De là au pont de Dinant l'eau est profonde et abondante. En aval du pont se trouve le plus rapide et le plus mauvais courant, celui de la Tour de Leffe. Un peu plus bas est le courant d'Houx, également très rapide. En aval, le chenal devient profond, mais il est encore rempli de roches, et jusqu'à Poilvache il est étroit et difficile, malgré l'abondance- de l'eau.
En face d'Anhée, un banc de gravier oblige à quitter la rive droite pour n'y revenir qu'à Moulin, quoique le chenal ait d'ailleurs 1m,40 et 1m,70, même en cet endroit. Il se rétrécit à Yvoir, où il forme un coude sur un mauvais fond; et à Fidevoye, au-dessous du confluent du Bocq, il est obstrué par un banc de gravier et de roches. II continue entre le gravier jusqu'au-dessous du château d'Hun, et à Rouillon, où il a de la profondeur, il est séparé de la rive droite par une multitude de roches. Un peu en aval, il est divisé en deux par un banc de gravier; bientôt après, il se reforme et se poursuit avec une bonne profondeur jusqu'en amont de Burnot, au courant de Frappecul, à partir duquel il a de l'eau en abondance.
Au-dessous de Profondeville, on retrouve le gravier en amont de l'île de Tailfer. De ce courant jusque vis-à-vis du château de Fooz, le chenal est profond et assez large, même lorsqu'en aval du château il est partagé et affaibli par une île. Au-dessous de ce point, le lit du fleuve forme un coude qui entame chaque année la rive gauche et contrarie le passage des bateaux. Enfin, en tête de l'île de Wépion, existe un courant de peu d'étendue, à partir duquel on ne rencontre plus, jusqu'au pont de Namur, que le courant de la Plante, qui est du reste un des plus forts.
Aux difficultés de ces courants, dans lesquels la hauteur n'est guère que de 0m,50 à 0m,60 dans les basses eaux, et de 0m,90 à 1m,10 dans les eaux moyennes, se joignent celles qui proviennent de l'état du chemin de. halage; changeant plusieurs fois de rive, obligeant les chevaux à traverser des bras assez larges, souvent éloigné du chenal navigable, toujours trop bas ou trop étroit, quand il n'est pas l'un et l'autre, il est encore à construire dans la plus grande partie de ce parcours.
Le mal date de loin, il est depuis longtemps connu, et de vives plaintes se sont maintes fois fait entendre; il ne parait pas pourtant que l'on se soit mis en peine d'y chercher un remède. Du moins aucun document antérieur à 1826 ne donne à supposer, avant cette époque, l'existence du moindre projet d'amélioration.
En 1826, M. De Puydt eut le dessein de canaliser la rivière dans cette étendue de 49,000 mètres, de la frontière à Namur; des plans et profils des ouvrages furent établis, des devis estimatifs furent dressés, et un avant-projet présenté à l'approbation du gouvernement resta sans effet, peut-être seulement à cause des événements politiques de 1830, en supposant que les stipulations du traité de Vienne eussent permis d'admettre sans restriction un projet qui augmentait sensiblement le péage (8).
Vers le même temps, la compagnie française, concessionnaire du canal des Ardennes, autorisée par le gouvernement français à faire faire des études pour l'amélioration de la navigation jusqu'à nos frontières, offrit au gouvernement des Pays-Bas de se charger du même travail en Belgique. Elle avait compris que son entreprise ne lui serait, que d'un faible avantage, que peut être même elle lui deviendrait onéreuse, si de semblables travaux n'étaient pas continués sur notre territoire, mais ses offres furent rejetées et les améliorations ajournées (9).
La conviction de la compagnie française sera partagée par toutes les personnes au fait de la matière, et le conseil général du département des Ardennes, ignorant encore le projet que vous avez conçu, a, dans sa dernière session, émis le voeu que des arrangements fussent pris, entre la Belgique et la France, pour la continuation des travaux en cours d'exécution de Sedan à Givet.
Cet aspect, si peu encourageant pour la navigation, que présente la Meuse belge jusqu'à Namur, se reproduit encore, à quelques différences près, de Namur à Liège, pendant un cours de 67,000 mètres, durant lequel la largeur est de 100 à 140 mètres, le volume d'eau d'environ 60 mètres cubes, la vitesse moyenne de 0m,40, et la pente générale de 0m,000196.
De Namur, la Meuse passe à Samson, où elle reçoit le ruisseau du même nom; à Huy, où elle reçoit la Méhaigne au-dessus de la ville, et le Hoyoux dans la ville même; de là elle se rend à Liège, où elle reçoit la Liege (lire Légia) à gauche et l'Ourthe à droite, par plusieurs bras (10).
Quoique l'on doive regarder comme des travaux importants même ceux qui se renferment dans l'enceinte et aux abords des villes, qu'un pont (11), un port et des quais à Huy, les quais, les ports en amont et en aval du pont des Arches, à Liège (12), soient d'évidents avantages, les distances entre les villes ont un grand développement et là, il n'y a pas vestige d'un projet d'amélioration.
(12) Le pont des Arches, construit en 1038, sous le règne de l'évêque Réginard, s'est écroulé en 1409; rétabli en 1446, il a été emporté en 1643 par une crue d'eau extraordinaire, dont la hauteur, il y a peu d'années, était encore marquée sur un des piliers de l'église St-Barthélemy, à Liège. Sa reconstruction, commencée le 17 octobre 1648, a été terminée en 1657, et a coûté 315,954 for. 14 sols et 3 liards. Pour subvenir aux frais d'un travail si considérable, il fut établi un impôt de dix liard, par tonne de bière, qui, en très peu de temps, couvrit la dépense. L'architecte se nommait CORNELIS PESSERS.
Les archives de la province de Liège renferment un projet de pont destiné à mettre en communication les villages de Jemeppe et de Seraing. Ce projet, qui n'a pas reçu d'exécution, date des premières années de ce siècle, et est dû à M. POTET, architecte des travaux publics. Il s'agissait d'un pont en bois, qui se composait de 6 piles et de 2 culées, couvertes par un plancher d'environ 12 mètres de large; les travées avaient 34m,60, excepté celles des deux extrémités, de 17m,30 chacune; il y avait deux voies, avec plates-bandes en fer pour recevoir les roues des voitures; deux trottoirs étaient ménagés sur les côtés et garantis par des garde-fous; les piles eussent été en bois ou en pierre le projet laisse le choix et en présente de l'une et de l'autre espèce.
Depuis, un projet de pont en fer a été proposé pour le même endroit, en face des établissements de M. John Cockerill.
Ce passage de la Meuse a toujours été très fréquenté: c'est un des points où les relations entre le Condroz et la Hesbaye sont les plus actives. En 1381, un pont de bois avait été construit à Jemeppe, magna suburbanerum et rusticanorum condrosorum commodo - FOULLON, tom. 1er, pag. 446.
|
Dès le pont de Namur, un peu en aval, est un fort courant, où l'eau n'a pas plus de 0m.50 de profondeur, sur une largeur de 5 à 6 mètres de part et d'autre, le gravier n'est recouvert que de 0m,30 à 0m,35 d'eau. A la suite de quelques courants moins rapides et d'iles qui diminuent la hauteur du chenal navigable, vient le courant de Samson, le plus fort de tout ce parcours, entretenu et augmenté par les attérissements dus au ruisseau qui s'y décharge; puis le courant d'Andenne, et celui d'Andenelle, causé par les piles ruinées d'un pont romain; et, après le beau bassin de 10 à 15 mètres de profondeur, qui remplit l'intervalle du confluent de la Méhaigne au pont de Huy, on arrive successivement au courant en aval de ce même pont; au courant de Loyable, en face d'Ampsin, où le chenal navigable passe de la rive gauche à la rive droite; au courant de Flône, où l'eau n'a pas moins de 1m,40 de profondeur, mais qui, resserré par les attérissements d'un faible ruisseau, est le passage le plus étroit de tout le cours de la Meuse en Belgique; au courant de la Mallieue, étroit aussi, mais profond de 0m,85 à 0m,90; ensuite, par une belle eau, au courant de Chokier, en aval du village, également étroit, également rapide, mais assez profond; enfin au courant du Val-St-Lambert, à partir duquel la navigation ne rencontre plus jusqu'à Liège que de faibles obstacles; mais, comme au delà de Namur, le halage ne se fait qu'avec de grandes difficultés, surtout en remonte, et par les mêmes motifs.
Une société de bateaux à vapeur destinés au transport des voyageurs et des marchandises entre Liège et Namur, s'est formée il y à deux ans; elle a, sans succès, tenté quelques draguages. Cette opération, effectuée dans le dessein d'approfondir le chenal navigable, en enlevant le gravier et en détruisant les barrages naturels, n'a pas empêché le gravier de revenir et les barrages de se reformer aux mêmes endroits; elle a eu, en réalité, pour résultat contraire à celui qu'on voulait obtenir, de faire baisser les eaux dans des passes où leur hauteur était déjà insuffisante, et de rendre ainsi la navigation plus difficile dans les basses eaux.
Ce n'est que dans la traverse même de Liège, en amont et en aval, que l'on parait, même à des époques déjà anciennes, s'être occupé des moyens de faciliter la navigation et de prévenir les inondations presque périodiques qui désolent les deux rives. Sans parler des pilotis, des digues, des pérés et autres ouvrages exécutés et entretenus dans les derniers siècles pour la défense des rives ou pour le halage (13), l'évêque Notger, dès le onzième siècle, pour assainir le quartier d'Outre-Meuse et dessécher les marais à travers lesquels passait la Chaussée-des-Prés, fit faire une importante dérivation. La Meuse, comme quelques-uns le prétendent, passait-elle alors au pont d'Amercoeur? Est-ce son lit actuel qui fut creusé et élargi par Notger? Ou, comme d'autres l'affirment, l'ancien canal d'Avroy était-il lui-même cette dérivation? Les ouvrages et les monuments historiques laissent cette controverse indécise; néanmoins peut-être, à la configuration du terrain, à la composition du sol, qui présente le gravier presque à fleur de terre, peut-on reconnaitre que la direction naturelle du fleuve est de Fragnée par le pied de la Chartreuse; comme d'ailleurs il est constant que le quartier de l'est n'a été délivré des eaux que par la dérivation de Notger, on peut conjecturer que le pont des Arches est sur cette dérivation. Cela expliquerait la multitude de bras par lesquels I'Ourthe se rend aujourd'hui dans la Meuse.
Quoi qu'il en soit, qu'elle qu'ait été l'origine du canal qui, par le quai d'Avroy, la Sauvenière et la rue actuelle de la Régence, se dirigeait des Augustins vers l'extrémité du quai des Jésuites, en aval de l'Université, son existence était aussi favorable à la navigation, que les tournants en amont du pont des Arches lui sont contraires, des constructions successives ayant fait dévier le courant, oblique aujourd'hui à l'axe longitudinal de ce même pont. Des règlements du XVIIe siècle sur les barques de Huy (14), qui partaient alors du pont d'Avroy, les anciens plans de la ville, qui présentent des bateaux à voile sur ce canal, attestent le soin que nos pères mettaient à le conserver et l'entretien dont il était l'objet; car il fallait de fréquents curages, vu le peu de pente des Augustins à l'Université, 0m,26 sur une longueur de 1,800 mètres (15).
(15) Si la navigation de la Meuse est devenue si difficile dans la traverse de Liège, cela tient â ce que, depuis cinquante ans, elle a cessé d'être l'objet des mêmes soins que par le passé. Précédemment le fleuve était maintenu en bon état par des curages, il était entretenu à grands frais, ainsi que les autres rivières du pays de Liège. LOUVREX, tom. III, p. 13,235, etc. - Mandement pour l'entretien des rivières d'Ourthe et de Vesdre, ainsi que pour la construction et l'entretien du chemin de halage. Ibid., tom. III, pag. 235. Edit du 28 mai 1725, par lequel il est défendu de laisser des bois sur le rivage d'Avroy, attendu que ce bois amasse des fanges et graviers contribuant à remplir le canal qui conduit de l'eau au quartier de l'ile. Ibid., tom. III, pag. 18. - Le 14 juin 1658, dans un règlement sur la rivière d'Ourthe, il est défendu d'en gâter le cours; ordre est donné d'ôter les irigus et autres immondices qui pourraient nuire à la navigation, et de nettoyer la rivière. Ibid. - Mandement sur les rivières de Demer, Stymer, Beeck et autres. Ibid. - Règlement de 1659 et de 1705 sur la police de la ville de Liège. Ibid., tom. III, pag. 8 et suiv.
La négligence a eu de funestes suites: le canal d'Avroy ne s'est comblé peu à peu que parce que les attérissements en amont du pont des Arches, en diminuant une pente déjà très faible, ont rendu tout écoulement impossible, et ces attérissements sont eux-mêmes causés par le défaut de curage, et aussi par les emprises pour l'université, qui ont rejeté le courant sur la rive droite, obliquement au pont des Arches.
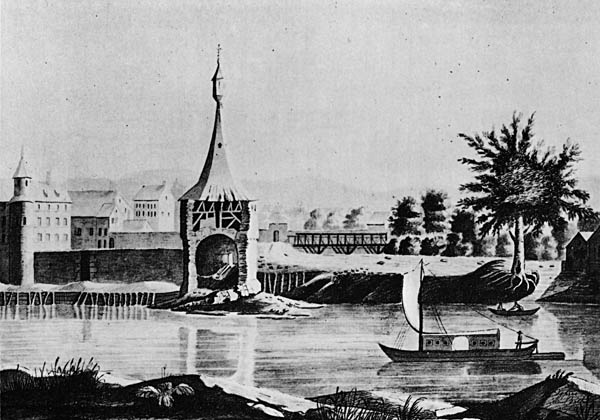
1819 - Bethune - La tour en Beche emportée par les pluies.
La Meuse en cet endroit, refoulée sur la Tour en Bêche par les construction, de sa rive gauche, qui forment un véritable épi, ne ressemble plus guère à ce qu'elle était quand elle s'étendait jusqu'à la rue du Merry, qu'un de ses bras allait se jeter au-dessus du pont des Jésuite., qu'elle battait le derrière des maisons de la rue Sur-Meuse, la rue Sur-Meuse-à l'eau n'étant qu'un chemin de halage, fait à l'époque de la reconstruction du pont des Arches. Aussi a-t-il fallu, en 1446, changer la direction qu'avait l'axe du pont de 1038; du prolongement de la Chaussée-des-Prés jusqu'à la rue du Pont, il a été dirigé du même point de la rive droite vers la rue Neuvice; en 1648, sur la rue Neuvice même, et aujourd'hui la culée de la rive gauche devrait être reportée encore plus en amont.
|
Sous le gouvernement français, on avait eu l'intention de corriger ce défaut de pente, source de frais continuels et d'interruption dans le passage des bateaux. A cet effet, les ingénieurs du département de l'Ourthe avaient présenté un projet d'amélioration qui consistait, d'une part, dans un redressement du coude des Augustins, à partir d'un point au-dessous de la chapelle du Paradis, avec chemin de halage le long des maisons derrière St-Jacques jusqu'au rivage des Croisiers, et, d'autre part, dans un prolongement du canal; l'eau qui l'aurait alimenté eût donné le moyen de transformer la promenade d'Avroy en un vaste bassin offrant une gare des plus sûres et des plus utiles, dont le manque est une privation coûteuse pour le batelage. On doit regretter que les événements de 1814 aient mis à néant un travail qui eût été pour Liège un bienfait inappréciable, et pour la navigation un avantage qu'elle ne peut plus se promettre.
C'est maintenant dans cet ancien bras de la rivière, trop longtemps négligé, que viennent dégorger les immondices de plusieurs égouts de la ville, et leur séjour sans écoulement y occasionne des exhalaisons pestilentielles, cause des plus vives plaintes. Pour remédier à un inconvénient si grave, le conseil communal fit, en 1828, un appel au savoir des gens de l'art connaissant les localités; mais de neuf projets d'amélioration qui lui furent remis, aucun ne parut susceptible de conduire aux résultats désirés. Alors le canal était couvert sur la place de la Comédie, il l'était aussi dans la rue de la Régence, et l'on ne pouvait plus chercher qu'à obtenir une chasse d'eau qui en permît le curage. Toute grande et importante amélioration était devenue impraticable.
En 1829, M. Beaulieu, architecte de la ville, avait conçu l'idée d'une belle dérivation, par suite de laquelle le lit actuel de la Meuse, rétréci depuis le quai d'Avroy jusqu'au bout du quai St-Léonard, devenait un immense bassin, un port des plus faciles pour le commerce, et un excellent abri pour les bateaux. Liège eût été par là un centre commercial beaucoup plus important encore qu'elle ne peut l'être dans d'autres conditions. Cette dérivation commençait à 330 mètres environ au-dessus de la chapelle du Paradis, elle se poursuivait en ligne droite par le pont d'Amercoeur, et venait aboutir en aval de la fonderie de canons. La dépense, qui montait approximativement à fl. 600,000 des Pays-Bas, serait bien plus considérable aujourd'hui, que des constructions nouvelles et dispendieuses occupent le terrain que la dérivation devait parcourir.
Ce projet doit sa naissance aux recherches demandées pour l'assainissement du canal de la Sauvenière (16); beaucoup d'autres projets l'ont précédé et suivi dans l'intervalle de peu d'années.
| (16) La rive gauche du canal d'Avroy, a été changée en promenade publique sous l'administration du baron Micoud, préfet de l'Ourthe, qui fit construire le quai de la Sauvenière.
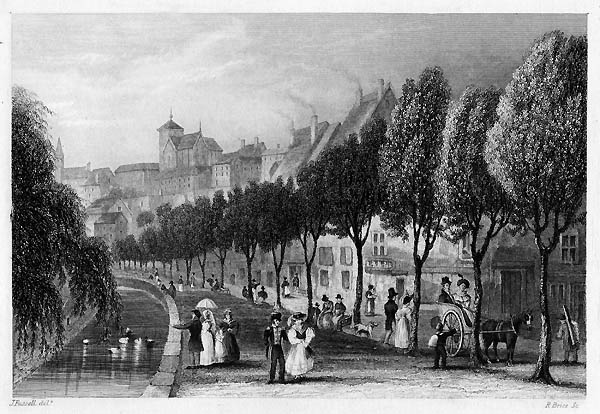
Le pont des Jésuites, jeté sur son extrémité d'aval, datait de l'an 1596: il a été démoli en 1827. Le pont d'Avroy, qui joignait les quartiers du centre avec le faubourg St-Gilles, a été détruit aussi dans ces dernières années.
|
En 1826, des discussions s'élevèrent dans le sein du conseil communal de Liège, relativement aux plaintes des bateliers sur les difficultés du halage depuis les Augustins jusqu'à Cheravoye; on décida dès-lors la construction d'un chemin de halage de 10 mètres de largeur; mais, d'année en année, cette décision se modifia. Bientôt on voulut un quai qui fût en même temps chemin de halage et promenade publique ouverte à la fois aux piétons et aux voitures; puis, en 1836, on imagina de prolonger au delà des Augustins le quai que l'on avait projeté, de manière à opérer un redressement du coude que fait la rivière en cet endroit. C'était à peu près revenir, sauf une gare, au projet précédemment proposé par les ingénieurs français. Les travaux reçurent même un commencement d'exécution; mais les réclamations spécieuses, quoique peut-être peu fondées, auxquelles ils donnèrent lieu, les firent presque aussitôt suspendre, et, à cette occasion, divers projets furent soumis au conseil communal et au gouvernement, tous ayant pour but une dérivation de la Meuse, de la chapelle du Paradis au nouveau pont actuellement en démolition. Ces projets datent de 1837; présentés par MM. Chevron, Franck, Renoz et Van Keerberghen, ils ont passé sous les yeux du conseil des ponts et chaussées, juge compétent des mérites particuliers à chacun d'eux.
Le pont des Arches a été longtemps le seul qui joignit les deux parties de la ville séparées par la Meuse; cependant le quartier de l'est s'étant agrandi, des usines de tout genre s'y étant formées, il a fallu penser à rendre plus faciles des communications devenues plus fréquentes, et le passage d'eau de la Boverie a été remplacé par un pont dont le projet remonte à une douzaine d'années. Il avait d'abord été question d'un pont en fer; mais en 1834 un pont en pierre a été préféré et définitivement adopté. Il est fâcheux que la mauvaise qualité des matériaux et les vices de construction aient obligé le gouvernement à en ordonner la démolition, au moment même où le passage venait d'en être ouvert au public. Sa reconstruction, décidée en principe, doit commencer incessamment (17).
Le chemin de fer a nécessité aussi l'établissement d'un pont à Fragnée. Les grandes dimensions de cet ouvrage vraiment monumental ont permis d'y tracer trois voies, une pour recevoir les rails, une seconde pour les voitures ordinaires, et la troisième pour les piétons (18).
Au nombre des projets en rapport avec la Meuse, également importants pour la navigation intérieure et les relations avec le dehors, il faut compter celui de la société du Luxembourg, entrepris en 1828, et destiné à joindre la Meuse à la Moselle, par un canal de Liège à Trèves. Ce bel ouvrage, suspendu par la révolution, n'a point encore été repris (19).
En aval de Liège, et jusqu'à Venloo, la Meuse retrouve ses allures naturelles, l'art ne les a presqu'en rien altérées, et la navigation, dans cette partie du fleuve, éprouve ou les mêmes obstacles que dans la partie supérieure de son cours, ou des obstacles analogues, et, de plus, elle est astreinte à de longs circuits, par suite des empiétements perpétuels du fleuve sur ses rives, bien différentes ici de ce qu'elles sont plus haut; élevées depuis Charleville, bornées par des collines escarpées et resserrées jusqu'au-dessous d'Argenteau, elles s'abaissent dans le Limbourg. La vallée, qui s'élargit à Tilleur, et de plus en plus jusqu'à Liège, se resserre de nouveau à Jupille, et s'ouvrant une dernière fois à Wandre, elle se change peu après en une vaste plaine, où la Meuse étend son cours sinueux et des plus irréguliers jusqu'à Venloo.
Au-dessous de Visé (20), elle reçoit la Berwinne, en aval de laquelle la rive droite appartient à la Hollande; elle traverse Maestricht, dont le rayon stratégique, de 2,400 mètres, enclave une partie de sa rive gauche; dans la ville, où elle passe sous un beau pont composé de neuf arches (21), elle reçoit le Jaer, et c'est de Maestricht que part le canal de Bois-le-Duc. Au-dessous de cette ville, son volume d'eau est de 75 mètres cubes, et sa vitesse moyenne de 0m,35. De là, elle se rend à Maeseyck, devient, un peu plus bas, à Kessenich, hollandaise par ses deux rives, et passe à Stevenswert, à Ruremonde, à Venloo, à Gennep, à Grave; puis elle se réunit au Wahal au fort St-André (22), à l'est de l'île de Bommel, le quitte pour former cette île, passe à Heusden, où se détache à gauche le bras appelé Vieille-Meuse, et rejoint le Vahal à droite à l'ouest de l'île. Enfin, prenant le nom de Merwe depuis Gorcum jusqu'à Dordrecht, elle passe à Rotterdam, où elle a plus d'une demi-lieue de large, et se jette dans la mer du Nord à la Brielle. Ses affluents, depuis Maestricht jusqu'à son embouchure, sont la Geule, la Gelen, l'Ittervoord, la Roer, le Swalm, le Niera et l'Aa (23).
De Liége à Eysden, au point où la rive droite devient hollandaise, la distance est d'environ 19,000 mètres, et la pente générale de 0m,00038.
De ce point à Venloo, sur une distance de 105,000 mètres, la pente générale est de 0m,00035.
Dans son cours de Liège à cette dernière ville, la Meuse demande de grands travaux d'amélioration et d'entretien. Son fond de sable et de gravier, des plus fermes jusque vers Maestricht, se mêle plus bas et de terre et de vase, et les hautes eaux viennent tous les ans changer sa direction première. Déjà en 1818 et en 1825, le gouvernement avait appelé à son aide les lumières d'hommes spéciaux, et en 1837, M. de Sermoise, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a fait un travail complet sur les moyens de régulariser le cours du fleuve et de préserver ses rives dans toute l'étendue de la province de Limbourg. Il énumère les causes qui le font dévier de sa route, qui donnent lieu à l'ouverture d'un grand nombre de faux bras, et indique les endroits à rectifier ou à améliorer, notamment en aval de la Naye, près de Visé, en amont de Smermaes; en aval de la prise d'eau, à Hocht; en amont du hameau de Herbericht; en aval d'Uyckhoven; en amont de la maison nommée le Hall, à Cotheim; à Mechelen; au port d'Urmond; en amont du chàteau d'Obbicht; en amont de la Vieille-Meuse, à Stockheim; au village de Grevenbicht; en amont de la maison dite de Koock; à Visserwert; vis-à-vis de Heppener; en aval de Roosteren, etc.
« A côté des obstacles, dit M. de Sermoise, et des causes de destruction qu'on a déjà signalées, viennent se ranger les empiétements que, pendant bien des années, quelques propriétaires ont faits; ils ont, par des plantations ou des fascinages, tourmenté le cours de la rivière; ils en ont diminué la section transversale, refoulé les eaux vers la rive opposée, qui, souvent n'étant pas aussi bien entretenue, a dû succomber à la fin. »
Les travaux que propose cet ingénieur sont nombreux et de diverses espèces. Les principaux consistent en dérivations; en barrages perpendiculaires au courant, en épis et éperons de chasse; en pérés simples, ou avec enrochement, ou sur pilotis; en fascinages, etc. Il estimait que la dépense monterait à fr. 2,003,078-66 polir les dérivations, à fr. 1,702,741-53 pour les autres ouvrages, en tout à fr. 3,705,820-19.
Il est certain que l'entretien des rives entamées par les hautes eaux, est une nécessité des plus urgentes, et elle a été sentie par le gouvernement hollandais, qui, dès cette année, vient de sauver d'une ruine imminente le village de Maasbracht, en amont de Vessem, par l'exécution d'un revêtement en fascinage (24). D'autres communes auraient eu besoin des mêmes ouvrages de défense; mais le système du gouvernement hollandais est de venir au secours de celles qui entrent selon leurs moyens dans la dépense, et de ne rien faire pour celles qui ne consentent pas à s'imposer de minces sacrifices, même lorsqu'il s'agit de leur conservation.
Il est à observer que les empiétements annuels de la Meuse se font principalement sur sa rive droite, où elle est poussée par les vents d'ouest, qui règnent la plus grande partie de l'année, et surtout dans la mauvaise saison (25).
Il résulte de là que la Belgique a comparativement peu de travaux de défense à exécuter, que les plus nombreux, les plus importants, concernent la rive hollandaise, et qu'ainsi les dépenses de première construction et d'entretien ne seraient pas très élevées. D'un autre côté, plus la Hollande s'applique à défendre sa rive, plus il importe de défendre la nôtre, qui serait d'autant plus aisément endommagée que la rive droite opposerait une plus forte résistance aux envahissements du fleuve.
Des dispositions réglementaires prises dès 1818, dans le Limbourg, renouvelées en 1825 et approuvées par arrêté royal du 13 novembre de la même année, qui mettaient à la charge des communes riveraines tous les ouvrages défensifs, sont demeurées sans effet, quoique la province s'engageât à venir en aide aux communes, lorsque l'étendue des travaux ou la situation de la caisse communale le requerrait. Ce serait donc se tromper gravement que de compter sur les communes, même sur les provinces, pour des travaux d'intérêt général, quand on en voit de si peu soucieuses d'exécuter des ouvrages que leur commande non l'espoir d'avantages éloignés, mais le simple sentiment de leur sécurité présente.
Si jusqu'à Venloo la Meuse exige de grands travaux et de grands frais, elle peut sans inconvénient être à peu près abandonnée à elle-même en aval de cette ville, et tout te soin qu'elle demande se borne à quelques travaux d'entretien. Là, son régime bien établi se continue d'une manière régulière, son cours se rectifie, les plus basses eaux y ont au moins 1m,40 et même 1m,50, et en toute saison elle admet des bateaux de 47m,50 de long, sur 7m,50 de large, avec un tirant d'eau de plus d'un mètre, et du port de 250 tonneaux.
C'est de Venloo que devait partir le grand canal du Nord, destiné à joindre l'Escaut à la Meuse et la Meuse au Rhin (26). Les travaux, décrétés le 9 thermidor an XI, commencés en 1808, ont été abandonnés en 1813, par suite des événements politiques (27).
RÈGLEMENTS ET PÉAGES.
Quelque difficile qu'ait toujours été la navigation de la Meuse, son importance pour les provinces qu'elle traverse n'en a pas moins obligé le commerce à se servir de cette grande voie de communication. Utile dans tous les temps pour les marchandises dont les frais de transport par terre eussent empêché ou restreint l'usage, indispensable pour les matières pondéreuses, telles que les pierres, les minerais, la houille, et aujourd'hui d'une nécessité absolue pour l'industrie croissante de trois provinces, pour ses relations au dedans et au dehors, ce fleuve a été soumis, selon les époques, à des règlements et à des péages qui n'ont pas toujours été assez protecteurs.
La navigation de la Meuse, quant aux règles générales, est assujettie en France aux dispositions de l'ordonnance de 1669; les droits, jusqu'à ces derniers temps, étaient réglés en conformité de la loi du 30 floréal an X, étendue à toutes les rivières françaises par l'arrêté du 8 prairial an XI, et rendue applicable à la Meuse par les décrets impériaux du 10 brumaire an XIV. La quotité du péage, le nombre des bureaux de perception, ainsi que leur emplacement, sont indiqués par le tableau suivant.
Tarif des droits de navigation sur la Meuse française.
(Loi du 30 floréal an X et décret impérial du 10 brumaire an XIV.)
DESIGNATION
de l'espèce de bateaux
en largeur |
Droits à payer à la remonte et à la descente
Stenay
Francs |
Sedan
Francs |
Meziere
Francs |
Fumay
Francs |
Givet
Francs |
|
| De 2m40 et au-dessous |
| 2m40 à 2m70 |
| 2m70 à 3m10 |
| 3m10 à 3m40 |
| 3m40 à 3m70 |
| 3m70 à 4m10 |
| 4m10 à 4m30 |
Flotte, bois flottants et
trains de bois,
par 0m30 de longueur |
|
| 0,60 |
0,40 |
0,30 |
0,70 |
0,35 |
| 1,90 |
1,15 |
0,90 |
2,30 |
1,20 |
| 4,40 |
2,60 |
2,10 |
5,20 |
2,70 |
| 6,25 |
3,75 |
3,00 |
6,90 |
3,60 |
| 7,50 |
4,50 |
3,60 |
8,30 |
4,30 |
| 8,75 |
5,25 |
4,20 |
9,80 |
5,10 |
| 10,10 |
6,00 |
4,80 |
11,50 |
6,00 |
| 0,15 |
0,10 |
0,80 |
0,15 |
0,10 |
|
OBSERVATIONS
Les voitures et coche d'eau, et autres bateaux destinés uniquement aux transport des voyageurs payaient 5 francs par bureau.
Nota. Le décime par franc devait être ajouté aux droits.
On voit qu'il y avait sept classes de bateaux déterminées par la largeur, et que les droits perçus dans ces bureaux l'étaient pour la navigation ascendante et descendante, en amont de chacun d'eux.
Un décret impérial du 22 janvier 1808, sur la largeur nécessaire au chemin de halage, déclare l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669, applicable à toutes les rivières de l'empire, et depuis lors, rien n'avait été innové ni dans les péages, ni dans la police du fleuve. Mais une loi récente, du 9 juillet 1836, change tout le système suivi pendant trente années. Le gouvernement français ne s'est pas contenté de perfectionner le lit de la Meuse et des autres fleuves il a compris aussi qu'il devait alléger les charges de la navigation, en asseyant mieux le péage et en le diminuant.
Le 23 mai 1834, les chambres françaises ont adopté une loi qui modifie, pour la Basse-Seine, les droits introduits par la loi du 30 floréal an X, et qui décide qu'au 1 septembre de la même année le droit sera perçu d'après la charge réelle des bateaux, à raison de centimes et demi à la remonte, et de 2 centimes à la descente, par distance de 5 kilomètres et par tonneau de 1,000 kilog. Par là on a mis un terme, en ce qui concerne la Basse-Seine, à l'abus évident de l'ancienne loi, par laquelle il arrivait que des bateaux très larges payaient plus que d'autres d'une moindre largeur, qui étaient cependant d'un plus fort tonnage. A cette occasion, la question de la suppression entière des droits de navigation a été soulevée dans les débats législatifs, et l'on a soutenu que les vrais principes d'économie politique exigeaient cette suppression; qu'il y aurait profit pour l'État à favoriser tes transports par eau; que les routes ne seraient plus détériorées par les objets d'un grand poids, dont la navigation se chargerait avec bénéfice pour tous; que si, par cette mesure, l'État perdait deux millions de francs que lui rapportent les péages sur les fleuves et sur les canaux, il gagnerait en échange plus de dix millions sur les frais d'entretien des routes.
A dater du 1er janvier 1837, le principe adopté pour la Basse-Seine est devenu la règle des péages pour la Meuse et d'autres rivières, en conformité de la loi du 9 juillet 1836. L'art. 1er de cette loi dispose que le droit sera imposé par distance de 5 kilomètres, en raison de la charge réelle des bateaux, en tonneaux de 1,000 kilogrammes, ou du volume des trains en décastères;
l'art. 2, que le nombre des tonneaux imposables sera déterminé, au moment du jaugeage des bateaux et pour chaque degré d'enfoncement, par la différence entre le poids de l'eau que déplacera le bateau chargé et celui de l'eau que déplacera le bateau vide, y compris les agrès, le degré d'enfoncement étant indiqué au moyen d'échelles métriques incrustées dans le bordage extérieur du bateau; l'art. 3, qu'il y aura deux classes de marchandises, et que celles qui seront soumises au droit fixé pour la 2e classe, sont: 1° les bois de toute espèce, autres que les bois étrangers d'ébénisterie ou de teinture, le charbon de bois ou de terre, le coke et la tourbe, les écorces et les tans; 2° le fumier, les cendres et les engrais de toute sorte; 3° les marbres et les granits bruts ou simplement dégrossis, les pierres et moellons, les laves, les grès, le tuf, la marne et les cailloux; 4° le plâtre, le sable, la chaux, le ciment, les briques, tuiles, carreaux et ardoises; 5° et enfin le minerai, le verre cassé, les terres et ocres. Toutes les marchandises, autres que celles qui viennent d'être désignées, sont imposées à la 1ère classe du tarif, dont voici l'extrait:
Tarif des droits de navigation.
(Loi du 9 juillet 1836.)
| Bassins |
Fleuves, rivières et
canaux auxquels
s'applique le tarif.
Rivières
|
| Quotité de la taxe par tonneau et par distance. |
A LA DESCENTE
Marchandise de |
A LA REMONTE
Marchandise de |
|
| 1 classe |
2 classe |
3 classe |
4 classe |
|
|
TRAINS
PAR DECASTERE
ET PAR DISTANCE
|
| Meuse |
Meuse |
| 2 cent. |
1 cent. |
2,5 cent. |
1,25 cent. |
|
5 cent. |
Les autres dispositions expliquent et complètent la loi dont le mode d'exécution a été réglé par ordonnances royales du 15 octobre de la même année et du 27 octobre 1837.
La loi du 30 floréal an X avait créé les droits de navigation intérieure, et leur produit formait, pour chaque rivière, un fonds spécial exclusivement affecté à son entretien. La spécialité de cet impôt a été supprimée en 1814, et, depuis lors, des sommes bien plus considérables que celles qu'il produisait, ont été consacrées aux travaux de la navigation intérieure, ainsi qu'on en peut juger par les allocations relatives à la Haute-Seine, à la Moselle et, plus récemment, à la Meuse. Chaque rivière, depuis l'an X, avait un tarif particulier, et non seulement de bassin à bassin, mais, dans un même bassin, de rivière à rivière, le tarif, ses bases et le mode de perception n'avaient souvent rien de commun. La loi du 9 juillet 1836 a eu pour but de ramener, autant que possible, tous les tarifs à un taux et à des bases uniformes, en prenant ces bases dans la distance parcourue et dans le poids de la marchandise. Il est remarquable que, dans la discussion de cette loi, comme acheminement à l'abolition de tout droit sur la navigation intérieure, le ministère français ait adhéré à la proposition faite par la commission de la chambre des députés, de diminuer d'environ un million de francs le produit de cet impôt.
En Belgique, les péages ont subi de nombreuses variations.
Sous le gouvernement des princes-évêques, les bateaux venant de France payaient un droit à leur entrée dans le pays de Liège, au bureau d'Hermeton (28); ils payaient aussi le tonlieu à leur passage à Namur, au pont de Huy (29), au pont des Arches et à Maestricht.
Ce droit de tonlieu, qui était une taxe sur les marchandises, date des époques les plus reculées; on le voit mentionné dans des actes du Xe siècle, entre autres dans un diplôme de Louis, fils de l'empereur Arnulph, de l'an 908, en faveur de l'église de Liège (30); au XVe siècle, dans une cession en date du 1er juillet 1469, faite par le prince-évêque, Louis de Bourbon, au duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, pour en jouir, lui, ses hoirs et ayant-cause, pendant le terme de trente ans, du droit de tonlieu sur les bateaux et marchandises, et sur tout ce qui passait sous le pont des Arches, droit qui s'élevait au trentième des biens et marchandises, et dont les sujets du duc de Bourgogne étaient seuls exemptés; au XVIe siècle, dans un concordat du 4 août 1546, entre le pays de Liège et l'empire (31); au XVIIe siècle, notamment dans un acte du 7 août 1657, portant que le péage sur et sous le pont des Arches avait été affermé pour 23,000 fl. au sieur soub-mayeur Prosset; mais que les bourgeois ayant fait du bruit à cette occasion, MM. les bourgmestres et le conseil de la cité s'empressèrent de surroguer au lieu et place dudit péage, un impôt de dix liards sur chaque tonne de bière, en sus des dix liards déjà imposés pour la construction dudit pont (32).
Le tonlieu s'est conservé jusqu'à la réunion de la Belgique à la France.
Indépendamment des droits d'entrée et des tonlieus, les bateaux qui descendaient la Meuse étaient contraints d'acquitter des droits de sortie et de passage. De Liège à Gorcum, il y avait:
A Lixhe, bureau de péage du prince de Liège;
A Nawagne, bureau de droit d'entrée de l'Autriche
A Urmond, bureau de droit d'entrée et de sortie de l'électeur palatin;
A Ruremonde, bureau de droit de sortie de l'Autriche;
A Kessel, bureau de droit d'entrée de la Prusse;
A Well, bureau intermédiaire de la Prusse;
A Gennep, bureau de droit de sortie de la Prusse;
A Catwyck, tol de la princesse de Hohenzollern;
A Catwyck, bureau de déclaration d'entrée en Hollande;
A Grave, tol hollandaise et bureau pour le paiement des droits, d'après la déclaration faite à Catwyck;
A Ravenstein, forte tol de l'électeur palatin, dont le péage était suspendu à certaines époques de l'année;
A Maas-Bommel, tol seigneuriale;
A Batenburg, tol seigneuriale, doublée à certaines époques;
A Bommel, tol seigneuriale.
En remonte, il fallait encore acquitter un droit au bureau de Coronmeuse (33).
Il serait difficile de savoir aujourd'hui quel était au juste la quotité du droit dans chacun de ces bureaux (34); mais quelle qu'elle fût, la multiplicité des péages n'aurait pas été tolérable, si les bateliers n'avaient eu l'adresse de s'y soustraire par la fraude et par leur connivence avec les receveurs, et c'était une entrave des plus onéreuses pour la navigation. Le batelage cependant était l'objet d'une protection spéciale de la part des princes-évêques, qui s'opposaient, dans le pays de Liège, aux vexations des châtelains voisins du fleuve. Un édit de 1733 défend au comte d'Arberg, seigneur de la Rochette, d'exiger aucun péage pour la navigation sur la Vesdre (35). Une vigilante sollicitude entourait les bateliers de la même protection dans le comté de Namur. Un placard de Philippe IV, de l'année 1656, défend à tous les officiers publics de prendre ou exiger aucune chose sur bateaux, chariots, chevaux, personnes et marchandises, passant par rivières, ponts, etc. et ce à peine de privation de toutes charges, au regard des gouverneurs, commandants ou officiers, de trois traits de corde au regard des soldats, etc. (36).
Lors de la réunion à la France, tous les droits établis sur la Meuse belge furent abolis, et le décret du 10 brumaire an XIV supprima les péages qui existaient encore à cette époque sur la Meuse hollandaise jusqu'à Mooch, au-dessous de Venloo. Pendant plus de dix ans, de 1795 à la fin de 1805, la Meuse fut affranchie de tout droit, et les bateliers, soumis, comme les autres industriels, à un simple droit de patente, ne cessèrent de jouir de cette liberté qu'en 1806.
Le décret du 10 brumaire, dont un extrait publié à Liège le 11 janvier 1806 par le préfet du département de l'Ourthe, l'a été à Namur et à Maestricht dans le même mois, ayant appliqué à la Meuse les dispositions de la loi de floréal, les péages furent perçus, à partir du 1er février suivant, aux bureaux établis par un second décret du 10 brumaire an XIV. Les bureaux étaient, pour nos trois provinces, à Dinant, à Namur, à Huy, à Liège, à Maestricht, à Ruremonde et à Venloo. Le droit était calculé sur la distance, et les distances étant inégales, le tarif fut réglé en conséquence. En voici le tableau:
Tarif des droits de navigation sur la Meuse belge.
(Loi du 30 floreal an X et décret impérial du 10 brumaire an XIV.)
DESIGNATION
de l'espèce de bateaux
en largeur |
Droits à payer à la remonte et à la descente
Dinant
Francs |
Namur
Francs |
Huy
Francs |
Liege
6 maisons |
Liege
Coronmeuse |
Maestricht |
Ruremonde |
Venloo |
|
| De 2m40 et inf. |
| 2m40 à 2m70 |
| 2m70 à 3m10 |
| 3m10 à 3m40 |
| 3m40 à 3m70 |
| 3m70 à 4m10 |
| 4m10 à 4m30 |
Flotte, bois flottants et
trains de bois,
par 0m30 de longueur |
|
| 0,30 |
0,35 |
0,45 |
0,50 |
0,50 |
0,95 |
0,40 |
0,65 |
| 1,00 |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
1,50 |
3,00 |
1,25 |
1,75 |
| 2,25 |
2,50 |
3,00 |
3,85 |
3,30 |
6,60 |
2,75 |
4,40 |
| 3,00 |
3,30 |
4,10 |
5,25 |
4,50 |
9,00 |
3,75 |
6,00 |
| 3,60 |
3,95 |
4,95 |
6,30 |
5,40 |
10,80 |
4,50 |
7,20 |
| 4,25 |
4,70 |
5,75 |
7,35 |
6,30 |
12,60 |
5,25 |
8,40 |
| 5,00 |
5,50 |
6,90 |
8,75 |
7,50 |
15,00 |
6,25 |
10,00 |
| 0,80 |
0,10 |
0,12 |
0,15 |
0,12 |
0,20 |
0,10 |
0,15 |
|
OBSERVATIONS
Les voitures et coche d'eau, et autres bateaux destinés uniquement aux transport des voyageurs payaient 5 francs par bureau.
Nota. Le décime par franc devait être ajouté aux droits.
Le gouvernement français disposant des recettes en vertu de la loi du 30 floréal, se chargeait de l'entretien des rivières, et, dans le département de l'Ourthe, même lorsqu'il n'en était indemnisé par aucun péage, il dépensait annuellement de 20 à 25,000 fr. pour cet objet, si l'on en juge par les allocations de l'an XI, de l'an XII et de l'an XIII, qui ont été de 20,000 Fr. pour chacun des deux premières années, et de 25,000 Fr. pour la dernière (37).
A cette époque, de grandes réparations étaient déjà devenues nécessaires, et l'abandon dans lequel on avait précédemment laissé les rives de la Meuse, les digues, le chemin de halage, est signalé dans un rapport du 1er prairial an IX, adressé au ministre de l'intérieur par le préfet de l'Ourthe. C'est pour porter remède à cet état alarmant, selon les termes du préfet, mais qui se prolongea encore pendant des années, que parut le décret impérial du 4 prairial an XIII, modifié peu après par celui du 8 vendémiaire an XIV, et qui rend exécutoire en Belgique l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669 (38).
La perception de tout droit, fut suspendue à l'arrivée des alliés en 1814; mais en vertu d'un arrêté du gouverneur-général du Bas-Rhin, en date du 5 juin de la même année, et qui demeura obligatoire sous le gouvernement des Pays-Bas, cette perception fut reprise d'après le tarif du 10 brumaire: elle recommença le 10 juin. Le seul changement apporté aux anciens règlements par l'arrêté du gouvernement prussien, fut la suppression du droit de 10 centimes par bureau pour les laissez-passer. Tant que ce régime fut en vigueur, le bureau de Dinant produisit environ fr. 10,000 par année, celui de Maestricht fr. 18,000, Ruremonde et Venloo ensemble à peu près de fr. 30 à 35,000.
A ces droits s'ajouta en 1816, par la loi du 15 septembre, un droit de tonnage dit last-geld, espèce de patente pour chaque bateau (39). Mitigé le 12 mai 1819, ce droit a été abrogé le 12 juillet 1821, et finalement remplacé par la patente personnelle imposée aux bateliers.
En 1818, un arrêté royal du 1er mars, pour maintenir la liberté de la navigation, supprima les taxes municipales qui, dans quelques communes, restreignaient cette liberté.
Par arrêté royal du 17 décembre 1819, l'administration de la Meuse fut divisée et confiée aux trois provinces de Namur, de Liège et de Limbourg, chacune pour la partie qui la traverse. Dès-lors, sur la proposition des États députés de la province de Namur, de commun accord avec les États députés de Liège et ceux du Limbourg, un nouveau tarif fut adopté par arrêté royal du 30 octobre 1820, et le droit se perçut au profit de chacune des trois provinces. Ce règlement ne fut cependant que provisoire; le gouvernement se réserva d'en changer les dispositions d'année en année, sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, et c'est seulement en 1827, après avoir été approuvé de nouveau tous les ans, qu'il reçut une sanction définitive.
En vertu de l'arrêté du 30 octobre 1820, devenu exécutoire le 1er janvier 1821, la dimension des bateaux cessa de servir de règle pour le droit à acquitter, la capacité en devint la base, et il fut fixé a trois centièmes de florin par tonneau et par bureau; les trains de bois payaient le même droit pour chaque stère dont ils se composaient.
Il semble que, dans ce système, la taxe dût être moins élevée que celle qui se prélevait précédemment, et qu'elle fût mieux assise, puisqu'elle prenait pour point de départ la capacité. Une note de l'inspecteur de la navigation, du 20 avril 1820, fait en effet observer que le bureau de Coronmeuse, qui avait rapporté en 1819 la somme de fl. 11,530-46, ou Fr. 24,403-08, n'aurait produit, d'après le nouveau tarif, que fl. 3,729-41, ou fr. 7,892-92. Le bureau des Six-Maisons aurait perdu, dit-il, bien davantage. Mais les bateliers ont présenté des observations contraires, se fondant sur ce que le tarif imposait la capacité du bateau, et non pas le chargement réel.
Les nouveaux bureaux étaient dans la province de Namur, Hastières-Lavaux, Profondeville et Lives; dans la province de Liège, Huy, Liège, en partie aux Six-Maisons, en partie à Coronmeuse, et Lixhe; dans le Limbourg, St-Pierre, Maeseyck, Ruremonde, Venloo et Well.
La perception, d'après ce règlement qui spécifiait quelques exemptions en faveur des services publics et de l'agriculture, produisait annuellement dans la province de Namur environ fr. 30,000, autant dans la province de Liège, et de Fr. 40 à 45,000 dans le Limbourg. Continuée jusqu'à ce jour dans les deux premières provinces, elle a cessé dans la dernière au moment où les événements politiques sont venus interrompre le passage par Maestricht. Aussitôt après la convention de Londres du 21 mai 1833, la députation des États, dans l'idée que la navigation allait reprendre quelque activité, s'est hâtée de rétablir les bureaux de péage; mais la perception ne s'est faite que pendant le mois d'août de la même année, les intérêts du commerce ayant exigé que le droit fût aboli. La recette de ce seul mois avait été de fr. 2,022-69.
Les produits du péage étaient, dans les trois provinces, consacrés à l'entretien de la rivière et presque uniquement employés à l'amélioration du chemin de halage, usage pour lequel ils auraient suffi, si, par des dépenses premières, un véritable halage eût été convenablement établi; mais, obligées de construire de nouveaux chemins et d'entretenir ceux qui se détérioraient, les provinces, ont été astreintes à une économie préjudiciable aux travaux à faire. Ainsi, on a cherché à tenir le chemin de halage à 2 mètres; le fleuve ne cessant d'être navigable que lorsque les eaux s'élèvent à 2m,50 et même à 2m,60, il s'ensuit que les chevaux doivent entrer dans l'eau de 50 à 60 centimètres. Si l'on considère la difficulté de la remonte à cette époque, la force des courants qu'il faut surmonter, la position gênante du cheval, presqu'en travers sur la ligne étroite qu'il parcourt, on conviendra de la justesse du mot des bateliers, qu'un cheval dans l'eau ne vaut plus que la moitié d'un cheval.
Ce péage, ressource insuffisante pour les travaux à faire dans les provinces de Liège et de Namur, a complétement manqué dans le Limbourg depuis 1830, en sorte qu'il a fallu que l'État intervint pour sauver plusieurs villages d'une destruction inévitable sans son secours. A dater de 1833, le trésor public a donné au Limbourg, pour entretien des rives de la Meuse, la somme de fr. 283,000; les riverains, dans un espace de quatre ans, ont exécuté pour fr. 128,770 de travaux défensifs, et une allocation de fr. 40,000 pour les mêmes travaux continue à figurer au budget de l'État.
En outre du droit perçu d'après le règlement du 30 octobre 1820, il y a sur la Meuse, comme sur les autres rivières, des péages au profit de l'État ou des communes. Dans la province de Namur, 17 passages d'eau, 21 dans la province de Liège, et 16 dans la province de Limbourg, en tout 54, rapportent à l'État une somme totale et annuelle d'environ fr. 32,000, et aux communes fr. 2,484-20 (40); mais les trois provinces, bornées au revenu du péage établi sur la navigation, n'ont pu pourvoir ni à l'entretien du fleuve, ni aux besoins du batelage, et se sont vues dans l'impossibilité de lui procurer les facilités qu'il réclame. Et cependant le batelage de la Meuse emploie, dans la seule province de Liège, plus de 3,000 ouvriers, plus de 400 chevaux, et possède un matériel qui lui coûte environ fr. 9,000,000. Dans les trois provinces, le capital affecté à ce matériel va au delà de fr. 16,000,000. Une foule d'industries sont donc froissées à la fois quand le batelage est en souffrance,
Vous avez justement reconnu, Monsieur le Ministre, qu'il était temps que cette fâcheuse situation changeât. Les intérêts compromis par l'abandon d'un fleuve si important, les résultats qu'amènerait une navigation non interrompue, si ce n'est lors des fortes gelées et des hautes eaux, seulement pendant quelques semaines, doivent faire envisager comme peu de chose la dépense nécessaire pour les améliorations de son chenal navigable et pour l'entretien de ses rives.
MOUVEMENT DE LA NAVIGATION.
Si, en effet, on se reporte à l'an IX, époque déjà fort éloignée, on trouvera que dès-lors, malgré la difficulté des temps, il y avait 110 bateaux du port de 200 à 250 tonneaux, allant de Venloo à Dordrecht et à Rotterdam; 120 d'un port moindre versaient à Venloo leurs cargaisons; 45 du port de 40 à 50 tonneaux, allaient de Liège à Namur et de Namur à Charleville, et leurs chargements se composaient de 2,000,000 de quintaux de houille, de 13,000 d'alun, de 140,000 de chaux, de 120,000 de clous, en tout de 2,273,000 quintaux, ou 113,650 tonneaux, représentant une valeur de fr. 4,612,000 (41).
Les transports actuels entre Verdun et Sedan s'élèvent à 10,000 tonneaux; entre Sedan et Charleville, à 40,000; et de Charleville à Givet, ils dépassent 90,000. Ces transports se composent principalement de houille tirée de Liège et de Charleroy, d'ardoises des carrières de Fumay et de Monthermé, de minerai pour les hauts-fourneaux situés entre Givet et Charleville, de bois de charpente et de chauffage, des produits des usines à fer, des verreries, etc. La quantité de houille introduite en France, par Givet, s'est élevée, en 1833, à 40,000 tonneaux; en 1834, à 50,000; en 1837, à 66,000; en 1838, à 55,000, et pendant les 9 premiers mois de 1839, à 40,500 (42) elle représente donc à peu près les deux tiers du tonnage total dans cette direction.
Les transports de Namur à Givet s'effectuent sur près de 150 bateaux, comprenant en totalité 9,000 tonneaux et parcourant continuellement la Meuse, tant que les eaux ne sont ni trop basses, ni trop hautes. Leurs chargements vont, en remonte, à plus de 170,000 tonneaux; savoir: houille, de 110 à 120,000; charbon de bois, 12,000; minerai de fer, 23,000; écorces, 5,000, etc. Sur les 120,000 tonneaux de houille, 60 ou 65,000 proviennent de Charleroy, et 50 à 55,000 des houillères de Liège; 5,000 sont employés à la consommation de la ville de Dinant; 18,000 environ per les villages qui bordent la Meuse, et le reste est consommé dans diverses usines ou destiné pour la France. Le minerai est pour les hauts-fourneaux entre Namur et la frontière.
En descente, ces mêmes bateaux importent de 8 à 10,000 tonneaux, sur lesquels les ardoises comptent pour plus de 4,000. Le vin, les eaux-de-vie, le cuivre, la craie, la soude, la laine, etc., etc., forment le reste. - De Givet à Dinant le transport total peut être de 30 à 35,000 tonneaux.
De Liège à Namur et à Maestricht, on comptait à la fin de 1833, 313 bateaux: 119 au-dessus de 20 tonneaux, contenant ensemble près de 4,000 tonneaux; et 194 d'un port inférieur, ne naviguant qu'à de petites distances. En 1826, le nombre des bateaux était aussi de 313; mais il y eu avait 147 au-dessus de 20 tonneaux, et leur ensemble formait près de 11,000 tonneaux.
Les produits qui s'écoulent sur Namur sont principalement la houille et le fer, et les transports vers cette ville forment, en remonte, plus de 100,000 tonneaux. La ville de Huy, la ville d'Andenne et les villages sur la Meuse, exigent plus de 30,000 tonneaux de houille pour leur consommation (43).
En descente, de Narnur à Liège, le minerai, les pierres à bâtir, la chaux, etc., s'élèvent en totalité à environ 150,000 tonneaux, nombre dans lequel le minerai entre pour 60,000, tirés de la province de Namur, et en grande partie de Bouillon; la pierre calcaire ou castine, pour 20,000, et la chaux pour 6,000 tonneaux.
De Liège sur Maestricht, pour la partie belge en aval et pour la Hollande, le mouvement était, avant la révolution, pendant les années 1828, 1829 et 1830, d'environ 300,000 tonneaux, dont 230 à 235,000 de houille, et le surplus en fer, chaux, bois, ardoises, pierres de taille, terre de pipe, alun, clous, etc. Le retour, en vieux fer, en fer travaillé ou en gueuse, en poisson, beurre, genièvre, huiles, fromages, graines, etc., n'était pas au-dessous de 200,000 tonneaux. Le transport de la houille occupait alors à lui seul près de 600 bateaux belges et hollandais (44).
Dans ces évaluations n'entrent pas les transports à petite distance et de toute saison, qui se font sur des bateaux légers et d'un faible tonnage, pour les échanges réciproques et les approvisionnements des localités voisines; mais, tels qu'ils sont, les transports constatés n'approchent point de ce qu'ils seraient si la navigation n'était pas fréquemment interrompue. Un seul industriel de Liège tirerait annuellement de l'entre Sambre-et-Meuse 50,000 tonneaux de minerai de fer pour ses usines, si les communications étaient plus faciles; bien d'autres feraient comme lui, et ce surcroît d'activité serait plus productif pour le trésor, que ne saurait l'être le plus fort péage. Mais je ne veux pas oublier qu'il s'agit en ce moment de ce qu'est la Meuse, et non de ce qu'elle peut être un jour.
Je m'arrête donc, Monsieur le Ministre, pour m'en tenir aux notions que vous avez désiré voir réunies et qui témoignent de l'état actuel de ce fleuve.
CONCLUSION.
En résumé, la Meuse est aujourd'hui en Belgique, à peu de chose près, ce qu'elle a été dans tous les temps; si, jusqu'en 1794, elle a été, dans la traverse de Liège et dans ses abords, l'objet de fréquents curages et d'utiles travaux d'entretien, elle n'a jamais, en aucune de ses parties, offert une pleine sécurité à la navigation, jamais nulle part elle n'a été entièrement exempte de longueurs ou de périls, et les améliorations qu'elle a depuis des siècles si vainement attendues, c'est de votre administration qu'elle les recevra.
Il serait sans doute téméraire d'assigner dès à présent d'une manière trop précise le système de travaux qu'il conviendra de suivre pour atteindre le but cependant, si l'on considère que les dérivations et les coupures sont très coûteuses, qu'elles exigent un nombreux personnel, qu'elles privent toujours quelques communes d'avantages et de droits acquis, et que le passage des écluses entrave la navigation à la vapeur, que l'intérêt public est d'encourager; si, d'autre part, on tient compte du régime du fleuve, auquel on ne doit toucher qu'avec une extrême circonspection, de la nature et de la configuration du terrain, de la solidité, de la régularité du fond, du genre de difficultés que rencontre la navigation depuis la frontière de France jusqu'à Liège et au-delà, peut-être déjà, sans rien adopter exclusivement, sans rien repousser d'une manière absolue, peut-on prévoir que, dans cette partie, des chenaux en rivière avec digues submersibles, des barrages obliques aux bras perdus, qui abaissent les eaux en les divisant, et l'enlèvement des roches aux endroits où elles gênent le passage des bateaux, seront des mesures efficaces pour entretenir constamment la hauteur d'eau que demande le batelage; peut-être même pourrait-on espérer par là d'obtenir de 1m,50 à 1m,60 aux plus bas étiages, condition qu'il serait essentiel de remplir, vu le tirant d'eau des bateaux de la Sambre, qui oblige maintenant les bateliers de cette rivière à rompre charge à Namur, et à transborder le chargement d'un seul bateau de Sambre sur deux ou trois bateaux de Meuse. C'est une perte de temps et d'argent, et la navigation a besoin d'être délivrée de retards si dispendieux.
De Liège au-dessous de Maeseyck, jusqu'au point où les deux rives deviennent hollandaises, le même système pourrait être suivi; il faudrait seulement y ajouter des travaux de défense pour les rives en butte à de continuelles érosions, et dans toute l'étendue du fleuve, il faudrait aviser à la construction d'un chemin de halage; les endroits où il manque sont les plus nombreux, et presque partout où il existe, il devrait être exhaussé et élargi; souvent aussi, trop éloigné du chenal navigable, il est également impraticable dans les hautes et dans les basses eaux.
Vous avez sagement pensé, Monsieur le Ministre que de semblables travaux ne devaient point être concédés à des particuliers; leur utilité est trop générale pour qu'ils ne soient pas exécutés par l'État. Une compagnie ne peut se rendre concessionnaire d'une aussi grande entreprise qu'en se ménageant le moyen de rentrer dans ses fonds par l'élévation des péages: aucun autre genre de bénéfice ne lui est réservé pour le dédommagement de ses peines et le remboursement de ses capitaux. Il n'en est pas de même pour l'État: les péages ne sont qu'une partie des produits de ses dépenses premières, qui rentrent indirectement dans ses coffres par une multitude de voies. Outre que les dépenses réclamées par les besoins du commerce et de l'industrie sont une dette qu'il lui faut acquitter, fût-ce aux dépens du trésor, la prospérité qu'elles font naître devient une source de nouveaux produits, et il y a plus que compensation entre les dépenses et les recettes. Le péage peut-être, dans certaines circonstances, ne rendra pas l'intérêt du capital employé; mais les développements que donnent à l'industrie des communications faciles, les produits qu'elles créent, les transactions qu'elles provoquent, la valeur qu'elles font acquérir à des lieux qui n'en avaient pas, les richesses qu'elles répandent, l'accroissement qu'elles introduisent dans la consommation, toutes ces circonstances diverses, indépendamment du bien-être général qu'elles étendent et affermissent, apportent dans les caisses publiques un intérêt élevé du capital dont l'État a ,fait l'avance. Ces avantages, partiels pour des provinces, peu sensibles pour des communes, perdus pour une compagnie une capitalistes, ne sont recueillis que par l'Etat; lui seul peut donc véritablement améliorer, en fournissant aux dépenses nécessaires.
Du reste, il ne s'agit pas de faire disparaître toutes les difficultés de la navigation, ce serait folie d'y prétendre; ni de bouleverser le régime du fleuve en cherchant à le perfectionner: il s'agit seulement d'avoir partout une hauteur d'eau suffisante, et les dépenses ne seraient pas aussi considérables qu'on pourrait le croire au premier abord. Il est vraisemblable que ce qui a été utilement pratiqué sur le Rhin, sur la Moselle, sur la Loire, que ce qui a réussi en France sur la Meuse, doit réussir également en Belgique dans des conditions analogues; les barrages faits par les bateliers au confluent de l'Hermeton et à Hastières - Lavaux, le creusement du chenal vis-à-vis du château de Waulsort, sont des indications qui semblent d'avance garantir le succès, et des essais immédiats peuvent d'ailleurs dissiper tous les doutes.
Les ouvrages en aval de Liège seraient une conséquence des travaux en amont, sauf ce qui concerne la défense des rives, et ces derniers ouvrages sont également indiqués.
Liège, le 23 décembre 1839.
L'ingénieur chargé de l'étude générale de la Meuse,
H. GUILLERY.
(1) On traverse la Meuse près de Neufchâteau, sur un pont très ancien et très étroit. - II y en a un fort beau à Pagny.
(2) « La Meuse, disent les Mémoires du Maréchal de Vauban, portait naturellement bateaux, en 1659, jusqu'à St-Mihiel, et, quand les eaux étaient bonnes, ils la remontaient jusqu'à Commercy, qui est à trois lieues de Pagny. » On peut induire de là combien, par le défaut de soin, s'altère rapidement le régime d'un fleuve, et ce qu'il faut de travaux et de persévérance pour lutter victorieusement contre les causes sans cesse renaissantes de déviation, d'attérissements etc.
(3) Les évaluations du volume d'eau, de la vitesse moyenne, etc., se rapportent à l'étiage.
(4) Sedan a un beau pont sur la Meuse: la pierre dont il est construit a été prise dans la ville même et à ses portes.
(5) Louvois avait eu le projet de joindre l'Aisne à la Meuse par un canal qui devait prendre ce fleuve au-dessus de Stenay, traverser la rivière de Bar par le Chêne et se jeter dans l'Aisne au-dessus de Vouziers; mais ce projet s'évanouit à la mort du ministre qui l'avait conçu.
(6) Le pont de Dinant a été construit en 1080 et réparé à diverses époques.
(7) Le pont de Namur date du onzième siècle; comme celui de Dinant, il a été plusieurs fois réparé et restauré. Le 21 juillet 1760, le magistrat de la ville ordonne que des réparations soient faites au Pont-de-Meuse, et qu'un bac soit provisoirement établi pour le passage du public.
(8) « Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les gouvernements co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux. » - Traité de Vienne: Règlement: pour la libre navigation des rivières, article concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, article IV.
(9) « Des considérations de localité, des intérêts personnels trop protégés aux dépens de ceux de la généralité, la crainte peut-être de voir remplacer une marine vieille, coûteuse, et lente, par une autre plus en rapport avec le développement de l'industrie et les besoins du commerce, ont empêché d'accueillir cette offre, et conséquemment de donner au riche bassin de la Meuse leu moyens faciles d'écouler le produit des nombreuses usine, et carrières dont il est parsemé, en améliorant une navigation qui se rattache à celle de la Sambre, du Rhin, des canaux et rivières de la France, de la Hollande et de l'Allemagne. » - Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique, etc., par B.-L. De RIVE. Bruxelles, 1835.
(10) « La pente du lit de la Meuse dans la province de Liège est de 18m,26. Le terme moyen de la vitesse du courant est de 55m,60 par minute. On évalue le cube d'eau qui passe annuellement par le pont des Arches à deux billions 794 millions de mètres. » - Dictionnaire géographique de la province de Liège; par. Ph. van der MAHLEN. Bruxelles, 1832.
(11) Le pont de Huy, bâti en 1294, n'existait plus à la fin de 1679. Reconstruit en 1680, il a été achevé en 1688. - Archives de la ville de Huy.
(12) Le pont des Arches, construit en 1038, sous le règne de l'évêque Réginard, s'est écroulé en 1409; rétabli en 1446, il a été emporté en 1643 par une crue d'eau extraordinaire, dont la hauteur, il y a peu d'années, était encore marquée sur un des piliers de l'église St-Barthélemy, à Liège. Sa reconstruction, commencée le 17 octobre 1648, a été terminée en 1657, et a coûté 315,954 for. 14 sols et 3 liards. Pour subvenir aux frais d'un travail si considérable, il fut établi un impôt de dix liard, par tonne de bière, qui, en très peu de temps, couvrit la dépense. L'architecte se nommait CORNELIS PESSERS.
Les archives de la province de Liège renferment un projet de pont destiné à mettre en communication les villages de Jemeppe et de Seraing. Ce projet, qui n'a pas reçu d'exécution, date des premières années de ce siècle, et est dû à M. POTET, architecte des travaux publics. Il s'agissait d'un pont en bois, qui se composait de 6 piles et de 2 culées, couvertes par un plancher d'environ 12 mètres de large; les travées avaient 34m,60, excepté celles des deux extrémités, de 17m,30 chacune; il y avait deux voies, avec plates-bandes en fer pour recevoir les roues des voitures; deux trottoirs étaient ménagés sur les côtés et garantis par des garde-fous; les piles eussent été en bois ou en pierre le projet laisse le choix et en présente de l'une et de l'autre espèce.
Depuis, un projet de pont en fer a été proposé pour le même endroit, en face des établissements de M. John Cockerill.
Ce passage de la Meuse a toujours été très fréquenté: c'est un des points où les relations entre le Condroz et la Hesbaye sont les plus actives. En 1381, un pont de bois avait été construit à Jemeppe, magna suburbanerum et rusticanorum condrosorum commodo - FOULLON, tom. 1er, pag. 446.
(13) La digue de Vivegnis date de l'an 1572; celles de Herstal et de Chertal sont de la même époque. Vers l'an 1645, les dames du monastère de Vivegnis ont fait réédifier la digue de ce nom, « sous l'espérance obligatoire que les manants garantis des inondations, désintéresseraient ces dames. » La batte de Menlevelt-lez-Stockheim, antérieure au XVIIIe siècle, a été reconstruite en 1765, pour conserver les rives de la Meuse. Les archive, de la province de Liège sont riches en documents sur ces ouvrages. Dans les procès-verbaux des séances de l'État noble, année 1778, sont mentionnées des allocations pour réparations à une foule de digues, contre-digues, battes, etc., entre autres à celles de Berg, d'Ophoven, de Neerharen, de Stockheim, de Maeseyck, de Meulevelt, de Hocht, de La Naye, de Vivegnis, de Fragnée, de Tileur, d'Engis, etc., etc.
(14) Règlements de 1651 et 1654. - LOUVREX, tom. III, pag. 235 et 234.
(15) Si la navigation de la Meuse est devenue si difficile dans la traverse de Liège, cela tient â ce que, depuis cinquante ans, elle a cessé d'être l'objet des mêmes soins que par le passé. Précédemment le fleuve était maintenu en bon état par des curages, il était entretenu à grands frais, ainsi que les autres rivières du pays de Liège. LOUVREX, tom. III, p. 13,235, etc. - Mandement pour l'entretien des rivières d'Ourthe et de Vesdre, ainsi que pour la construction et l'entretien du chemin de halage. Ibid., tom. III, pag. 235. Edit du 28 mai 1725, par lequel il est défendu de laisser des bois sur le rivage d'Avroy, attendu que ce bois amasse des fanges et graviers contribuant à remplir le canal qui conduit de l'eau au quartier de l'ile. Ibid., tom. III, pag. 18. - Le 14 juin 1658, dans un règlement sur la rivière d'Ourthe, il est défendu d'en gâter le cours; ordre est donné d'ôter les irigus et autres immondices qui pourraient nuire à la navigation, et de nettoyer la rivière. Ibid. - Mandement sur les rivières de Demer, Stymer, Beeck et autres. Ibid. - Règlement de 1659 et de 1705 sur la police de la ville de Liège. Ibid., tom. III, pag. 8 et suiv.
La négligence a eu de funestes suites: le canal d'Avroy ne s'est comblé peu à peu que parce que les attérissements en amont du pont des Arches, en diminuant une pente déjà très faible, ont rendu tout écoulement impossible, et ces attérissements sont eux-mêmes causés par le défaut de curage, et aussi par les emprises pour l'université, qui ont rejeté le courant sur la rive droite, obliquement au pont des Arches.
La Meuse en cet endroit, refoulée sur la Tour en Bêche par les construction, de sa rive gauche, qui forment un véritable épi, ne ressemble plus guère à ce qu'elle était quand elle s'étendait jusqu'à la rue du Merry, qu'un de ses bras allait se jeter au-dessus du pont des Jésuite., qu'elle battait le derrière des maisons de la rue Sur-Meuse, la rue Sur-Meuse-à l'eau n'étant qu'un chemin de halage, fait à l'époque de la reconstruction du pont des Arches. Aussi a-t-il fallu, en 1446, changer la direction qu'avait l'axe du pont de 1038; du prolongement de la Chaussée-des-Prés jusqu'à la rue du Pont, il a été dirigé du même point de la rive droite vers la rue Neuvice; en 1648, sur la rue Neuvice même, et aujourd'hui la culée de la rive gauche devrait être reportée encore plus en amont.
(16) La rive gauche du canal d'Avroy, a été changée en promenade publique sous l'administration du baron Micoud, préfet de l'Ourthe, qui fit construire le quai de la Sauvenière. Le pont des Jésuites, jeté sur son extrémité d'aval, datait de l'an 1596: il a été démoli en 1827. Le pont d'Avroy, qui joignait les quartiers du centre avec le faubourg St-Gilles, a été détruit aussi dans ces dernière. années.
(17) Une société autorisée par arrêté royal du 27 décembre 1834, avait entrepris la construction du pont de la Boverie, moyennant un péage à percevoir durant 59 ans et 6 mois., qui ont pris cours la 27 janvier 1837, lorsque le pont a été livré à la circulation. Le passage d'eau des Croisiers, momentanément rétabli, l'est au profit des actionnaires du pont.
(18) C'est sur les plans et sous la direction de M. SIMONS, ingénieur en chef des ponts et chaussées, que s'élève ce beau travail.
(19) Mémoire sur le canal de jonction de la Meuse à la Moselle, dans le Luxembourg; par un ingénieur. Mons, 1831.
(20) Aux archives de la province de Liège se trouve, sous la date du 19 décembre 1755, le Plan du pont à faire devant la ville de Visé, pour joindre la chaussée venant de Liège pour aller en Allemagne. Ce pont est en pierre; il a neuf arches reposant sur des piles à distances inégales; la longueur totale est de 288 mètres, et la largeur d'environ 18 mètres. L'auteur, nommé CARRONT, géomètre dont le nom se rencontre fréquemment dans les actes relatifs aux travaux sur la Meuse à celte époque, évalue la dépense à fl. 165,000, auxquels il croit devoir ajouter fl. 15,000 pour les accidents imprévus, avec cette restriction toutefois qui ne laisse pas d'être assez curieuse: « Ne pouvant cependant assurer qu'il ne coûtera pas plus ou moins, attendu qu'il faut dresser des mémoires à ce sujet, après avoir sondé le fond de l'eau, pour voir quelle est la nature du terrain. Il faut prendre des information, pour voir d'où l'on tirera les matériaux, tant pour les pierres, chaux, bois, etc. »
En l'année 1105, it y avait un pont en bois devant Visé. On en construisit un autre en l'année 1380. - FOULLON, tom. Ier, pag. 252 et 445.
(21) Le pont de Maestricht a été bâtis en 1682, par Jacques ROMAN, frère dominicain.
(22) Toutes les opinions sont bonnes à connaître; en voici une qui ne doit point être passée sous silence.
« La Meuse, par une erreur populaire que des géographes ont accréditée, est en possession, depuis plusieurs siècles, d'usurper le nom de fleuve, qui ne lui est dû à aucun titre, puisqu'au lieu de recevoir le Wahal, branche occidentale du Rhin dont la largeur et la profondeur sont beaucoup plus considérables que celles de la Meuse, ce fleuve s'y jette vis-à-vis de Gorcum. Par une cause qu'il serait difficile d'apprécier, le nom de Rhin n'a été conservé qu'au moindre de ses deux bras, qui perd ses eaux dans les sables près de Leyde.
D'après une carte dressée en 1584 par le savant Abraham Ortel, ou OErtel, en latin Ortelius, surnommé le Ptolémée de son siècle, et qui se trouve dans son ouvrage in-fol, intitulé: Theatri orbis terrarum Parergon, sive veteris géographiae Tabulae, imprimé à Anvers en 1595, l'embouchure de la Meuse, indiquée par Ptolémée (Claude), se trouvait de l'an 125 à l'an 135 de notre ère, là où il place actuellement l'embouchure de la branche orientale de l'Escaut; et ce qu'on appelle de nos jours les bouches de la Meuse était alors désigné par le nom de Rheni ostium occidentale, ou embouchure occidentale du Rhin. » - Précis historique et satistique des canaux et rivière, navigables, etc.; par B. L. De RIVE.
Voici encore une opinion d'un autre genre sur la Meuse
Un physicien a remarqué qu'elle s'enfle ordinairement la nuit d'un demi-pied (0m,16242) plus que le jour, si le vent ne s'y oppose pas; mais c'est un fait qu'il faudrait bien constater avant d'en chercher la cause. - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, etc.; Neufchastel, 1765. - M. de Jaucourt, auteur de cet article de l'Encyclopédie, a raison de douter du fait avancé par un physicien; nombre de personnes, très éclairées, connaissant bien la Meuse, ont été consultées sur ce phénomène, et aucune d'elles n'a jamais rien observé qui pût donner lieu de croire à son existence.
(23) A son origine, la Meuse coule sur des bancs de calcaire inclinés vers le nord, et dont le grain semble indiquer un commencement de cristallisation. Le terrain change déjà sensiblement de nature à Bazoilles; ce n'est plus qu'une couche de 8 à 9 mètres de pierrailles argilo-calcaires déposées sans ordre les unes auprès des autres, et jointes entre elles par une terre argileuse rouge, onctueuse, qui se délaie facilement. En approchant de Vaucouleurs, on quitte le terrain de pierrailles; on trouve des bancs calcaires très épais, dans lesquels les coquilles ne sont jamais bien conservées: la masse parait composée d'une matière qui, en prenant un commencement de cristallisation, a agglutine les débris de coquilles. C'est encore le même calcaire à Domremy; mais on aperçoit quelque changement dans l'épaisseur, Ia contexture, le grain et la nature des couches. Jusqu'à Void, ces couches sont souvent recouvertes par des sables argileux, et, à Commercy, elles ont un commencement de contexture spathique: quelques-unes contiennent beaucoup de corps marins.
A St-Mihiel, on voit des carrières de calcaire blanc, d'un grain très fin, n'ayant aucune apparence spathique: il ne renferme que peu de débris de coquilles, ou elles sont réduites en fragments très petits. C'est une pierre dure et compacte, susceptible même d'être travaillée au ciseau.
Verdun est pavé en silex roulés et en pierre coquillière très dure, recueillie l'un et l'autre, sur les hauteurs voisines. Cette pierre calcaire est en grandes couches horizontale, de 0m,15 à 1 mètre d'épaisseur, qui, très nombreuses, sans être parfaitement régulières, présentent une multitude de coquilles, souvent même de coquilles entières, telles que des vis, des cames, des buccins; et, quoique fréquemment séparées par des fentes en différents sens, elles n'en fournissent pas moins de bonnes pierres à bâtir. Elle, donnent aussi d'excellente chaux. On trouve dans les vignes, au-dessus de Verdun, du coté de Clermont, en couches minces et plates, un marbre lumachelle, d'un gris de fer tacheté de gris-blanc, connu, dans le pays, sous le nom de marbre des Argennes. On y distingue très bien les coquilles qui le composent.
Le plus communément il est en bancs minces de 1 à 2 mètres de longueur, dans une terre rougeâtre, argileuse et sablonneuse, dont toutes les hauteurs avoisinantes sont couvertes à près de 1 mètre. Les sables, tablettes, plaques et antres objets fabriqués avec ce marbre, reçoivent un assez beau, poli. On voit aux environs de la même ville quelque, carrières en exploitatsion; dans l'une d'elles, à la côte St-Martin, se remarque celte particularité qu'une couche de silex, de 0m,07à 0m,08 d'épaisseur, traverse la carrière obliquement et produit l'effet d'une paille. Verdun offre encore du sable et de la terre à four qui serait propre à le poterie et à la faience, moyennant quelques légères opérations préliminaires.
La pierre des environs de Stenay est ferrugineuse, jaune et ocracée; elle alterne avec des couches calcaires bleuâtres, ou d'un gris-bleu à grain fin et susceptible de poli. A Signy, à Ecurey et à Montigny, on exploite des mines de fer.
De Steney à Sedan, le Meuse coule sur des masses calcaires plus épaisses, et souvent sur des couches d'argile ferrugineuse.
Les rochers de Sedan et ceux de tous les environ, sont des masses calcaires colorée, par l'oxyde de fer, des couches coquillières alternent entre elles, par la plus ou moins grande quantité de coquilles qu'elles renferment, ou par leur couleur grise, jaune et rougeâtre. Le pavé de la ville est tiré d'un banc calcaire a proximité, bleu et très dur. Le sommet des hauteurs voisines est couvert de cailloux roulés, mêlés, dans du sable, de fragments de quartz et de roches schisteuses.
Depuis Sedan jusqu'auprès de Mézières, le lit de la Meuse est donc une belle vallée dont les deux rives sont douces et fertiles. Mézières, dans la partie la plus étroite d'une presqu'île formée par le fleuve, est sur un calcaire en bancs peu épais, blancs, remplis de coquilles, parmi lesquelles on distingue beaucoup de nautiles mêlées aux astroïtes et madrépores fossiles. La surface du terrain est couverte de fragments de quartz blanc et d'ardoises, avec quelques coquilles pétrifiées et des morceaux de pierre calcaire.
Le même terrain se montre au-dessus de Charleville; mais ici la Meuse quitte le terrain tertiaire et sa belle vallée si évasée, pour couler dans une gorge profonde jusqu'à Givet, entre deux cotes fort élevées de rochers schisteux et d'ardoises dont la couleur varie: elles sont rouges, vertes ou bleues, entremêlées de grès quartzeux très durs. Les deux côtés de cette gorge sont souvent à pic; ils offrent un espect nu, dépouillé de terre végétale, un site des plus sauvages, et, par intervalles, ils ont de 140 à 200 mètres de hauteur perpendiculaire. Près de Dame-de-Meuse, est une suite de roches qui s'élèvent à 330 mètres.
De Revin à Fumay, on trouve encore du quarts et des schistes alternant entre eux, et, en quelques endroits, on observe des coupes de terrain dans lesquelles ces bancs sont devenus perpendiculaires. Parmi les différentes ardoises exploitées à Fumay, il en est qui peuvent être préférées à celles d'Angers: quelquefois elles sont très micacées, souvent grises ou vertes, et rarement bleues; mais, en général, elles sont plus sonores, plus cassantes et moins pyriteuses que celles d'Angers.
De Fumay à Givet, la Meuse est toujours sur des schistes à ardoises, entremêlés de quartz, parfois très abondant. Les couches des terrains voisins sont plus ou moins inclinnées à l'horizon, et quelquefois elles lui sont perpendiculaires. On trouve, au-dessus de Givet, des schistes qui n'on point de disposition fossile et qui n'affectent aucune règle déterminée dans leur cassure; plus loin, on voit des schistes tendres qui, ayant pris des retraits, ont reçu dans leurs fissures, une eau surchargée d'un suc lapidifique quartzeux, qui s'y est consolidé. Le schiste s'est détruit, et, ces infiltrations quartzeuses étant restées, elles offrent des assemblages de prismes creux ou cellules semblables aux Ludus Heimonlii.
Les géologues ont vérifié sur la Meuse ce fait vraiment remarquable, qui consiste en ce qu'une rivière, tant qu'elle coule dans les ardoises et les schistes, ou en général dans les terrains secondaires, est bordée de côtes escarpées fort hautes et fort resserrées, tandis que, dans les pays calcaires, les bassins et les vallées sont au contraire très évasés, et ne présentent sur l'une et l'autre rive que des pentes douces ou peu escarpées.
Au-dessous de Givet, les ardoises et les schistes disparaissent; la Meuse commence alors à couler sur les marbres, changement qui devient surtout très sensible au pied d'une petite colline d'ardoises et de schistes rougeâtres, dont les touches sont obliques, et où commencent réellement les marbres sur lesquels sont adossés les schistes; à Dinant, son lit est creusé deus des marbres blancs et noirs, connus par l'intensité de leur couleur et la beauté de leur poli.
Entre Dinant et Namur, on trouve le terrain secondaire, les schistes micacés et les grès des houillères.
En descendant de Namur à Huy, le fleuve passe sur des marbres et sur du calcaire compacte; à Andenne, on trouve l'argile blanche, exploitée pour la poterie, la faïence et les pipes, et d'Andenne à Huy le terrain houiller reparaît de nouveau. Là, les schistes argileux alternent avec la pierre calcaire compacte. Plus bas, à Loyable, le lit de la Meuse est creusé dans le calcaire; mais à 200 mètres de chaque rive sont des schistes alumineux en exploitation. A Flône, au midi de ces schistes, est un filon de calamine et de plomb, tandis qu'au nord se trouvent plusieurs houillères exploitée, pour les fabriques d'alun et pour le chauffage.
C'est en coulant ainsi sur des schistes, des grès et des houillères, que la Meuse arrive à Liège; on côtoie des bancs calcaires coquilliers alternant avec des lits de silex, jusqu'à Visé, ville située au passage du terrain secondaire au terrain tertiaire, et le même calcaire coquillier se continue jusqu'à Maestricht.
Au côté ouest de la montagne de St-Pierre, au-dessus de Maeatricht, est un escarpement rapide, découpé en plusieurs parties, et formant des sinuosités analogues à celles que produirait un courant qui rencontrerait sur ses bords des obstacles à sa marche. Ce courant, soit de mer, soit d'eau douce, a existé autrefois dans cette ligne et a excavé la vallée profonde arrosée par le Jaer. La partie de la montagne exposée à l'est offre un escarpement élevé sur la rive gauche de la Meuse, qui en baigne le pied. Il est taillé à pic et composé de couches horizontales d'un sable fin, blanc et un peu crayeux, qui alternent avec des couches également horizontales de silex noirs mamelonés et comme branchus, dont quelques-uns ont appartenu autrefois à des madrépores passés à l'état siliceux, mais offrant encore à l'extérieur quelques traces d'organisation régulière. On y voit aussi du bois et des coquilles à l'état siliceux, circonstance d'autant plus digne d'attention, que l'autre face de la montagne renferme en général des madrépores et des coquilles entièrement calcaires et de la plus parfaite conservation, au point que quelques-unes ont conservé leur couleur naturelle. Tout le plateau de la montagne est couvert d'une couche de 8m,50 en galets arrondis ou ovales, de toute grosseur; ils sont d'un quartz grenu, opaque, tantôt grisâtre, tantôt d'un blanc plus ou moins terne, et quelquefois couvert d'oxyde de fer. Il s'y trouve aussi quelques jaspes grossiers, rougeâtres ou d'un violet obscur. Sous cette couche en est une de sable quartzeux, friable, d'un jaune ocreux très vif, posé sur un autre banc de sable quartzeux de 3 mètres, mais verdâtre. Ce banc est directement porté par la partie solide et pierreuse de la montagne, formée d'un grès quartzeux à grain fin, faiblement lié par un gluteux calcaire peu dur, mais assez solide néanmoins pour former de la pierre de taille, qu'on coupe avec une si grande facilité, qu'une exploitation active, durant une longue suite de siècles, a fait de cette montagne un labyrinthe inextricable, et si compliqué, si étendu, que probablement il n'en existe aucun qui puisse lui être comparé. Par là, on est forcé, de croire que l'extraction de la pierre n'a pas seulement servi à Maestricht et aux villes voisines, mais qu'il en a été fait autrefois d'immenses transports par la Meuse, en Hollande et ailleurs. On fait aussi usage de cette pierre sablonneuse, facilement réduite en poudre, comme d'un engrais précieux, très propre à fertiliser les terrains gras. - Dans les bancs de sables et dans la masse continue de pierre calcaire qui forme la montagne, on rencontre des dépouilles nombreuses du règne animal; ce sont des bélemnites isolées, des coquilles fossiles de tout genre, des vertèbres, des dents de poissons, d'amphibies, etc.
De Maestricht, la Meuse coule sur des débris calcaires et des sables jusqu'à Ruremonde; elle continue sur des sables, à travers des landes, jusqu'à Venloo, au-dessous duquel son lit est sur une tourbe mousseuse très légère, qui sert au chauffage, et elle traverse le reste des Pays-Bas sur un fond argileux déposé par la mer. - Description minéralogique de la France, par MONET, inspecteur des mines; Essai petamographique sur la Meuse, par HERICART DE THURY; etc., etc.
(24) S'étendant jusqu'au fond de la rivière, ce revêtement forme une défense inattaquable par les courants les plus rapides, même dans les plus fortes crues, dont l'élévation est cependant de 4 à 5 mètres au-dessus des basses eaux. Sur une longueur de 350 mètres. on a placé des milliers de fascines formant talus et s'avançant jusqu'à 15 et 18 mètres dans la rivière, dont la profondeur est, en cet endroit, d'environ 5 mètres. Le même travail a été fait sur une moindre étendue, mais d'après les mêmes procédés et avec le même soin, au village de Herten et en aval de Ruremonde. La force et la durée de ce genre de revêtement dépendent de son enfoncement dans la rivière; sans cette précaution, les crues d'un seul hiver détruisent l'ouvrage en apparence le mieux fait; si au contraire, assis au fond du lit, il est défendu par sa racine, un léger entretien suffit pour assurer sa conservation pendant des années. Un fascinage exécuté à Swalmen, au-dessous de Ruremonde, dans l'année 1817, sur une longueur de 200 mètres, à près de 5 mètres de profondeur, est encore aujourd'hui presque intact. Il avait coûté de 30 à 35,000 francs.
Le village de Maasbracht n'avait point été oublié dans les allocations du gouvernement belge depuis 1888, pour la défense des rives de la Meuse dans le Limbourg.
(25) On assure que le propriétaire du château d'Osden gagne annuellement, par les alluvions de la rive gauche, plus de deux hectares d'excellente terre sur les villages de Herten et de Linne, placés en face sur la rive droite, et que sa propriété s'est accrue peut-être de 110 à 115 hectares en moins de 50 ans.
(26) Le projet de jonction de la Meuse et du Rhin, avait déjà été conçu antérieurement; il avait même reçu un commencement d'exécution, en 1627, par les ordres de l'Infante Isabelle, sous le nom de canal Eugénien. Ce canal aboutissait à Venloo sur la Meuse, et à Rhinberg sur le Rhin.
(27) Précis historique et statistique des canaux et rivière, navigable., etc.; par B.-L. DE RIVE.
(28) Un mémoire, publié à Liège, en 1740, à l'occasion de la longue guerre de tarifs que, vers le milieu du siècle dernier, se sont faite le pays de Liège et les Pays-Bas autrichiens, mentionne des tarifs de 1590, 1605, 1606, 1671, 1680, etc., pièces qu'il serait intéressant de connaître, mais qu'il est difficile de se procurer. Recueil historique d'actes, négociatnons, etc., par ROUSSET, t. XIV. La Haye, 1742.
(29) Ce droit a varié. En 1779, chaque bateau excédant les 8 pieds de pielle, payait 3 fl.; de 6 pieds jusqu'à 8, 1 fl. 10 sols; de 5 pieds, 15 sols, etc. Les bateaux non chargés payaient la moitié du droit. - Archives de la ville de Huy, tarif du 30 août 1779.
(30) De la souveraineté indivise des évêques de Liège et des états-généraux sur Maestricht, par M. L. POLAIN. Liège, 1831.
(31) LOUVREX, tom. 1er, p. 213.
(32) L'impôt des dix liards par tonne de bière a été affermé, en 1664, pour 41,400 flor.; en 1666, pour 45,000 flor., à un nommé Hendrick Berck. Un document de 1666 montre que; quelques années auparavant, cet impôt n'avait rapporté que 38,000 flor. - Archiv. de la prov. de Liège.
(33) Ce droit était d'un florin par cheval.
(34) La difficulté de connaître le montant de ces droits divers est d'autant plus grande que nous nous éloignons davantage des temps où ils se percevaient, et c'en était déjà une peu d'années après leur suppression. On lit dans une lettre du 10 fructidor an X, adressée par le conseil de préfecture du département de l'Ourthe au préfet de ce département: « Il n'existait jadis dans la partie de la Meuse qui traverse le département de l'Ourthe, que trois sortes de taxes, savoir: celle qui était due pour chaque bateau passant le pont de Huy, et dont la valeur ne nous est pas connue; celle d'un soixantième, argent du pays, à charge des étrangers voiturant par eau pour leur compte et descendant au pont de la Victoire (pont des Arches); enfin, celle d'un florin de Liège, qui se payait au bureau de Coronmeuse, pour chaque cheval de bateau remontant la rivière. » Archives de la province de Luge.
(35) LOUVREX, tom. IV, pag. 267.
(36) Ce placard est du 12 décembre 1656. - Coutume et ordonnances du conseil de Namur, pag. 305.
Les droits usurpés par les barons dans les temps féodaux avaient fini, au moins pour quelques-uns, par être considérés comme régaliens; aussi voit-on que plusieurs châtelains imposaient des péages contre lesquels ni prince ni marchand n'élevait de réclamations. Voici à ce sujet un document que renferment les archives de la province de Liège.
« Specification de ce que chacune marchandise doit passant à Winaige du chasteau Thiry sur Meuse, appartenant au seigneur du dit lieu. 1553, le 27 janvier. - Toute marchandise qui se poisse à balances, pour chascun millier, 1 patar brabant; pour chascune tonne de bierre et havens, 1 blanc; pour one charée de sel, 3 sols 1 blanc; pour chascune navée de charbons passante oultre Bovignes, 18 sols 1 blanc; le ponton seul, idem; quand il demeure à Bovignes, Dinant ou par-desseur, 17 sols; la pasquete seule passante Bovignes, 6 sols 1 quart; demeurant à Bovignes, Dinant ou par-deça , 5 sols... Pour une navée passante oultre Bovignes, 5 sols 1 blanc; chascune pasquete passante le dit Bovignes, 2 sols. Le semblable se faict des escorces, quand il demeure à Dinant ou Bovingnes; etc., etc. » - Liasse des papiers du héraut d'armes Lefort.
Tous les péages féodaux sur la Meuse ne se prélevaient pas avec la même facilité. A Eysden, il y en eut un anciennement qui souleva des plaintes dès le XVI siècle, comme l'atteste une lettre du collecteur du Thoulieu d'Eisden au magistrat de la ville de Ruremonde, escrite le 26 d'april 1563; et plus tard, les magistrats de Liège lui opposèrent une vigoureuse résistance. Les pièces relatives à ce débat ont été recueillies et publiées en un volume: Manifeste et démonstration sincère et véritable de l'usurpation du Thoulieu, entreprinse par les seigneurs gagiers d'Eisden, etc. Liège, 1675.
On lit, pag. 49 et 50 de ce manifeste, le tarif du Thoulieu d'Eisden.
« Pour un premier du vin, vinaigre, huil, harens, poissonnerie et semblables marchandises empacquées en tonneaux, réservé des cuirasses de chasque tonneau, 7 brabanders.
Et pour harens déchargez à Maestricht hors de batteau de chasque tonne, 1 brabonder.
Item de batterie c'est à sçavoir de marchandise de cuivre, de mineraulx rouges en pouldre et tontes aultres sortes de marchandises de poid de chasque livre, 4 deniers de bonne monnoye.
Item de mines d'estain en pouldre, de Thoulieu, 4 deniers bonne monnoye.
D'une pierre sépulchrale, 1 vieux gros de Thoulieu.
Item d'une pierre de moulin, 6 deniers.
Item d'une pierre a aguiser, 4 deniers de bonne monnoye.
De sel, de poisson, de grains nettoyez, et d'escorche de bois, de fer, réservé les cuirasses, aussi réservé les harens, qui se deschargent a Maestreicht, comme est escrit cy-dessus, de touttes marchandises de poid sont les estrangers obligez de payer.
Pour un batteau de sel, un batteau de harengs, un batteau de poissons, 5 brabanders.
Les estrangers doibvent pour un batteau de grains, un vieux gros, réservez les grains que l'on meine en sacque à Maestreicht, en hault ou en bas.
Item les estrangers sont redebvables pour une marque de Thoulieu, 4 deniers.
Item pour un cent de cendre de chalmine de Thoulieu, 4 vieux gros. »
Le Manifeste ajoute, pag. 50: « Pour interprétation et pertinente intelligence de cette liste, servira la lettre escrite par feu Henrick Hoffe lors collecteur dudit prétendu Thoulieu soub le seigneur de Gheleine au Magistrat de la ville de Ruremonde le 26 d'avril 1563, s'excusant, et purgeant de ce qu'il étoit accusé d'avoir excedé en la levée du dit prétendu Thoulieu, déclare n'estre deub, et ne lever d'un lust d'huyle, et savon que douze patars, d'un last de hareng, et de poix, trois patars, d'une navière ou mast du sel pour grande qu'elle fut quand bien elle seroit tirée par quattre, cincque, on plusieurs chevaulx ne se payoit qu'un braspenick valissant un patar, et un liard. »
(37) Archives de la province de Liège. L'art. 18 de l'arrêté du 8 prairial an XI, offre une disposition remarquable sur la manière de procéder aux dépenses d'amélioration et d'entretien des fleuves.
(38) En l'an XI, M. Lejeune, ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la département de l'Ourthe, avait proposé de curer les rivières d'Ourthe, de Vesdre et d'Amblève, d'améliorer leur cours et de réparer les chemins de halage; mais on ne voit pas qu'il ait fait de propositions pour la Meuse.
(39) « Cette contribution n'était point excessive pour les bateliers hollandais; appliquée aux bateliers de la Meuse, elle était exorbitante elle était injuste; car une industrie qui chômait une grande partie de l'année payait la même contribution qu'une industrie toujours active, toujours productive. La preuve de ce que nous avançons nous coûtera peu d'efforts, la voici :
« Les bateaux employés à la navigation en Hollande, ne sont point d'une même construction que ceux employés à la navigation intérieure du bassin de la Meuse. En Hollande, ils sont d'une grande dimension. Le propriétaire et sa famille y ont leur domicile, ils naviguent à la voile et à charge complète; toute l'année ils parcourent les canaux dont ce pays est coupé; côtoient les bords de la mer; descendent ou remontent la Meuse, l'Escaut, le Rhin, sans jamais avoir besoin d'employer le secours des chevaux ou d'ouvriers extraordinaires. Au contraire, les bateaux du bassin de la Meuse jaugeant, pour la plus grande partie, de 80 à 00 tonneaux, ne peuvent aller en amont qu'à l'aide de chevaux et de nombreux ouvriers; pendant une grande partie de l'année ils restent sans emploi, empêchés qu'ils sont de naviguer, en hiver par les glaces et les débordements de la rivière, pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, par le manque d'eau. Leur construction rase et à découvert ne permet point au batelier de s'y établir à demeure, lui et les siens, et il est obligé d'avoir en terre ferme une habitation, où ils sont assujettis à des contributions et à des frais que ne paient point les bateliers hollandais, » - De la suppression, dans l'intérêt de l'exportation des produits belges, des péage. provinciaux, etc.; par J.-J. PICARD, ancien juge au tribunal de commerce. Liège, 1833.
(40) Les passages d'eau sur la Meuse, dans les provinces de Liège et de Limbourg, sont affermés au profit de l'État; dans la province de Namur, ils sont abandonnés aux communes.
(41) Souvenirs de l'ancien paye J. Liège, par CONSTANS, Bruxelles, an X.
(42) Celte année-ci a été des plus défavorables à la navigation. ordinairement les eaux moyennes commencent en octobre, quelquefois même à Ia fin de septembre, et se maintiennent en novembre et souvent une partie du mois suivant; cette année, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et le commencement de décembre n'ont eu que de basses eaux, et les besoins des villes de Sedan, de Mézières et de Charleville l'exigeant impérieusement, il a fallu que les bateaux de houille, à la fin de novembre et jusqu'en décembre, remontassent avec demi-charge et mème moins.
(43) En 1839, les exportations de la ville d'Andenne par la Meuse, en faïence, terre de pipe et sable, se sont élevées à 7,868 tonneaux.
(44) ...« Et cependant notre province y exportait annuellement du charbon (en Hollande) pour plus de cinq millions de florins des Pays-Bas. » - Pétition adressée au Congrès le 6 décembre 1830. Cette pétition est signée de 165 des principaux commerçants et fabricants de la province de Liège.
« On peut admettre sans erreur sensible, qu'avant la révolution, pendant les années 1828, 1829 et 1830, les trois quarts des grosses houilles et le tiers des charbons gailleteux et fins, s'expédiaient tant en Hollande que vers les parties du cours de la Meuse encore régies aujourd'hui par les autorités belges, dont l'accès nous est interdit par l'occupation de Maestricht par les Hollandais. Cette exportation peut donc s'évaluer à:
| 74,390 |
de houille, à flor. 10-00, prix moyen des différentes qualités, |
flor. 743,900 |
| 156,966 |
de charbon, à flor. 4-00, prix moyen des différentes qualités, |
627,864 |
| Total 231,356 |
à flor. 5-93, id. de combustible exporté |
flor. 1,371,764 |
Rapport d. M. DEVAUX, ingénieur en chef des mines dans la 3e division; 28 juillet 1832.
TABLE CHRONOLOGIQUE
Des travaux, faits à la Meuse, quais, ports, ponts, ouvrages en lit de rivière, des projets conçus, des lois, règlements de police, tarifs et arrêtés relatifs à la navigation.
| 115. |
Il y avait en cette année un pont sur la Meuse, à Cheratte. Ce pont ayant été ruiné par Pépin, Charlemagne en employa les débris à bâtir une église à Herstal. |
| 750. |
Pont en pierre construit sur la Meuse par Pepin, entre Jupille et Herstal. |
| 908. |
Le droit de tonlien est mentionné dans un diplôme de Louis, fils de l'empereur Arnulph, en faveur de l'église de Liège. |
| 1088. |
Construction du premier pont des Arches, connu dans l'histoire de Liège sous le nom de pont de Réginard. Ce pont s'écroule en 1409. |
| 1050. |
Vers cette époque fut construit le pont de Meuse, à Namur. |
| 1080. |
Construction d'un pont en pierre à Dinant. |
| 1105. |
Pont en bois devant Visé. |
| 1151. |
Destruction du pont qui existait devant la ville d'Andenne. |
| 1175. |
Le pont de Namur est emporté par les eaux. |
| 1199. |
Traité du 26 août, entre Philippe le Noble, comte de Namur, et Thibaut, comte de Bar, qui stipule, art. 4, que les eaux de la Meuse seront communes entre le comte de Bar et le comte de Namur jusqu'à ta forêt d'Arche; mais, en commençant à cette forêt, la Meuse appartiendra tout entière au comte de Namur. |
| 1294. |
Construction du pont de Huy. Il n'existait plus à la fin de 1678. |
| 1360. |
Reconstruction du pont de Namur par Guillaume I. |
| 1380. |
Construction d'un pont en bois devant Visé. |
| 1381. |
Construction d'un pont en bois à Jemeppe. |
| 1446. |
Rétablissement du pont des Arches. Il est emporté par une crue d'eau extraordinaire en 1643. |
| 1469. |
Cession du droit de tonlieu du pont des Arches, en faveur de Charles le Téméraire. |
| 1479. |
Chartes des naiveurs de Liège. - Elles ont été renouvelées en 1525, 1587, 1613, 1715, 1719 et depuis. |
| 1517. |
Projet de jonction de la Meuse à l'Escaut par la Méhaigne, la Geete et le Demer. Octroi de Charles Quint pour la canalisation de la Geete et du Demer. |
| 1518. |
Le traité conclu le 12 novembre, entre Marie, reine douairière de Hongrie, gouvernante de Pays-Bas, et le prince-évêque de Liège, règle des différends relatifs aux tonlieux de Namur et de Huy. |
| 1533. |
On construit à Namur, le long de la Meuse, une rue qui depuis a été changée en un quai appelé communément Rempart ad aquam.
|
| 1539. |
Projet de pont barrage sur la sauvenière à Liège ajourné 26 août suite à l'opposition manifestée par les meuniers occupant les moulins des Collégiales de Saint-Denis, de Saint-Jean et celui dit de Brabant au pont d'Ile. Le projet ne fut jamais rapporté. |
| 1548. |
Le traité de 1548 confirme le traité du 12 novembre 1518. |
| 1553. |
Tarif des droits perçus au château Thiry sur les marchandises transportées par la Meuse. |
| 1563. |
Tarif des droits de tonlieu perçus à Eisden. |
| 1572. |
Établissement des digues de Vivegnis, de Herstal et de Chertal. |
| 1573. |
Le pont de Dinant est emporté par une crue extraordinaire. Il est remplacé par un pont de bateaux. |
| 1573. |
Une partie du polit des Arches est détruite. |
| 1590. |
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
| 1596. |
Construction du pont des Jésuites, à l'aval du canal de la Sauvenière, a Liège. |
| 1598. |
Charte des naiveurs de Namur, donnée par Philippe Il; elle s'est accrue de nouvelles dispositions en 1697, 1710, 1713, 1718 et 1734. |
| 1605. |
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
| 1606. |
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
| 1611. |
Le 26 janvier, établissement de la première barque marchande entre Givet et Dinant. |
| 1627. |
Projet de jonction de la Meuse au Rhin, commencé par les ordres de l'infante Isabelle. |
| 1643. |
Rétablissement de la digue de Vivegnis. |
| 1648. |
Construction du quai de halage à l'amont et à l'aval du pont des Arches à LIège. |
|
Reconstruction du pont des Arches, achevée en 1657 à Liège. |
| 1651. |
Règlement sur les barques de Huy, qui partaient alors du pont d'Avroy. |
| 1652. |
Mandement qui ordonne aux propriétaires riverains de l'Ourthe d'ouvrir leurs héritages, d'ôter les arbres et haies, afin de donner aux chevaux un libre passage.
|
| 1653. |
Le 14 juin, règlement sur la rivière d'Ourthe. |
| 1654. |
Règlement sur les barques de Huy. |
| 1656. |
Placard de Philippe IV, qui défend à tous les officiers publics de prendre on exiger aucune chose sur bateaux, etc. |
| 1657. |
Adjudication du péage sur et sous le pont des Arches. |
| 1659. |
Règlement sur la police de la ville de Liège et sur la police de la Meuse dans la ville. |
| 1671. |
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
| 1680. |
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
|
Reconstruction du pont de Huy, terminée en 1688. |
| 1683. |
Construction du pont de Maestricht, bâti par Jacques Roman, frère dominicain. |
|
Tarif des droits à payer sur la Meuse dans le pays de Liège. |
| 1685. |
Mandement qui renouvelle aux propriétaires riverains de l'Ourthe, l'ordre d'ouvrir leurs héritages, d'ôter les arbres et haies, afin de donner aux chevaux un libre passage. |
| 1700. |
Prélèvement du soixantième au bureau de Neer, plus bas que Ruremonde. C'était une nouveauté illégitime introduite par les Liégeois. |
| 1705. |
Règlement sur la police de la ville de Liège. |
| 1712. |
Tarif des droits perçus pour les marchandises transportées sur la Meuse. |
| 1713. |
Établissement d'un bureau de péage à Well, par le roi de Prusse. |
| 1715. |
Mandement du prince-évêque de Liège sur les chemins de halage de l'Ourthe, portant règlement pour les usines de cette rivière, et ordonnant aux riverains de draguer le lit. |
| 1717. |
Reconstruction du pont de Dinant. |
| 1718. |
Supprimé à main armée par l'électeur de Bavière, le bureau de Neer fut rétabli en 1718. |
| 1720. |
Projet de jonction de la Meuse à la Saône par le Vair. Ce projet, dû à M. de Bavilliers, ingénieur, ne fut pas accueilli. |
| 1725. |
Le 28 mai, édit par lequel il est fait défense de laisser des bois sur le rivage d'Avroy. |
| 1728. |
Construction du quai le long du rivage St-Martin, à la Plante (Namur). |
| 1798. |
Édit qui défend au comte d'Arberg, seigneur de la Rochette, de prélever des droits sur les bateaux de la Vesdre. |
| 1736. |
Mandement du prince-évêque de Liège sur les chemins de halage de l'Ourthe, en date du 22 septembre. |
|
Mandement du prince-évêque de Liège sur les chemins de halage de la Vesdre, en date du 12 novembre. |
| 1738. |
Le sieur Bresson propose la jonction de la Meuse à la Saône par le Mouzon, en partant de Neufchâteau. |
| 1742. |
Mandement pour la Vesdre, les usines et la navigation. |
| 1751. |
Mandement pour la Vesdre, qui oblige les maîtres d'usines à lâcher leurs eaux à certaines heures, pour que les bateliers puissent naviguer librement; la même obligation leur est imposée à l'égard des barques de Chaudfontaine. |
|
Le roi Stanislas échoue dans le projet de jonction de la Meuse à la Saône. |
| 1755. |
Projet d'un pont en pierre à établir devant la ville de Visé. |
| 1765. |
Reconstruction de la batte de Meulevelt-lez-Stookheim, laquelle était antérieure au XVIIIe siècle. |
|
Mandement relatif au halage de l'Ourthe et de la Vesdre. Il renouvelle aux maitres d'usines de cette dernière rivière, l'ordre de lâcher leurs eaux à l'heure convenue avec les bateliers. |
| 1768. |
Mémoire du sieur Cretté, ingénieur, pour obtenir l'autorisation d'ouvrir le canal de Champagne. |
| 1770. |
Chemin de halage à l'aval du pont de Huy. |
| 1779. |
Tarif des péages perçus au pont de Huy, et affermés le 24 août. |
| 1783. |
Proposition de canalisation de la Meuse, depuis Verdun jusqu'au confluent du Vair. |
| 1784. |
L'empereur Joseph Il abolit à Namur le droit du soixantième. |
| 1785. |
Route de Huy à Namur dans la vallée de la Meuse. |
| 1788. |
Projet de canal, à Sedan, ayant pour effet de couper un coude long et dangereux. |
| 1789. |
Commencement d'exécution du canal de Sedan, bientôt interrompue par les événements politiques. |
| |
REVOLUTION LIEGEOISE
|
| 1794. |
Mémoire sur les améliorations à faire a la Meuse, publié par M. Lecreulx, officier du génie. |
| 1797. |
Arrêté du Directoire exécutif, du 18 nivôse an V, sur les chemins de halage. |
| 1798. |
Arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an VI, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières navigables et flottables. |
| 1798. |
Loi du 6 frimaire an VII, relative au régime et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables. |
| 1800. |
Mémoire du 1 frimaire an IX, par M. Lejeune, ingénieur en chef, sur l'état de la navigation dans le département de Sambre-et-Meuse. |
|
Mémoire du 28 du même mois, par le même ingénieur, sur l'état de la navigation dans le département de l'Ourthe. |
| 1802. |
Projet de réunion de la Meuse à l'Escaut, par M. Cayenne, ingénieur des ponts et chaussées, au mois de thermidor an X. |
|
Loi du 14 floréal an X, autorisant le Gouvernement à déterminer les droits sur les bacs et bateaux de passage, comme aussi sur les ponts concédés. |
|
Loi du 30 floréal an X, qui crée des droits de navigation. |
|
Décret du 9 thermidor an XI, ordonnant l'ouverture du canal du Nord, destiné à joindre l'Escaut à la Meuse et la Meuse au Rhin. |
| 1803. |
L'arrêté du 8 prairial an XI divise en bassins la navigation intérieure de la France. |
|
Rapport fait en l'an XI par le préfet de l'Ourthe, et qui signale l'état alarmant du chemin de halage. |
| 1804. |
Arrêté du 8 floréal an XII, relatif aux baux des droits de bacs et de passages d'eau, et à l'emploi de leurs produits. |
|
Projet proposé le 30 prairial an XII, par M. Lejeune, ingénieur en chef, pour l'amélioration du Forchu-Fossé à LIège. |
|
Réparations au chemin de halage, en l'an XII. |
|
An XIII. Reconstruction de l'arche du milieu et des avant-becs du pont de Huy, par M. Lejeune, ingénieur en chef, qui en avait présenté le projet dès l'an V. |
| 1805. |
Décret du 8 mars 1805, ordonnant le canal de Soissons, à l'effet d'ouvrir une ligne directe de Rotterdam à Paris, par l'Aisne et la Meuse. |
|
Décret du 4 prairial an XIII, qui fixe la largeur des chemins de halage et promulgue en Belgique l'art. 7 du titre XXVIII de l'ordonnance du mois d'août 1669. |
|
Décret impérial du 8 vendémiaire an XIV, réglant que les contraventions à l'art. 7, titre XXVIII, de l'ordonnance de 1669, seront jugées administrativement. |
|
Deux décrets relatifs à la Meuse ont été rendus le 10 brumaire an XIV: l'un établit un droit de navigation sur la Meuse, l'autre fixe les bureaux et règle la perception. |
| 1806. |
Le 11 janvier, publication à Liège du décret du 10 brumaire an XIV. |
|
Reprise des travaux du canal de Sedan. |
| 1807. |
Projet proposé le 18 mai par M. Cl. Deschamps, ingénieur en chef, pour remédier aux ravages causés par le Forchu-Fossé. |
| 1808. |
Décret impérial du 22 janvier, qui déclare l'art. 7, titre XXVIII, de l'ordonnance de 1669, applicable à toutes les rivières navigables de l'empire. |
|
Arrêté du préfet, en date du 1er août, pour le chemin de halage de l'Ourthe. |
|
Commencement des travaux du canal du Nord, abandonnés en 1813. |
| 1810. |
Achèvement du canal de Sedan. |
| 1812. |
Route de Huy à Liège par la vallée de la Meuse. |
| 1813. |
Projets pour l'amélioration de la Meuse au coude des Augustins, et pour l'alimentation du canal de la Sauvenière, avec bassin sur la promenade d'Avroy. |
| 1814. |
Le 5 juin, arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin, qui rétablit, conformément au décret du 10 brumaire an XlV, la perception des péages, qui avait été suspendue sur la Meuse, à l'arrivée des alliés. |
| 1815. |
Le traité de Vienne, en date du 9 juin, règle que les droits perçus à cette époque sur la Meuse, en vertu des décrets du 10 brumaire an XIV, ne seront pas augmentés. |
|
PAYS-BAS
|
| 1818. |
(15 septembre). Loi qui fixe un droit de tonnage dit lastgeld, espèce de patente pour chaque bateau. |
| 1817. |
Fascinage exécuté à Swalmen, au-dessous de Ruremonde. |
| 1818. |
Dispositions règlementaires prises dans le Limbourg, renouvelées eu 1825 et approuvées le 18 novembre de la même année, par arrêté royal, qui mettent les ouvrages défensifs des rives de la Meuse à la charge des communes. |
|
Arrêté royal du 1er mars, supprimant les taxes qui, dans quelques communes, restreignaient la liberté de la navigation. |
|
Arrêté royal du 21 mars, réglant le mode de travaux de défense à faire à la Meuse dans le Limbourg. |
| 1818. |
Arrêté du gouverneur de la province de Liège, en date du 26 octobre, pour les chemins de halage de la Meuse et de I'Ourthe. |
| 1819. |
Arrêté royal du 17 décembre, qui divise et confie l'administration de la Meuse aux trois provinces de Namur, de Liège et de Limbourg. |
|
Construction de portions de chemin de halage. |
| 1820. |
(30 octobre). Règlement pour la navigation de la Meuse et de quelques autres rivières, approuvé par arrêté royal du 1 janvier 1821. |
|
Construction de portions de chemin de halage. |
| 1821. |
(12 juillet). Le droit dit lastgeld est abrogé. |
|
Construction du canal des Ardennes. |
| 1822. |
Projet de réunion de la Meuse à l'Escaut, par un canal dirigé de Louvain sur Charleroy. |
|
Chenal creusé, mais bientôt détruit, au droit de la ville d'Andenne. |
| 1824. |
Projet de réunion de la Meuse à l'Escaut, par un canal dirigé de Louvain sur Namur. |
| 1825. |
Projet de canalisation de la Sambre. |
|
Construction du chemin de halage, à Dinant, depuis la promenade qui longe la rive de la droite Meuse, en amont du pont, jusqu'au rivage de la barque, sur une longueur de 475 mètres. |
|
Quai de déchargement au rivage St-Martin, à la Plante. |
| 1826. |
Ouverture du canal de Bois-le-Duc à Maestricht. |
|
Projet de canalisation de la Meuse depuis la frontière de France jusqu'à Namur, par M. R. De Puydt. |
| 1817. |
Démolition du pont des Jésuites, à Liège. |
|
Ouverture du canal des Ardennes, sans qu'il fût encore complétement achevé. |
| 1828. |
Projet de canal destiné à joindre la Meuse à la Moselle. |
|
Mur de soutènement exhaussé à la Plante. |
|
Appel du conseil communal de Liège aux gens de l'art, pour des projets d'amélioration au canal de la Sauvenière. |
| 1829. |
Projet de dérivation de la Meuse, à Liège, par M. l'architecte Beaulieu. |
|
La canalisation de la Sambre est en partie achevée, et une assez grande étendue de la rivière est livrée à la navigation. |
|
La compagnie française concessionnaire du canal des Ardennes, autorisée par le Gouvernement français à faire des études pour l'amélioration de la Meuse jusqu'au pont de Jaspe, offre an Gouvernement des Pays-Bas de se charger du même travail en Belgique. Ses propositions ne sont pas agréées. |
|
BELGIQUE
|
| 1831. |
Mémoire sur le canal de Meuse et Moselle. - Vues sur les améliorations a faire à la Meuse. |
| 1834. |
Adoption du pont en pierre pour le remplacement du passage d'eau de la Boverie. |
|
Projet d'un draguage dans le chemin des bateaux, à la Basse-Enhaive. |
|
Établissement de portions de pérés et réparations au chemin de halage. |
|
Placement de garde-corps le long de la Meuse, sur la route Namur à Dinant. |
| 1835. |
Reconstructions d'aqueducs au rempart ad aquam. |
| 1836. |
Essais de draguages sur la Meuse, par M. De Sermoise, ingénieur en chef du Limbourg. |
|
Réparations au chemin de halage, dans la province de Namur pour une somme de fr. 14,700. |
|
Loi du 9 juillet, qui change tout le système établi précédemment sur la Meuse française et qui fixe le tarif des droits de navigation. |
|
Prolongation du chemin de halage, à Huy, sous la première arche du pont et un en amont de cette arche. |
| 1837. |
Passe artificielle de Dom le Mesnil, sur la Meuse française. |
|
Adjudication d'un rivage, à Jambes. |
|
Projets de dérivation présentés par MM. Chevron, Franck, Renoz et Van Keerbergen. |
|
Projet de creusement d'un chenal à la Basse-Enhaive, au moyen du bateau dragueur de la Sambre, d'un cube de 500 mètres, et réparations au chemin de halage, établissement de quelques parties de pérés, etc. |
|
Projet d'amélioration au cours de la Meuse dans la province de Limbourg, par M. De Sermoise, ingénieur en chef. |
|
Le principe adopté pour la Basse-Seine devient la règle des péages pour la Meuse et d'autres rivières, en conformité de la loi du 9 juillet 1838. |
|
Loi du 17 mai 1837, qui affecte fr. 7,000,000 aux travaux de la Meuse française. |
|
Le 21 août, formation de la première société (société liégeoise) pour la navigation à vapeur sur la Meuse. |
| 1838. |
Loi du 21 décembre, par laquelle, chap. IV, art. 2, l'État reprend l'administration de la Meuse, à partir du 1er janvier 1840. |
|
Construction du rivage du Jeu-de-Balle, à Dinant. |
|
Passe artificielle de St-Louis, sur la Meuse française. |
|
Construction d'un pont suspendu en fer, à Monthermé, sur la Meuse française. |
|
Dérivations, en partie souterraines, entreprises à Revin et à Chooz, sur la Meuse française. |
| 1839. |
Essais de draguages tentés par la société liégeoise pour la navigation à vapeur sur la Meuse. |
|
Rivage de Froidveau, à Dinant. |
|
Rivage des Tanneries, à Dinant. |
|
Enlèvement d'un banc de sable, en amont du pont de Dinant. |
| 1840. |
Exécution d'un revêtement en fascinage, en amont de Vessem, pour sauver le village de Maasbracht. |
|
Construction d'un rivage entre les portes de Gravière et du Cul-du-Tan. |
|
Ouverture des dérivations éclusées de Donchery et de Villette, sur la Meuse française. |
|
Construction de la passe artificielle de Fépin, sur la Meuse française. |
| 1840. |
Ponts suspendus sur la Meuse française à Revin, à Fumay, etc. |
|
Commencement de la passe artificielle de Chokier. |
| 1841. |
Construction du pont du Val Benoit, à Liège. |
|
Démolition et reconstruction du pont de la Boverie, à Liège. |
|
Arrêté royal du 8 novembre 1841, portant règlement de police et de navigation pour la Meuse belge. |
| 1842. |
Construction du premier pont suspendu sur la Meuse belge, à Seraing. |
|
Passes artificielles d'Anseremme, de Tailfer, des Grands-Malades, des îles de Beez, du Val-St-Lambert et de Jupille. |
|
Ouverture de la dérivation de Mézières. |
|
|
NOTA. Des constructions de ponceaux, soit en bois, soit en pierre, des réparations aux chemins de halage, aux murs de quai, et beaucoup d'autres menus ouvrages qui ne sont pas repris en détail dans les cinq rapports sur la Meuse, n'ont pu trouver place dans cette table.
|
|



